Partie I. Chapitre 1.
L’ère post-, changement de paradigme axiologique du théâtre politique
En novembre 1989, la chute du Mur de Berlin marque si l’on peut dire le commencement de la fin de l’Empire Soviétique, et la disparition officielle de l’URSS en 1991 ne fera que confirmer l’événement dans ses répercussions à plusieurs niveaux :
effondrement d’un monde bipolaire articulé autour d’une lutte entre deux superpuissances dont le combat est celui de deux systèmes politiques, économiques et idéologiques – URSS vs USA, communisme vs capitalisme, système autoritaire vs démocratie.
La fin réelle de l’URSS coïncide ainsi avec celle d’un monde bipolaire, et marque l’avènement d’un nouvel ordre mondial.
Mais c’est surtout l’effondrement de l’idéal révolutionnaire, et 1989 sonne le glas symbolique définitif de l'utopie communiste, avec tout ce qu'elle a charrié d'illusions et de déception pour les intellectuels et les artistes, et singulièrement pour le théâtre révolutionnaire de gauche.
Le processus de démythification était largement entamé avant 1989, mais la destruction concrète du modèle soviétique sur le plan étatique a néanmoins marqué les consciences occidentales comme la fin réelle et idéologique d'un monde.
L'équilibre politique mondial va s'en trouver bouleversé, mais également le tréfonds des consciences individuelles et collectives.
Désormais ne se pose plus tant la question de savoir quel nouvel idéal évoquer, que celle de l'opportunité qu'il y a à convoquer un quelconque idéal, toute volonté globalisante étant systématiquement soupçonnée de totalitarisme.
C'est donc l'idéal révolutionnaire au sens d'un changement politique radical qui est remis en question 108 , ce qui interdit de penser l’avenir sous forme de rupture possible, et tend à accréditer la formule précédemment citée de François Furet selon laquelle « nous sommes condamnés à vivre dans le monde dans lequel nous vivons. » 109
Notes
108.
Dans Penser la révolution française F. Furet relit ainsi la période de la Révolution Française à la lumière de Archipel du Goulag, posant comme hypothèse que « le Goulag conduit à repenser la Terreur en vertu d'une identité de projet. » (Penser la Révolution Française, François Furet, Gallimard, 1979, p. 26.)
109.
François Furet, Le Passé d’une illusion, essai sur l’idée communiste au XXe siècle, (première édition : Paris, Calmann-Lévy, Robert Laffont, 1995), Paris, Livre de Poche, 2003, p. 809.
Partie I. Chapitre 1. 1.
1989 : Rupture ou radicalisation de traumatismes antérieurs ?
L’effondrement de l’idéal communiste vient donner le coup de grâce à une conception du monde déjà mise à mal par la découverte des camps de concentration et par les différentes vagues de contestation de l’idéal communiste du fait de ses incarnations réelles.
Si nous insistons sur le rappel historique des conditions d’émergence de cette référence au totalitarisme et singulièrement au génocide perpétré durant la Deuxième Guerre Mondiale 110 , c’est parce que la mise en avant de la référence à Auschwitz comme fondation d’un certain théâtre contemporain nous paraît occulter un passé plus récent et dans lequel les artistes de théâtre ont été partie prenante.
Alors qu’aujourd’hui certains tendent à faire de la Shoah l’événement fondateur d’une nouvelle conception du monde, il semble bien plutôt que ce soit l’effondrement de l’idéal révolutionnaire qui ait entraîné depuis la fin des années 1970 une lecture rétrospective de la solution finale et une redéfinition du rapport que les artistes de théâtre entretiennent avec la politique et le théâtre politique.
Notes
110.
Ce rappel sera forcément lacunaire et schématique, ce dont nous nous excusons par avance. Il s’agit pour nous de mettre en lumière le décalage entre les événements qui sont aujourd’hui jugés saillants et déterminants et le rappel des événements dans leur déroulement historique, notre objectif étant de comprendre les sources des contradictions et tensions dont témoignent aujourd’hui les artistes de théâtre dans leur rapport au politique.
Partie I. Chapitre 1. 1. a.
Le marxisme après-guerre comme première réponse
au « plus jamais ça. »
Dans l’immédiat après-guerre, la découverte des camps de concentration ne s’accompagne pas encore d’un discours théorique, ce qui s'explique par deux types de raisons : la survie psychique et la nécessité économique. D'une part, les déportés ne parlent pas de l’expérience inouïe et impensable des camps, et les blessures individuelles et collectives sont beaucoup trop vives pour être regardées en face ou théorisées. D'autre part, l’heure est à la reconstruction, et l’ensemble de la population connaît encore la faim et le rationnement. Cependant, dès cette période, le procès de Nuremberg, qui se déroule du 20 novembre 1945 au 10 octobre 1946, crée la notion juridique de crime contre l’humanité. 111
En 1948, les Nations Unies publient la Déclaration universelle des droits de l'homme 112 ,
qui constitue un modèle pour tous les gouvernements qui souhaitent s'y conformer. Elle affirme l'existence de « droits de l'homme universels » qui s'appliquent de la même manière à tous les êtres humains. Ce qui domine donc c’est la volonté de faire justice et de tirer les leçons de l’histoire récente, autrement dit d’intégrer l’événement historique que constitue la Seconde Guerre Mondiale dans l’histoire du XXe siècle. D’où une réflexion sur le nom à créer pour désigner ce que Churchill avait qualifié de « crime sans nom ». Le terme de Holocauste apparaît très rapidement dans la bouche des américains. Ce terme, du latin holocustum (brûlé tout entier) désigne « chez les Juifs [un] sacrifice religieux où la victime était entièrement consumée par le feu. » 113
Certes, nous dit le dictionnaire, le sens du terme n’est pas forcément religieux et peut désigner « un sacrifice total, à caractère religieux ou non ». Mais la référence à la religion et spécifiquement à la religion juive est contenue dans la référence à l’Holocauste avec une majuscule, terme qui met en relief une spécificité de l’extermination des Juifs. La référence à la notion de sacrifice suggère que les victimes se seraient offertes en sacrifice ou que leur extermination aurait été le fruit d’une volonté divine, ce terme est donc sujet à polémiques. Le terme de génocide, créé en 1944 par le juriste polonais Raphaël Lemkin, est repris pour la première fois du point de vue du droit international, par l'accord de Londres du 8 août 1945 portant statut du tribunal militaire international de Nuremberg, chargé de juger les criminels de guerre nazis. La définition est ensuite précisée par la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (article 2), adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948, qui entre en vigueur le 12 janvier 1951. 114
En 1961, le procès de Adolf Eichmann, dignitaire nazi et responsable logistique de la solution finale, modifie la perspective et revêt une fonction importante pour les Juifs et les Israéliens d’appropriation de l’événement que constitue le génocide. 115
Ce procès a lieu à Jérusalem, et fait suite à l’enlèvement de Eichmann en Argentine par le Mossad. C’est le procès Eichmann qui « enclenche le processus d’identification aux victimes et non plus seulement aux révoltés des ghettos et aux résistants » 116 :
‘« L’importance réelle du procès a tenu à sa fonction de thérapie collective. Avant le procès, en Israël, le génocide était presque complètement tabou. Les parents n’en parlaient pas à leurs enfants, et ceux-ci n’osaient pas poser de questions. L’horreur, la culpabilité et la honte plongeaient l’Holocauste dans un profond silence. Beaucoup d’Israéliens se sentaient coupables d’avoir fui l’Europe avant la catastrophe, voire d’y avoir laissé des êtres chers. Nombre de rescapés étaient honteux d’avoir survécu. Bien des Israéliens méprisaient la faiblesse des victimes et demandaient pourquoi les juifs ne s’étaient pas défendus. Certains regardaient de haut les anciens déportés, prétendant représenter, eux, ce "juif nouveau" cher à la mythologie sioniste. C’étaient des gens brisés, physiquement et mentalement. Beaucoup d’entre eux n’avaient pas de plus fort désir que de partager leurs expériences, mais peu de gens s’y intéressaient. […] Le procès Eichmann a marqué le début d’un processus au cours duquel l’Holocauste, de traumatisme mystérieux et terriblement douloureux, s’est transformé en mémoire nationale institutionnalisée, pour devenir un élément essentiel de l’identité d’Israël, de sa culture et de sa vie politique. » 117 ’
Notes
111.
La notion de crime contre l’humanité est ainsi définie par le tribunal de Nuremberg : « L’assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal. »
112.
Déclaration adoptée, depuis, par tous les pays membres des Nations unies.
113.
Article « Holocauste », Le Robert, Dictionnaire de la langue Française, Tome V, deuxième édition revue et enrichie par Alain Rey, 1989, p. 214.
114.
Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948, article 2 : « Dans la présente convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a. Meurtre de membres du groupe ; b. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe » . Sur la notion de génocide, consulter Jacques Sémelin, « Massacres et génocides » Le Monde Diplomatique, avril 2004, et Purifier et détruire : Usages politiques des massacres et génocides, Seuil, La Couleur des idées, 2005.
115.
L’historien Stephan Katz ira jusqu’à soutenir qu’un seul génocide a été perpétré dans l’Histoire, celui des Juifs.
116.
Annette Wieworka et Nicolas Weill « La construction de la mémoire de la Shoah : les cas français et israélien », compte-rendu des Conférences et séminaires sur l'histoire de la Shoah, Université de Paris I, 1993-1994 in Les cahiers de la Shoah n°1, Les Éditions Liana Levi, 1994.
117.
Tom Segev, « En 1961, le tournant du procès Eichmann », Le Monde Diplomatique, avril 2001.
Partie I. Chapitre 1. 1. b.
La découverte de « la banalité du mal »,
point de départ d’un pessimisme anthropologique
Le procès Eichmann est l’occasion d’une mise en lumière de la spécificité du génocide juif qui tend à l’extraire de l’histoire – interprétation qui servira ensuite à remettre en cause la notion d’histoire comme mouvement téléologique orienté vers un progrès.
Mais ce procès est également le moment d’une réflexion plus universalisable sur la banalité du mal avec la parution de l’essai de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. 118
Dans son ouvrage qui compile ses chroniques de ce procès, Arendt conclut qu'Eichmann n'a montré ni antisémitisme ni troubles psychiques, et qu'il n'avait agi de la sorte durant la guerre que pour « faire carrière ».
Elle le décrit comme étant la personnification même de la banalité du mal, se basant sur le fait qu'au procès il n'a semblé ressentir ni culpabilité ni haine et présenté une personnalité tout ce qu'il y a de plus ordinaire.
Elle élargit cette constatation à la plupart des criminels nazis, et ce quelque soit le rang dans la chaîne de commandement, chacun effectuant consciencieusement son petit travail de fonctionnaire ou de soldat plus préoccupé comme tout un chacun par son avancement que par les conséquence réelles de ce travail.
Chez Arendt la mise en lumière de la banalité du mal ne débouche cependant pas sur un pessimisme anthropologique mais sur l’importance de garde-fous anti-totalitaires. Mais les travaux de Arendt ne trouvent encore que peu d’écho dans les années 1960.
Notes
118.
Hannah Arendt, (Eichman in Jerusalem : A Report on the Banality of Evil, 1963), Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, traduction française A. Guérin, Gallimard, (1966), Folio, 1991.
Partie I. Chapitre 1. 1. c.
Le néo-marxisme et l’Ecole de Francfort :
critique de la modernité des Lumières…
et maintien d’une ambition critique
et d’un espoir politique
L’on peut considérer que c’est l’affiliation au Parti Communiste et au marxisme qui a empêché durant toute cette période la diffusion de la pensée de Hannah Arendt, qui ne pense pas uniquement à partir des notions de lutte des classes et dont la complexe réflexion sur le politique s’accorde mal au monde bipolaire et à la vision du monde dichotomique qui prévaut à l’époque 119 tandis que sa réflexion sur le totalitarisme est mal perçue du fait des successives découvertes concernant la réalité de la situation dans les pays communistes. De fait, Hannah Arendt est alors lue essentiellement dans les milieux libéraux, qui tentent de l’utiliser, parfois à contre-sens. Les idées de Arendt ne seront popularisées que dans les années 1980, comme voie de sortie du marxisme, débouchant pour certains sur une radicalisation de la critique du totalitarisme et une défiance à l’égard de toute institution et de toute forme d’organisation politique ou sociale, alors que pour d’autres sa pensée sur La condition de l’homme moderne ouvre une voie pour retrouver la politique en contexte post-marxiste.La critique qui prévaut dans les années 1960 est celle que font les néo-marxistes gravitant autour de ce que l’on a appelé l’Ecole de Francfort. Ils livrent une critique radicale des Lumières en revenant aux premiers textes de Marx, dont ils prolongent l’héritage d’une pensée critique de dénonciation des injustices contre l’héritage d’une philosophie téléologique de l’histoire fondée sur le progrès et la raison : « [...] L’Aufklärung, au sens le plus large de pensée en progrès, a eu pour but de libérer les hommes de la peur et de les rendre souverains. Mais la terre, entièrement « éclairée », resplendit sous le signe des calamités triomphant partout […]. La raison est totalitaire. » 120 L’antisémitisme et le racisme, données inséparables l’une de l’autre et qui dépassent le cadre de la Deuxième Guerre Mondiale, illustrent le caractère illusoire de la pensée universaliste des Lumières. 121 Horkheimer pratique ainsi « la dénonciation de ce qu’on qualifie actuellement de raison » 122 , suggérant que « le caractère vraiment épouvantable du système réside plus dans sa rationalité que dans sa déraison. » 123 Les Lumières n’ont pas éclairé le monde, elles n’ont pas empêché voire ont conduit à la catastrophe. C’est pour cette raison que désormais « les espoirs que Marx et Lukacs, et Horkheimer lui-même auparavant, avaient placé dans le prolétariat » 124 , Horkheimer les place « dans tous les sujets de la civilisation mais surtout dans les fous, les délinquants et les rebelles "noirs." » 125 Ce processus par lequel la figure de l’exclu, du marginal 126 , vient supplanter celle du prolétaire, et tend à la faire passer à l’arrière-plan, nous paraît primordial, de même que cette évolution du marxisme dans les années 1960. Mais la critique des Lumières et de la raison ne débouche pas sur l’impossibilité de tout projet critique, elle lui ouvre au contraire de nouvelles voies :
‘« La Théorie critique […] peut au premier chef « témoigner contre » la Raison instrumentale 127 ; elle "revaloris[e] une certaine forme de référence à la subjectivité et à la finitude", l’esthétique, particulièrement 128 ; elle met en avant, avec les écrits d’Adorno « un nouvel art de « moraliste » » 129 ; enfin, avec Marcuse, « à travers le destin de la société « sur-répressive » […] , [elle] arrive à point pour fournir à l’explosion de 1968 […] un [de ces] textes de légitimité. » 130 » 131 ’
De fait, dans L’homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la société industrielle avancée 132 – ouvrage qui connaît un grand succès aux alentours de Mai 1968 – Marcuse récupère le marxisme contre le capitalisme pour dénoncer le marché et la consommation de masse, qui entraînent une forme de réification de l’homme, la standardisation de la production, des goûts et des individus, ainsi que le passage de l’œuvre au produit. L’auteur dénonce donc déjà la société de consommation, dont la forme démocratique ne doit pas masquer les nouvelles formes de contrôle social qui tendent à dépouiller l'individu-consommateur de sa liberté et de ses goûts et opinions propres. D’où la tentation de rejeter toutes les institutions et les organisations quelles qu’elles soient – y compris les organisations syndicales ou les partis – en ce qu’elles sont toujours déjà, toujours en germe, totalitaires, génératrices elles aussi d’un système qui broie les individus. On trouve dans cet ouvrage « freudo-marxiste » l’ambiguïté qui sera au cœur du mouvement de contestation, mêlant ce que Luc Boltanski et Eve Chiapello ont nommé la « critique sociale », fondée sur la notion de lutte des classes et le principe de l’organisation et de l’action collective et la « critique artiste » centrée sur la revendication de liberté pour des individus autonomes. Et ce sont ces ambiguïtés, débouchant sur l’échec du mouvement de Mai, ainsi que l’évolution de la situation internationale, qui vont progressivement obérer l’espoir qu’une critique radicale de la société existante soit possible – et non pas la découverte des camps de concentration.
Notes
119.
Mitterrand opposera encore le parti de l’ordre – de la réaction – au parti du mouvement – articulé à l’idée de progrès et d’un sens vers un mieux.
120.
Max Horkheimer, Théodor Adorno, La dialectique de la raison. Fragments philosophiques, Paris, Gallimard, coll. Tel, 2000 (1974), p. 24 ; traduction française de : Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, New York, Social Studies Association, Inc., 1944, p. 21 et p. 24.
121.
Rolf Wiggershaus, L’école de Francfort, Histoire, développement, signification, (1986), traduction Lilyane Deroche-Gurcel, PUF, 1993, p. 331 et suivantes.
122.
Horkheimer, cité par Rolf Wiggershaus, ibid, p. 336.
123.
Marcuse, « Lettre à Horkheimer » du 18 juillet 1947, en réponse au texte de Horkheimer Eclipse of Reason. Cité par Rolf Wiggershaus, ibid, p. 336-237.
124.
Rolf Wiggershaus, ibid, p. 336.
125.
Idem.
126.
Du marginal psychique en l’occurrence.
127.
Paul-Laurent Assoun, L’école de Francfort, Que Sais-je ?, 2001.p. 102
128.
Ibid, p. 103.
129.
Idem.
130.
Ibid, p. 104.
131.
René-Eric Dagorn, « Critique de la théorie critique », EspacesTemps.net, 01.05.2002.
132.
Herbert Marcuse, L'Homme unidimensionnel (1964), Éd. de Minuit, 1968.
Partie I. Chapitre 1. 1. d.
De la lente désillusion à l’égard du communisme et du marxisme
à l’effondrement de l’ambition d’un projet critique.
En 1969, le PCF fait encore 25 % des voix, et connaît même un renouveau grâce au programme commun avec le PS en 1972. Certains, qui avaient rendu leur carte en 1956, reprennent du service, et de nombreux artistes parmi eux. La glaciation brejnévienne et la répression du Printemps de Prague trouvent cependant écho en France chez les intellectuels et les artistes, où la figure du dissident tend à succéder dans l’imaginaire collectif à celle du militant. C’est surtout avec la publication de la version française de l’immense fresque de Soljenitsyne sur le système concentrationnaire en URSS de 1918 à 1956, Archipel du Goulag, et la découverte que les populations fuient les régimes communistes que les intellectuels et artistes français soutenaient, que la critique prend corps massivement 133 , y compris au sein des PC eux-mêmes, au point que les maisons d'éditions militantes publient alors des ouvrages très critiques sur l'URSS. 134 La prise de conscience de ces événements amplifie le processus de défiance à l’égard des organisations politiques, y compris de celles qui se prétendent vouées à la cause du peuple, et accroît la valorisation corollaire de l’individu contre le système. Et les événements politiques comme les théoriciens des années 1980 vont amplifier ce mouvement de sape des principes universalistes et de l’idéal des Lumières.
Notes
133.
André Glucksmann, La Cuisinière et le mangeur d’homme. Essai sur l’état, le marxisme, les camps de concentration, Paris, Seuil, 1975.
134.
Tel l'ouvrage de Jean Radvanyi, Le géant aux paradoxes, Éditions Sociales, 1982.
Partie I. Chapitre 1. 2.
Les années 1980 :
post-modernisme, fin du projet critique et dépolitisation de la société
a. Le postmodernisme, rupture avec la pensée moderne héritée des Lumières
Le terme postmoderne est mis à l’honneur en France par Jean-François Lyotard en 1979, dans un ouvrage qui s’intéresse à la « condition postmoderne » 135 à partir de la définition qu’en donnent les sociologues et critiques américains :
« Le mot [ postmoderne] est en usage sur le continent américain, sous la plume de sociologues et de critiques.
Il désigne l’état de la culture après les transformations qui ont affecté les règles des jeux de la science, de la littérature et des arts à partir de la fin du XIXe siècle. » 136
Notes
135.
Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979.
136.
Ibid, p. 7.
Partie I. Chapitre 1. 2. a. i.
Le prolongement de la science moderne
L’origine de la condition postmoderne est donc relativement ancienne, et par ailleurs le terme est d’emblée corrélé à une transformation de la culture. J.-F. Lyotard s’intéresse lui spécifiquement à « la condition du savoir dans les sociétés les plus développées » 137 ,
et articule donc le constat de la transformation des connaissances à la « crise des récits » 138 :
« La science est d’origine en conflit avec les récits. A l’aune de ses propres critères, la plupart de ceux-ci se révèlent des fables. » 139
Mais si la science se démarque par définition des fables, elle s’est fondée sur ses propres récits, qui servent à « légitimer les règles du jeu. C’est alors qu’elle tient sur son propre statut un discours de légitimation, qui s’est appelé philosophie. » 140
Et l’on appelait « moderne » le monde dans lequel le métadiscours global de la science constitué par l’ensemble de récits que constituaient « la dialectique de l’Esprit, l’herméneutique du sens, l’émancipation du sujet raisonnable ou travailleur, le développement de la richesse », autrement dit « le récit des Lumières, où le héros du savoir travaille à une bonne fin éthico-politique, la paix universelle. […] En légitimant le savoir par un métarécit, qui implique une philosophie de l’histoire, on est conduit à se questionner sur la validité des institutions qui régissent le lien social : elles demandent aussi à être légitimées. La justice se trouve ainsi référée au grand récit, au même titre que la vérité. » 141
La pensée postmoderne se situe donc dans la lignée de la critique des Lumières faite par l’Ecole de Francfort, et dans la critique de « la philosophie de Hegel [qui] totalise tous ces récits, et en ce sens […] concentre en elle la modernité spéculative. » 142
Mais la pensée postmoderne radicalise la critique, du fait d’un pessimisme anthropologique.
Notes
137.
Idem.
138.
Idem.
139.
Idem.
140.
Idem.
141.
Idem.
142.
Jean-François Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, Correspondance 1982-1985, (1988), Paris, Galilée, 2005, p. 36.
Partie I. Chapitre 1. 2. a. ii.
Fin des métarécits modernes,
de toute pensée systémique, du sujet rationnel et de l’histoire.
‘« Le projet moderne (de réalisation de l’universalité) n’a pas été abandonné, oublié, mais détruit, "liquidé."
Il y a plusieurs modes de destruction, plusieurs noms qui en sont les symboles. "Auschwitz" peut être pris comme un nom paradigmatique pour « l’inachèvement » tragique de la modernité. […]
A "Auschwitz", on a détruit un souverain moderne :
tout un peuple.
On a essayé de le détruire.
C’est le crime qui ouvre la postmodernité,
crime de lèse-souveraineté,
non plus de régicide, mais de populicide […]. » 143 ’
La référence à Auschwitz réapparaît dans le monde postmoderne
de manière dés-historicisée et conceptualisée, pour devenir la preuve
de la vacuité de tout projet émancipateur et de toute conception télé
ologique de l’histoire orientée vers un progrès, parce qu’Auschwitz
constitue la preuve même de l’irrationalité du sujet et de la société.
L’effondrement sur le plan individuel de la conception d’un sujet rationnel fait écho à l’effondrement de la possibilité d’une conscience collective et d’une progression de l’histoire vers un monde meilleur.
Cette sortie du cadre de la philosophie de l’histoire va être fortement relayée. Paraît en 1989 un article de Francis Fukuyama, dont le titre « La fin de l’histoire » 144
contient une formule qui va marquer les esprits et sera bientôt étoffée
dans son ouvrage La fin de l’histoire ou le dernier homme, qui articule
précisément le changement de conception de l’histoire et la fin d’une certaine définition de l’humanité.
L’histoire qui s’achève, la définition de l’histoire qui est invalidée, c’est
en réalité la conception marxo-hégélienne d’une histoire téléologique
fondée sur la notion non seulement de progrès technologique mais
de progrès de l’humanité.
Notes
143.
Ibid,, pp. 36-37.
144.
Francis Fukuyama, « The end of History », National Interest, summer 1989. Traduction intégrale en Français, Revue Commentaire, n° 47, Automne 1989.
Partie I. Chapitre 1. 2. a. iii.
La fin de tout projet critique.
La période post-moderne,
c’est « l’incrédulité à l’égard des méta-récits » 145 des Lumières
que sont la philosophie de l’histoire, de l’idée de vérité et de justice.
Mais c’est aussi la fin de tout méta-récit, marxisme et néo-marxisme compris, la fin de tous les discours à fonction légitimante :
‘« Nul ne parle toutes ces langues, elles n'ont pas de métalangue universelle. Le projet du système-sujet est un échec, celui de l'émancipation n'a rien à faire avec la science, on est plongé dans le positivisme de telle ou telle connaissance particulière, les savants sont devenus des scientifiques, les tâches de recherche démultipliées sont devenues des tâches parcellaires que nul ne domine. » 146 ’
La pensée postmoderne va donc plus loin que l’école de Francfort puisqu’elle remet en cause non seulement les modèles critiques passés mais la possibilité même d’un projet critique :
‘« Certes, le modèle critique s’est maintenu et s’est [même] raffiné en face de ce processus, dans des minorités comme l’Ecole de Francfort ou comme le groupe Socialisme et Barbarie. 147
Mais on ne peut cacher que l’assise sociale du principe de la division, de la lutte des classes, venant à s’estomper au point de perdre toute radicalité, il s’est trouvé finalement exposé au péril de perdre son assiette théorique et de se réduire à une "utopie", à une "espérance" 148 ,
à une protestation pour l’honneur, levée au nom de l’homme, ou de la raison, ou de la créativité, ou encore de telle catégorie sociale affectée in extremis aux fonctions désormais improbables de sujet critique, comme le tiers-monde, ou la jeunesse étudiante. » 149 ’
A l’universalisme des Lumières s’oppose désormais ce que J. A. Amato nommera « l’universalisme du génocide » 150 et de ses victimes, innombrables, et inclassables, avec le risque de plus en plus avéré que l’indignation, fondée sur l’espoir d’une action qui aide les victimes et change le cours de l’histoire, ne cède la place à « l’indifférence et à l’apathie. » 151
Notes
145.
J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, op. cit., p. 67.
146.
Idem.
147.
C’est le titre que portait « l’organe de critique et d’orientation révolutionnaire » publié de 1949 à 1965 par un groupe dont les principaux rédacteurs (sous divers pseudonymes) furent C. de Beaumont, D. Blanchard, C. Castoriadis, S. de Diesbach, Cl. Lefort, J.-F. Lyotard, A. Maso, D. Mothé, B. Sarrel, P. Simon, P. Souyri.
148.
E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung (1954-1959), Francfort, 1967. Voir G. Raulet éd., Utopie-marxisme selon E. Bloch, Paris, Payot, 1976.
149.
J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, op. cit., p. 28.
150.
Joseph Amato, Victims and Values, New York, Praeger, 1990, pp. 175-201.
151.
Ibid, p. 200. Citation extraite de Luc Boltanski, La Souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique, Paris, Métailié, 1993, p. 244.
Partie I. Chapitre 1. 2. a. iv.
Fin de l’alternative moderne sur la nature du lien social.
Ni État-nation
ni lutte des classes
Pour J.-F. Lyotard, les connaissances se sont transformées sous l’influence des transformations technologiques et de la commercialisation des savoirs.
Et la transformation de la nature du savoir et de la circulation des capitaux conduit J.-F. Lyotard au constat d’une perte d’influence du cadre de l’Etat-Nation par rapport aux entreprises multinationales.
Dans un contexte de déclin de l’alternative socialiste mais aussi de fin de l’hégémonie du capitalisme américain 152 ,
la condition postmoderne est donc celle d’une redéfinition des rapports entre l’Etat-Nation, les multinationales et la société civile en général,
la classe dirigeante étant composée :
non plus des « anciens pôles d’attraction formés par les Etats-Nations, les partis, les professions, les institutions et les traditions historiques » 153 ,
mais par « une couche composite formée de chefs d’entreprise, de hauts fonctionnaires, de dirigeants des grands organismes professionnels, syndicaux, politiques, confessionnels. » 154
La place de l’espace public se trouve donc modifiée,
rétrécie par l’effritement du cadre de l’Etat-Nation,
augmentée par l’émergence de la société civile.
Mais il n’y a plus de consensus collectif sur les fins de la société.
La détermination du « but de vie » est « laissé[e] à la diligence de chacun. Chacun est renvoyé à soi. Et chacun sait que soi est peu. 155 » 156
La condition postmoderne se marque donc plus globalement par une rupture de l’alternative moderne entre deux conceptions de la nature du lien social :
« la société forme un tout fonctionnel,
la société est divisée en deux » 157,
autrement dit de :
l’alternative entre l’Etat-nourricier et la dictature du prolétariat,
l’alternative entre le modèle marxiste de lutte des classes et le modèle républicain.
Auschwitz n’est donc pas le seul mode de destruction du projet moderne, et, sous couvert de le réaliser, « la technoscience capitaliste » entérine la rupture avec tout projet de liberté ou de justice sociale articulé autour d’un idéal émancipateur, de tout projet politique de société, et « n’accomplit donc pas le projet de réalisation de l’universalité, mais au contraire […] accélère le processus de [sa] délégitimation. » 158
Notes
152.
J.-F. Lyotard a pressenti la multipolarisation du monde.
La Condition postmoderne, op. cit., p. 16.
153.
Ibid, p. 30.
154.
Idem.
155.
C’est un thème central de R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (1930-1933), Hambourg, Rowohlt, traduction française Jaccottet, L’homme sans qualités, Seuil, 1957.
Dans un commentaire libre, J. Bouveresse souligne l’affinité de ce thème de la « déréliction » du Soi avec la « crise » des sciences au début du XXe siècle et avec l’épistémologie de E. Mach ; il en cite les témoignages suivants :
« Étant donné en particulier l’état de la science, un homme n’est fait que de ce que l’on dit qu’il est ou de ce qu’on fait avec ce qu’il est […]. C’est un monde dans lequel les événements vécus se sont rendus indépendants de l’homme […] C’est un monde de l’advenir, le monde de ce qui arrive sans que ça arrive à personne, et sans que personne soit responsable. »
(La problématique du sujet dans L’homme sans qualités », Noroît (Arras) 234 et 235 (décembre 1978-janvier 1979) ; le texte publié n’a pas été revu par l’auteur.) »
Note de Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, op. cit., p. 31.
156.
Idem.
157.
Ibid, p. 24.
158.
Jean-François Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants, op. cit., p. 37.
Partie I. Chapitre 1. 2. a. v.
Un monde postpolitique ou une interprétation postmoderne du monde?
Le monde postmoderne peut être défini comme un monde post-politique, post-rationnel, post-collectif,
et post-humaniste,
fondé sur une sortie du cadre de la Modernité née au siècle des Lumières.
Plus que la simple description d’un état du monde, le postmodernisme est une idéologie, une grille d’interprétation du monde, fondée sur un triple rejet de l’interprétation moderne du monde :
‘« Rejet des macro-perspectives totalisantes sur la société et l’histoire, au profit de la micro-théorie et de la micro-politique, rejet également de la supposition d’une cohérence sociale et plus généralement des concepts d’universalité et de causalité au profit de la multiplicité, de la fragmentation, de la pluralité et de l’indétermination, et enfin rejet du sujet rationnel et unifié au profit d’un sujet socialement et linguistiquement décentré et fragmenté. » 159 ’
Le post-modernisme peut en définitive se définir comme la fin des grands récits et singulièrement des concepts-mythes qu’étaient la Nation, le marxisme – la lutte des classes – et le progrès des sociétés industrielles.
Le postmodernisme c’est en quelque sorte l’invalidation des Lumières par le marxisme doublée de l’invalidation du marxisme lui-même, toujours victime – ou toujours coupable – de « récupération » 160 , soit par le capitalisme soit par le totalitarisme.
Le communisme réel a montré qu'un bel idéal pouvait aboutir aux mêmes horreurs que le nazisme, ou, pour le dire avec Hannah Arendt, il a démontré tout le mal que l'on peut faire non seulement au nom du mal, mais au nom du bien. Cet effondrement se manifeste concrètement dans une dépolitisation de la société et une transformation radicale du rapport au politique.
Notes
159.
Steven Best et Douglas Kellner, Postmodern theory : Critical interrogation. Bastingstoke, Palgrave Macmillan, 1991, pp. 4-5. Traduction par nous-même.
160.
Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, op. cit., p. 29.
Partie I. Chapitre 1. 2. b.
Une transformation en profondeur du rapport au politique
Pour reprendre une formule de François Cusset, l’on peut considérer que « la mort des idéologies est l’idéologie des années 80. » 161
Les années Mitterrand ne sont pas simplement celles où l’espoir suscité par l’arrivée de la gauche au pouvoir cède la place à la déception, ce sont les années de la fin de la croyance dans la politique, les années d’une dépolitisation des individus, et notamment des artistes de théâtre.
Notes
161.
François Cusset, Propos recueillis par Eric Aeschimann, à propos de son ouvrage La Décennie : le grand cauchemar des années 80, La Découverte, 2006. Libération, samedi 4 novembre 2006.
Partie I. Chapitre1. 1. 2. b. i.
Définition du terme « dépolitisation »
Dans la mesure où tous les sujets sont potentiellement politisables, on peut définir la dépolitisation par le fait qu'un locuteur ayant à sa disposition des instruments de politisation préfère ne pas politiser une situation.
Il s'agit donc d'une démarche consciente et volontaire d’évitement du politique.
Les explications de ce comportement invoquées par les observateurs sont nombreuses et pour partie fonction de leur position sur l'échiquier politique, mais un certain nombre de facteurs semblent indiscutables, historiques mais aussi liés à des choix politiques, certains liés à l'évolution de la sphère politique, d'autres à celle parallèle de la société civile – sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude laquelle prime et induit l'autre.
Partie I. Chapitre 1. 2. b. ii.
L'évolution des « corps intermédiaires » et
le processus de « professionnalisation de la politique » 162 :
Dès la fin des années 1970 l'on assiste en France à l'affaiblissement des « corps intermédiaires » (Durkheim), partis, syndicats, et organisations « qui autrefois structuraient le corps social et le politisaient, jouant comme autant d’instances de regroupement et de médiation, et bien sûr de cristallisation des luttes. » 163
Les structures traditionnelles de militance sont ébranlées dès le début de notre période, et le phénomène se prolonge aujourd'hui malgré une relative refonte d'une partie des organisations traditionnelles au sein de la nébuleuse altermondialiste. 164
Ainsi un sondage de Libération en février 2006 révèle que moins de 10 % du personnel des entreprises est désormais syndiqué.
Le monde du travail fonctionne de moins en moins comme espace-temps de politisation pour les travailleurs, ce qui s'explique également par le nombre croissant de chômeurs qui perdent le lien avec leur ancienne attache syndicale en même temps que leur emploi, et la désertion des partis et syndicats modifie la structure des luttes et leur efficacité.
Parallèlement, la constitution d’une classe de « fonctionnaires » qualifiés, gravitant dans l’orbite d’hommes politiques professionnels, aboutit pour les hommes politiques à une conception de la politique pensée sur le mode de l’administration de l’entreprise privée, gérée par des spécialistes.
Et pour les citoyens s'accroît l'impression d'une sphère politique quasi autonome, hermétique – incompréhensible et totalement étrangère.
Notes
162.
Max Weber, Le savant et le politique, 10/18, UGE, Paris, 1982.
163.
Marine Bachelot, Pratiques et mutation du théâtre d’intervention aujourd’hui en France, Belgique et Italie, Mémoire de DEA sous la direction de Didier Plassard, Rennes 2, 2002, p. 27.
164.
Pour des développements sur ce sujet on pourra lire notamment les travaux de Sophie Béroult sur la CGT.
Partie I. Chapitre 1. 2. b. iii.
Un aplanissement de l’opposition idéologique des partis
de droite et de gauche ?
Le mouvement de professionnalisation de cette classe politique la rend d’autant plus homogène dans son hétérogénéité avec la société civile que le clivage gauche / droite tend à s’estomper entre les grands partis de chaque bord.
Cette autre caractéristique de l’évolution politique de ces vingt dernières années a occasionné la soumission de plus en plus grande du pouvoir politique à l’économie érigée en nouvelle Raison guidant le monde.
En France, pays où l’opposition historique droite/gauche était très structurante, il s'agit d'un bouleversement profond, avec l'apparition d'un discours du consensus qui semble invalider toute remise en cause radicale des orientations, entendues désormais moins comme des options politiques que comme des évolutions inéluctables et quasi naturelles. 165
Si le fait que l'unique parti de gauche au pouvoir sur la période est clivé en son sein et ne fonctionne donc plus comme une entité polarisée a pu un certain temps fausser l'impression générale, le clivage gauche / droite s'efface en fait moins qu'il ne se complexifie, le parti socialiste ne fonctionnant plus unilatéralement comme parti de gauche, ses dirigeants s'approchant plus des démocrates américains que de l'illustre ancêtre de la SFIO Jean Jaurès :
‘« [Ces années 1980 ] ont été marquées par " la fin sans fin " du politique, une tentative impossible pour y mettre fin, notamment en dépolitisant l’idée de changement.
Avant, le changement était un concept politique, lié à un projet, une volonté, une force critique.
Les années 1980 inaugurent la « naturalisation » du changement :
un certain discours idéologique lui donne la forme d’un phénomène mécanique, inexorable, sorte de fatalisme incapacitant. » 166 ’
Ce constat doit en réalité être nuancé parce que, s’il est incontestable pour la décennie 1980, la situation évolue au cours de la période qui nous occupe, et notamment depuis le début du XXIe siècle, le référendum sur la Constitution Européenne ou l’élection présidentielle de 2007 venant raviver à la fois l’intérêt des citoyens pour la chose politique et leur appréhension clivée de l’échiquier politique.
Mais nous verrons que cette évolution ne transparaît que de manière marginale dans les discours comme dans l’œuvre des artistes de la cité du théâtre postpolitique.
Notes
165.
« Le sentiment s’est fait jour, dans les cercles officiels de la politique, que sur un certain nombre de questions importantes il n’y avait pas de réelle différence entre les positions de la droite et de la gauche. »
L'objet du consensus est « l’existence d’un lien nécessaire entre économie de marché et démocratie représentative », in Marc Augé, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Champs Flammarion, Paris, 1994, p 32.
166.
François Cusset, « La mort des idéologies est l’idéologie des années 1980 », propos recueillis par Eric Aeschimann, Libération, 04 novembre 2006.
Partie I. Chapitre 1. 2. b. iv.
La fin de la politique comme fin du politique ?
Pour J. Rancière, l'un des plus fins observateurs critiques de la fin de la politique, cette dernière découle de la fin d'un rapport optimiste au temps (la fin de la promesse) qui lui-même est le fruit d'un certain désenchantement du monde et partant du monde politique 167 ,
autremement dit le fruit d’une conception désenchantée de la politique comme le serait notre monde contemporain. 168
Pour J. Rancière cette conception de la politique vidée de toute inscription temporelle et optimiste dans l'avenir provient d'une lecture erronée du passé, qui voudrait que le processus de révolution soit achevé, laissant place à « un temps homogène, dans une temporalité délestée de la double royauté du passé et du futur. » 169
Nous reviendrons sur cette contestation par J. Rancière de la fin – achèvement et impossibilité – de la politique comme révolution, car son point de vue éclaire la compréhension d’un théâtre contemporain de lutte politique. Pour l’heure nous insisterons sur le constat qu’il fait de la conception du politique et qui, bien qu’erronée à ses yeux, prévaut à l’heure actuelle. C’est ce même constat que livre Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po Paris et directeur du Centre de recherche sur la vie politique française (CEVIPOF), quand il estime que « les politiques doivent faire le deuil de la politique révolutionnaire, de cette religion séculaire qui a sévi jusqu’au début des années 80, celle qui disait aux citoyens : "Nous allons changer votre vie. "» 170
La fin de la politique fondée sur la promesse équivaut parallèlement à la fin d'une politique fondée sur le conflit et notamment sur la polarisation gauche/droite du paysage politique français. On trouve chez Jacques Rancière l’idée théorisée par Marc Augé selon laquelle la France, pays pourtant fortement marqué par le clivage gauche/droite depuis deux siècles, fait depuis les années 1980 l’apprentissage d’un discours du consensus « à partir du moment où le sentiment s’est fait jour, dans les cercles officiels de la politique, que sur un certain nombre de questions importantes il n’y avait pas de réelle différence entre les positions de la droite et de la gauche. » 171
L’âge post-moderne peut ainsi se définir comme celui de la fin des fins, fin des méta-récits, fin d’une conception téléologique de l’Histoire, fin d’une définition de l’homme comme sujet en voie d’émancipation héritée des Lumières. Nous avons eu l’occasion de développer les conséquences de l’origine historique de l’effondrement de cette conception de l’histoire qu’est la Deuxième Guerre Mondiale et d’aborder le second coup, fatal, porté par l’effondrement du bloc soviétique. La chute du communisme n’a pas simplement détruit un système politique concret, elle est venue achever l’implosion de la conception de l’homme, de l’histoire et de la politique, comme le précise Myriam Revault d’Allonnes à partir du même constat d’une fin de la promesse qu’évoquait J. Rancière :
‘« La chute du communisme n’a pas seulement vu s’effondrer un système de domination : système caractérisé par une idéologie d’Etat visant à un certain accomplissement de l’humanité. Elle a aussi accéléré la perte ou le vide de sens. Comme l’écrit Emmanuel Lévinas, nous avons aujourd’hui "vu disparaître l’horizon qui nous apparaissait, derrière le communisme, d’une espérance, d’une promesse de délivrance. Le temps promettait quelque chose. Avec l’effondrement du système soviétique, le trouble atteint des catégories très profondes de la conscience européenne." La chute du communisme s’est accompagnée non seulement d’un effondrement du mythe révolutionnaire, mais d’un ébranlement très profond des catégories de pensée qui soutenaient la réflexion politique. Car la disparition de cet horizon d’espérance fait advenir un temps sans promesses. Elle prive l’idée d’émancipation de ses repères messianiques. » 172 ’
Notes
167.
Jacques Rancière, Aux bords du politique, op. cit., pp. 23-24.
168.
Ibid, p. 25.
169.
Idem.
170.
Pascal Perrineau, Le Nouvel Observateur, 6 juin 2002.
171.
Marc Augé, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Champs Flammarion, Paris, 1994, p. 32.
172.
Myriam Revault d’Allonnes, Le dépérissement de la politique – Généalogie d’un lieu-commun, Champs Flammarion, Paris, 1999, p. 208. Cité par Marine Bachelot, op. cit., p. 24.
Partie I. Chapitre 1. 2. b. v.
Bilan : La fin de la promesse
La référence à la Shoah avait d’abord donné lieu à un renforcement du projet critique marxiste, destiné à combattre le « plus jamais ça. »
Mais la découverte de la banalité du mal et de ce que l’homme peut faire à l’homme vont prendre un sens nouveau en fonction de l’évolution du statut du projet marxiste, reformulé par l’Ecole de Francfort, puis remis en question, à mesure que le communiste réel révèle ses décalages voire ses sanglantes oppositions à l’idéal qu’il était censé servir.
Le génocide, de plus en plus interprété de manière déshistoricisée, va tendre alors progressivement tendre à fonder un pessimisme anthropologique radical, qui suppose une remise en cause radicale de l’idéologie des Lumières.
L’idée d’une orientation de l’histoire vers un progrès de l’humanité est invalidée, de même que sont plus ou moins évacués du discours public les grands actants politiques sociaux de l’histoire, l’Etat-Nation et les classes en luttes.
Dans le même temps, le mouvement de professionnalisation de la politique et l’effondrement des corps intermédiaires renforcent le processus de dépolitisation de la société.
Quelles sont les conséquences de ce changement d’ère idéologique – dépolitisation, effondrement du projet critique – dans la définition de la culture, de l’art et du théâtre ?
|
|
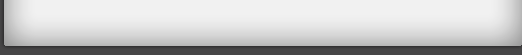 |
|