Partie I. Chapitre 4.
Un théâtre-expression
d’un monde contradictoire et violent
La perte des grands repères politiques n’a pas suscité que le repli sur la sphère esthétique. Tout un pan du théâtre maintient fortement la référence au « réel » et, à travers cette formule, la filiation avec les « théâtres réels » que constituaient selon Bernard Dort les dramaturgies épiques.
Mais avec un changement de taille :
il s’agit non plus de représenter un monde clivé mais d’exprimer un monde éclaté, contradictoire et violent.
Il n’est plus question de tenter de saisir la réalité en mettant en relation la petite histoire et les destins individuels avec le cours de la grande Histoire pour mieux changer cette dernière, mais d’exprimer un monde chaotique et violent.
Le théâtre prend pour référent le monde réel et s’en veut la représentation, mais le terme renvoie à la Darstellung – « présentation, qui désigne la mise en présence de la chose même » 300 –
et non plus à la Vorstellung, l’« action psychique de rendre présent à l’esprit. » 301
Il s’agit de donner à voir le monde réel dans son aspect chaotique, violent, contradictoire, voire de théoriser l’impossibilité d’un regard cohérent et distancié sur le monde. Et s’il est encore question de représenter un monde, de le donner à voir avec un point de vue synthétique et englobant, (Vorstellung), alors il s’agit non plus du monde réel mais d’un monde post-apocalyptique qui n’existe pas, qui ne s’inscrit dans aucune continuité historique, car fruit d’une rupture inaugurale, dans un théâtre qui interroge le sens de l’humain.
Les fondements communs à ces différentes options esthétiques et philosophiques résident dans l’effet cumulé des différents concepts que nous avons déjà évoqués : L’idée d’une condition postmoderne comme sortie du cadre moderne hérité des Lumières – fin de la croyance dans la raison et dans le progrès – assortie d’une pensée de la fin de l’histoire et d’un pessimisme anthropologique, hérité de la référence à Auschwitz, comme fondation inaugurale du monde contemporain. Mais une autre théorie permet de saisir les fondations de ce théâtre, celle du « choc des civilisations », formulée pour la première fois en 1964 302 ,
et remise à l’ordre du jour par Samuel Huntington dès 1996 303
et développée dans The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, ouvrage paru en 1998. 304
L’impression d’une fin de l’histoire, au sens d’une disparition des grands conflits idéologiques, est contredite par l’évolution de l’équilibre géopolitique du monde depuis 1989, preuve que des événements continuent d’avoir lieu, qui s’inscrivent dans le cours d’une histoire en train de se faire. Cette théorie est d’emblée liée à des enjeux politiques. Bernard Lewis était proche des conservateurs, et S. Huntington de l’équipe du président Carter. La théorie du Choc des Civilisations a permis de légitimer la politique américaine au Proche Orient et la stratégie israélienne. 305
Elle permet il est vrai de prendre en compte et de comprendre un certain nombre des événements qui sont venus bouleverser l’équilibre géopolitique mondial depuis la Chute du Mur, et est devenue une référence obligée depuis le 11 septembre 2001.
Il y a donc dans cette théorie une volonté de comprendre « le nouvel ordre mondial. » Mais l’interprétation rapide et l’utilisation courante qui en est faite peut contribuer à peindre le tableau d’un monde chaotique et violent. Le terrorisme constitue un ennemi sans visages, et le fait que les Etats ne soient plus les figures de proue – apparentes du moins – des conflits contribue à rendre invisibles et incompréhensibles les logiques d’affrontement politique ainsi le rapport de cause/ conséquence dans l’enchaînement des événements internationaux et nationaux. Mais théoriser le choc des civilisations, c’est aussi prétendre constater une impossibilité à vivre ensemble à l’échelle internationale et nationale (du fait de l’existence d’une population immigrée 306 ),
et la référer à des invariants d’ordre non pas politique mais culturels et religieux, l’opposition morale (voir la notion d’axe du mal utilisée par G.W. Bush pour justifier la seconde guerre en Irak) étant sous-tendue par un principe de hiérarchisation entre les civilisations. Nous souhaitons voir en quelle mesure cette théorie informe également la compréhension des tensions et ambitions à l’œuvre aujourd’hui en France chez un certain nombre d’artistes de théâtre (auteurs et metteurs en scène). Nous allons voir que certains choix esthétiques caractéristiques de ce théâtre – notamment la remise en cause des notions de personnage et de la fable organique – va de pair avec la remise en cause d’une conception téléologique de l’histoire et d’une fois dans la possibilité de changement politique. Ce théâtre se définit comme dépassement et invalidation des formes de théâtre politique antérieures et, s’ils ne semblent pas vouloir, consciemment du moins, contribuer à façonner le nouvel ordre mondial, force est de constater que la représentation d’un monde contradictoire et incompréhensible par ces artistes peut contribuer à invalider tout projet visant à changer cet ordre du monde.
Notes
300.
Maryvonne Saison, op. cit., p. 11.
301.
Idem.
302.
Bernard Lewis, The Middle East and the West, Indiana University Press, Bloomington, 1964, p. 135.
303.
Samuel Huntington, « The Clash of Civilizations ? », revue Foreign Affairs, summer 1993.
304.
Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order Simon & Schuster, 1st Touchstone Ed., 1998.
305.
Alain Gresh, « A l’origine d’un concept. Le choc des civilisations », Le Monde Diplomatique, septembre 2004.
306.
« Quand, en décembre 2003, à Tunis, le président Jacques Chirac parle d’« agression », à propos du foulard, la journaliste Elisabeth Schemla s’en réjouit : « Pour la première fois, Jacques Chirac reconnaît que la France n’est pas épargnée par le choc des civilisations. » Alain Gresh, idem.
Partie I. Chapitre 4. 1.
Exprimer l’incohérence
et le chaos du monde contemporain.
L’effondrement du bloc communiste en 1989 peut être appréhendé comme le catalyseur de la cité du théâtre postpolitique, car la position de nombre d’artistes de théâtre contemporain s’explique en grande partie par leur rapport distancié non seulement à l’idéal révolutionnaire mais à l’engagement politique, et passe par une absence ou un rejet de la référence au modèle aristotélicien comme à celui d’un théâtre épique soucieux de donner du monde une lecture critique dialectique ou systémique, tentative vouée à l’échec puisque le monde est incompréhensible.
Partie I. Chapitre 4. 1. a.
Le télescopage
dramatique et historique :
La Mission. Au Perroquet vert.(Schnitzler-Müller/M. Langhoff).
En 1989, alors que les festivités organisées dans le cadre de l’année du Bicentenaire de la Révolution battent leur plein 307 ,
le festival d’Avignon, qui fait la part belle pour cette édition aux tragiques grecs et au travail poétique de Valère Novarina 308 ,
refuse de céder totalement à la vague commémorative, et moins encore aux sirènes de la célébration de la Révolution – seule une rencontre y fait explicitement référence.
Mais, au sein de la programmation théâtrale, La Mission-Au perroquet Vert, montage des textes de Müller et Schnitzler par Matthias Langhoff, va marquer les esprits.
Or ce spectacle interroge non pas la Révolution Française mais la nature même de la Révolution, par la confrontation entre le concept idéal et les expériences historiques qu’il recouvre, ce qui induit un bouleversement du rapport non seulement à la Révolution mais à l’Histoire, au temps, et au drame.
Notes
307.
Voir partie II, chapitre 2, 1. a.
308.
Source : Claire David (sous la direction de), Avignon, cinquante festivals, Arles, Éditions locales de France/Actes Sud, 1997, p. 341.
Partie I. Chapitre 4. 1. a. i.
Matthias Langhoff, témoin du temps.
Le metteur en scène Matthias Langhoff incarne en lui-même, par son histoire personnelle, les bouleversements de l’histoire politique et théâtrale de la seconde moitié du XXe siècle. Fils d’un collaborateur de Brecht, entré au Berliner Ensemble en 1961, soit l’année de la construction du Mur de Berlin 309 ,
le metteur en scène allemand a dans sa jeunesse fait preuve d’une même adhésion – « sectaire » 310
selon ses propres termes – au socialisme et au brechtisme :
‘« - A cette époque là aussi bien [l]es œuvres [de Brecht] que sa manière de représenter les pièces étaient pour moi la seule vase pour un travail théâtral. Cet intérêt était assez exclusif puisqu’il s’accompagnait d’un terrible rejet de toute autre littérature. J’avais 18 ans et ça continuait d’être l’époque d’un grand bouleversement social. J’étais d’avis que dans ce bouleversement, seules des pièces comme celles de Brecht pouvaient avoir un impact.
- Ce bouleversement était pour toi la transformation de la société dans le sens du socialisme ?
- Exactement ! A cette époque, j’avais même des positions sectaires. Dans ma propre conscience, le monde était divisé entre ciel et terre, et le ciel était un domaine particulier, territorialement délimité !
- C’était la RDA ?
- Oui, c’était la RDA, ou disons, le camp socialiste, qu’on pouvait connaître concrètement ici sous les espèces de la RDA. » 311 ’
Et c’est du double fait de la décomposition de l’idéal socialiste en totalitarisme et de la fossilisation de la « méthode » 312
brechtienne en une doxa stérile, que M. Langhoff estime en 1977 que Brecht est « un auteur dépassé » 313 ,
et dépassé notamment par Müller, qui, après avoir beaucoup travaillé, non comme son élève, mais dans la même direction que lui, a pris une toute autre direction :
‘« Aujourd’hui, je crois Heiner Müller très éloigné de toute influence de Brecht. Je pense que Müller ne partage plus la croyance de Brecht à la possibilité de transformer le monde. […] Il considère le monde qui l’entoure beaucoup plus comme un matériau, et c’est là que réside la différence essentielle. Müller se sépare tout à fait de l’idée qu’il aurait à répondre à une question. Il est absolument d’avis que ce sont les lecteurs ou spectateurs qui doivent poser les questions. La vision du monde décrite par Müller est par conséquent fondamtentalement plus ouverte. Il est peut-être aussi plus facile d’en faire un mauvais usage. […] Ses pièces ne sont plus au service d’une doctrine ou d’une thèse. […] Qui n’eût préféré le monde tel que Brecht se le représentait ! Cet état de fait doit aussi trouver son reflet dans l’art. » 314 ’
Pour le metteur en scène, passé de Berlin-Est à Lausanne, même s’il précise que la RDA, dont il a conservé le passeport, « est [son] pays » 315
et que « [son] changement n’est pas une déclaration politique » 316 ,
Brecht n’est plus envisageable désormais que par le biais de sa relecture, sous forme de fragments, par Müller. 317
Et le spectacle qu’il donne au Festival d’Avignon en 1989 témoigne de cette esthétique de la mise à distance, le grand modèle marxo-brechtien d’un théâtre et d’un mouvement révolutionnaire se trouvant dynamité par un travail sur le montage, l’intertextualité et le fragment.
Notes
309.
Matthias Langhoff, entretien avec Bernard Dort, « S’il avait été possible de conserver au Berliner Ensemble sa forme initiale », in Bernard Dort et Jean-François Peyret, Bertolt Brecht, Paris, Cahier de l’Herne, n°35, vol. 1, 1977, p. 56.
310.
Ibid., p. 57.
311.
Ibid., pp. 57-58.
312.
Ibid., p. 58.
313.
Ibid., p. 63.
314.
Ibid., pp. 63-64.
315.
Matthias Langhoff, in Matthias Langhoff, entretien avec Georges Banu, Bernard Dort et Jean-Pierre Thibaudat, « Le théâtre, une activité concrète », Le théâtre, art du passé, art du présent, Art Press, numéro spécial, 1989, p. 148.
316.
Idem.
317.
Ibid., p. 66.
Partie I. Chapitre 4. 1. a. ii.
La Mission : Souvenir et dissection de la Révolution.
Le texte de Heiner Müller, écrit en 1979, constitue en lui-même un palimpseste littéraire et historique. Ecrite à partir d'une nouvelle d'Anna Seghers, la Lumière sur le gibet, La Mission, sous-titrée Souvenirs d’une révolution 318 ,
traite à sa manière de la période Révolutionnaire. La trame narrative se tisse autour de « l'envoi en Jamaïque de trois hommes chargés de soulever le peuple noir contre le joug britannique après que la Convention a voté à Paris, en 1794, l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies. » 319
Mais, du fait de la collision de différentes strates spatio-temporelles, Müller invalide la tentative d’exporter la révolution en Jamaïque par le rappel que la Révolution a rapidement été suivie, dans une succession qui paraît chrono-logique, de la contre-révolution. Et l’explication tient à la force de l’ennemi extérieur (Napoléon) mais aussi, et c’est là le fait essentiel, à la présence d’un ennemi intérieur, qui paraît en définitive constituer l’alpha et omega de toute révolution. Non seulement la mission des protagonistes, qui renvoie, au-delà de son contenu anecdotique, à la Révolution, n’est pas accomplie, mais elle paraît inaccessible, utopie que sa concrétisation défigure inéluctablement en son contraire aussi terrible qu’elle était grandiose.
Cette mise en crise de l’idéal révolutionnaire est étroitement corrélée à une mise en doute du rapport au temps, de toute vision globale du monde, et de toute action politique. Müller cherche sur les décombres du temps historique à créer un nouveau rapport au temps. A partir de la lettre du personnage de Galloudec à Antoine, qui fait figure de point de départ des relais énonciatifs, le texte procède par enchâssement des récits et des strates spatio-temporelles par le biais des dialogues, de celui entre Antoine, Marin et la femme, à celui entre Antoine et la femme-ange (pp. 9-13.) Puis l’instance énonciative se fait hésitante (pp. 13-14), avant de laisser la place, par le biais d’un flash-back, à un dialogue des personnages morts, quand ils étaient encore en Jamaïque. La construction narrative se double d’un jeu poétique sur la matière visuelle et sonore. Ainsi les lettres sont capitales comme l’est la leçon de leur combat révolutionnaire :
‘« LA REVOLUTION EST LE MASQUE DE LA MORT LA MORT EST LE MASQUE DE LA REVOLUTION LA REVOLUTION EST LA MORT LA MORT EST LE MASQUE DE LA REVOLUTION LA REVOLUTION EST LE MASQUE DE LA MORT LA MORT EST LE MASQUE DE LA REVOLUTION LA REVOLUTION EST LE MASQUE DE LA MORT LA MORT EST LE MASQUE DE LA REVOLUTION LA REVOLUTION EST LE MASQUE DE LA MORT LA MORT EST LE MASQUE DE LA REVOLUTION LA REVOLUTION EST LE MASQUE DE LA MORT LA MORT EST LE MASQUE » 320 ’
L’enchâssement des niveaux narratifs et dialogiques n’en finit pas d’épaissir le millefeuille historique et sémantique du temps. Sasportas devient « SasportasRobespierre » 321
et place « Galloudecdanton » 322
« au pilori de l’histoire » 323
tout en clamant que « [son] nom est écrit dans le Panthéon de l’histoire » 324 ,
juste avant une tirade dont l’énonciateur n’est pas explicite, et qui se situe dans un tout autre espace-temps. Müller paraît alors interroger les lois de la relativité en même temps qu’il exprime l’absurdité de toute quête d’un sens, dans une longue séquence moins brechtienne que kafkaïenne, située dans l’univers d’une dictature bureaucratique aux antipodes du dialogue précédent, le lien entre les séquences étant assuré explicitement par la mention d’une éventuelle « mission », et implicitement par le rapport temporel entre le temps de la lutte révolutionnaire et le temps du règne de la révolution. Coincé dans un « vieil ascenseur qui brinqueballe » mais ne le conduit pas assez vite vers l’étage de son « chef » - dont il ignore d’ailleurs l’emplacement exact, un homme, « entouré d’hommes qui [lui] sont inconnus » 325 ,
le regard vissé à sa montre, livre un combat contre le temps :
‘« Je suppose qu’il s’agit d’une mission qui doit m’être confiée. […] Le facteur temps est décisif. ETRE LA CINQ MINUTES AVANT L’HEURE / VOILA LA VRAIE PONCTUALITE. Quand j’ai regardé mon bracelet-montre la dernière fois, il indiquait dix heures. Je me souviens de mon sentiment de soulagement : encore quinze minutes jusqu’à mon rendez-vous avec le chef. Au regard suivant il y avait seulement cinq minutes de plus. Quand à présent, entre le huitième et le neuvième étage, je regarde à nouveau ma montre, […] plus question de vraie ponctualité, le temps ne travaille plus pour moi. Je fais rapidement le point de ma situation : je peux sortir au prochain arrêt et dégringoler l’escalier quatre à quatre jusqu’au quatrième étage. Si ce n’est pas le bon cela signifie bien sûr une perte de temps peut-être irrattrapable. Je peux aussi monter jusqu’au vingtième étage et, si le bureau du chef ne s’y trouve pas, redescendre au quatrième, à condition que l’ascenseur ne tombe pas en panne, ou bien dégringoler l’escalier (quatre à quatre) au risque de me casser une jambe ou le cou justement parce que je suis pressé. Je me vois déjà étendu sur une civière qu’à ma demande on transporterait dans le bureau du chef et déposerait devant lui, toujours désireux de servir mais désormais inapte. Pour le moment tout se ramène à cette question a priori sans réponse du fait de ma négligence, à quel étage le chef (qu’en pensée j’appelle Numéro Un) m’attend-il avec une mission importante. » 326 ’
Le caractère angoissant de l’auto-accusation et de la proliférante démultiplication des hypothèses qu’émet l’homme – réduit implicitement dans ses propres paroles au rang de subalterne – quant à son lieu de destination, aux différents scénarios possibles de son avenir et surtout à la nature de la mission, tient bien sûr à la menace d’une sanction arbitraire et disproportionnée que ces hypothèses exsudent. Mais l’angoisse et l’oppression que fait cette parole fait partager au spectateur provient également, de manière plus métaphysique que politique, à la collision non seulement des temps mais des modes temporels, le conditionnel, forcément instable, l’emportant largement sur le rassurant mode indicatif. Dans la pièce, cette instabilité du temps et cette incertitude quant à la mission de l’homme et donc à son utilité vont de pair avec une instabilité idéologique, et la position du marin, qui « ne croi[t] pas à la politique » et estime que « le monde est partout différent » paraît valoir comme commentaire surplombant de la pièce. 327
Et la crise politique est consubstantiellement dramatique pour Müller, qui estime que « la maladie du drame est certainement une maladie de la société, ou un reflet de la réorganisation du métabolisme de la société. » 328
Le rapport à l’histoire, à la trame narrative, découle du rapport à l’Histoire, objet essentiel de la dramaturgie de Müller. Dans le monde idéel, la révolution est la plus noble des causes, dans le monde empirique, « l’innocent finit toujours par avoir les mains sales » 329 .
Dès lors, l’objectif de Müller est de détruire la sacralité de la fable, de l’histoire théâtrale et de l’histoire, et de les déconstruire toutes ensemble du même mouvement :
‘« Ma première préoccupation, quand j’écris pour le théâtre, c’est de détruire les choses. Trente ans durant, Hamlet a constitué une obsession pour moi. Aussi ai-je tenté de le détruire en écrivant un texte bref, Hamlet-machine. L’histoire allemande a constitué une autre obsession, et j’ai tenté de détruire cette obsession, d’en détruire toutes les composantes. Ce qui me motive avant tout, c’est de dépecer les choses jusqu’à ce que je parvienne à leur squelette, je veux leur arracher la chair, anéantir leur surface. Après vous en avez fini avec elle. » 330 ’
Pour radicale et guerrière qu’elle puisse paraître, cette pulsion destructrice ne vise pas uniquement à « en finir avec » l’histoire mais aussi à mettre à nu sa structure profonde et cachée. « L’ennui avec l’histoire […] c’est qu’elle soit recouverte de chair, de peau, de surface. Traverser cette surface pour en arriver à la structure, voilà la motivation essentielle. » 331
La mise à distance de l’histoire et de la révolution ne conduit pour autant pas Müller à rejeter en bloc les ambitions au nom desquelles est mené le combat révolutionnaire, en RDA notamment. Müller salue ainsi le fait qu’ alors qu’« à l’époque de la tragédie grecque, la société était encore fondée sur la loi du clan » 332
et que « le pas à franchir du clan à la cité » 333 ,
à la "polis", indiquait la naissance d’une société de classe » 334 ,
« l’Allemagne de l’Est tend […] dans ses efforts à faire disparaître un tel type de société. » 335
Le texte de Müller est ainsi d’autant plus intéressant qu’il est écrit « depuis » la révolution pourrait-on dire, et par quelqu’un qui partage l’idéal révolutionnaire. Et cette position est vécue sur un mode paradoxal par l’auteur. Certes, ce regard de l’intérieur est forcément désabusé par le décalage entre l’idéal et la réalité de la vie dans un pays où le règne révolutionnaire est advenu. Mais il semble que les contraintes soient vécues non pas uniquement comme des désillusions et des oppressions, mais aussi comme une stimulation pour la création poétique. Müller insiste sur le fait qu’en RDA, parce que l’information est réprimée,
‘« la charge en expression [d’un texte] est bien plus violente et l’efficience des mots bien plus virulente qu’à l’Ouest. […] Ici les mots ne sont pas simples véhicules d’information, c’est de leur expression en fait que vous tirez l’information. C’est une situation avantageuse pour le langage théâtral. » 336 ’
Mais cet « avantage » pose également un problème de réception selon que le lecteur reçoit ou non le texte « depuis » le même lieu (le terme est à entendre au sens d’espace géographique, idéologique, et au sens de conditions d’existence) que celui d’où parle l’auteur :
‘« - Les gens saisissent-ils immédiatement à l’Est que vous écrivez sous la protection d’un masque ?
- Il ne leur est pas difficile de reconnaître, de voir ou de ressentir le silence entre les phrases. Ils savent ce qui se passe entre les mots. Ils mettent en jeu leur propre expérience. Ce n’est pas le cas des gens de l’Ouest. Pour eux cela n’est rien d’autre qu’un espace vide.
- Ainsi les gens sont-ils ici [à l’Est] bien plus impliqués qu’à l’Ouest dans l’acte de lecture. Ce serait là plutôt un problème d’esthétique. » 337 ’
La mise en scène de M. Langhoff répond à sa manière à ce défi de réception, par l’intrication du texte de Müller avec celui de Schnitzler, qui vient en radicaliser le sens.
Notes
318.
Heiner Müller, La Mission. Souvenir d’une révolution, in La Mission. Quartett, traduction Jean Jourdheuil et Heinz Schwrzinger, Paris, Minuit, 1982.
319.
Olivier Schmitt, « Les Folies Langhoff », Le Monde, 16 juillet 1989.
320.
Heiner Müller, La Mission, op. cit.., p. 18.
321.
Ibid., p. 22.
322.
Ibid., p. 23.
323.
Ibid., p. 22.
324.
Ibid., p. 24.
325.
Ibid., p. 25.
326.
Ibid., pp. 25-27.
327.
Ibid., p. 12.
328.
Heiner Müller, in Sylvère Lotringer, in entretien avec Heiner Müller, « Se débarrasser de l’histoire ? », TNS 84/85, Journal du Théâtre National de Strasbourg n°5, septembre 1984, p. 22.
329.
Idem.
330.
Ibid., p. 24.
331.
Idem.
332.
Ibid., p. 22.
333.
Idem.
334.
Idem.
335.
Idem.
336.
Idem.
337.
Ibid., p. 23.
Partie I. Chapitre 4. 1. a. iii.
Un spectacle à contre-courant de l’histoire.
Le spectacle, par la thématique des pièces comme par les éclairages, qui font miroiter sur le cloître des Carmes les couleurs du drapeau français, réfère directement à la Révolution. Mais le téléscopage des deux pièces, interprétées par la même distribution dans un décor unique démultiplie et radicalise les effets de sens de chacune d’elles. Dans un article qui s’ouvre sur le constat que « l’histoire est une impasse, au mieux un paradoxe, semblent dire aujourd’hui beaucoup de spectacles contemporains » 338 ,
Anne-Françoise Benhamou analyse le fait que La Mission s’ouvre sur Au perroquet vert, qui clôt le spectacle en terminant le cycle d’une conception de l’histoire vécue sur le mode de la promesse :
‘« Selon la manière dont on les met en scène, en accouplant La Mission et un texte de Schnitzler, Au perroquet vert, Langhoff accentue l’aspect " fin de siècle " (c’est-à-dire, pour le XXe, " fin des idéologies "), de la pièce de Müller. Car la petite comédie viennoise ne laisse aucune chance à l’ouverture historique qui s’esquisse à la fin de La Mission avec la dernière tirade de Sasportas, le Noir. […] Chez Langhoff, les aristocrates du Perroquet Vert sont les Noirs de la pièce précédente. […] Le spectacle est trop complexe pour que cela se laisse lire comme une pure réversibilité des opprimés et des oppresseurs. […] [Pourtant ] Au Perroquet Vert montre un théâtre qui, à sa plus grande stupéfaction, devient histoire ; ce qui produit une relecture de la pièce de Müller : l’histoire est peut-être devenue pur théâtre… Le temps historique est un simulacre ; du moins, tel que nous l’imaginons. […] Le spectacle de Langhoff barre toute hypothèse de restauration de l’histoire, ne serait-ce que parce que Schnitzler succède à Müller et non l’inverse. » 339 ’
En effet, la perspective entomologiste sur le fait révolutionnaire est encore plus poussée dans Au perroquet vert 340 ,
comédie burlesque et cynique qui « regarde la prise de la Bastille depuis un cabaret » 341 ,
dont le propriétaire est un ancien directeur de théâtre. Schnitzler, « sceptique-né » 342 ,
construit son texte autour de la mise à distance de la figure de Robespierre et à travers elle, il démultiplie les filtres afin d’isoler – de séparer pour les analyser et les éloigner – les concepts de Raison et de Vérité, mais aussi celui d’Histoire. Le tissage des deux textes est inextricable dans la mise en scène du fait du décor, qui constitue la véritable « machine à jouer » 343
du spectacle, comme l’a étudié Christine Hamon-Siréjols. La « suture » 344
entre les deux pièces n’est pas visible, parce que la transformation du plateau est accomplie non pas entre les pièces mais au sein de la première, accentuant le décalage temporel interne produit par la longue séquence de l’homme dans l’ascenseur précédemment évoquée. Sur le plateau « couleur de sang », la scénographe Katrin Brack a fondu l’espace non référencé, ou plus exactement multiréférencé, de Müller et celui, réaliste, de Schnitzler – qui représente « une cave » 345
– en un même décor, qui revisite les avant-gardes des années 1920 346 ,
Langhoff revendiquant la référence au « constructivis[me], à la manière des décors du théâtre révolutionnaire des années 1920 » 347 ,
qui « offrait beaucoup de possibilités. » 348
Cependant, malgré le clin d’œil revendiqué, le travail plastique sur la création d’un « rythme optique » 349
témoigne d’un autre rapport à l’espace, mais aussi au temps. La scène est découpée en différentes aires de jeu situées sur trois hauteurs, les passages se faisant par des marches intégrées aux planchers ou par des échelles. 350
Cette scénographie, complexifiée encore par les différents degrés de proximité, du proscenium à l’arrière-scène, et dont l’effet était en outre renforcé par le jeu des acteurs, ponctué de « continuelles ruptures de rythme qui "cassaient" en permanence la fluidité de la représentation » 351
avait pour but de donner à voir au spectateur une mise en perspective esthétique l’incitant à mener le même travail sur le plan sémantique :
‘« Suivant Müller dans sa volonté de faire rendre gorge à tous les mythes récupérés de la Révolution, Langhoff parvenait, avec les moyens propres à la mise en scène, à susciter chez le spectateur une disposition permanente à l’ironie et une forme de vigilance aiguë devant un spectacle dont les signes proliféraient avec une rapidité diabolique. Bien en vain, car aussitôt décryptés, ces signes semblaient perdre leur cohérence et ne plus offrir au public que les aléas du rêve. » 352 ’
Et le fait que le même dispositif scénique donne lieu dans la second partie du spectacle à un usage tout à fait différent, par le biais de son habillage avec des accessoires réalistes, mais aussi d’un « lieu fixe, homogène, clairement référencé » 353 ,
crée encore de la polysémie et de l’indécidabilité, la stabilité de la référence devenant elle-même la manifestation d’une instabilité générale de l’espace et du temps, de l’histoire et du sens. La Mission. Au Perroquet peut en définitive faire ainsi figure de spectacle augural de ce théâtre qui, parce qu’il se fonde sur un rapport désabusé au temps, à l’histoire et à la révolution, ne vise plus à interpréter le monde mais au contraire à en refléter le caractère chaotique. Et cette tendance va se confirmer, particulièrement sur la fin de notre période, l’année 2001 venant provoquer une nouvelle secousse sismique qui fait écho à celle produite par l’année 1989. 354
Notes
338.
Anne-Françoise Benhamou, « Les accordéons du temps », ibid., p. 6.
339.
Ibid., p. 10.
340.
Arthur Schnitzler, Au perroquet vert, traduction Marie-Louise Audiberti et Henri Christophe, Arles, Actes Sud Papiers, 1986, 1999.
341.
Armelle Héliot, « Théâtre de la Ville. La Mission. Au Perroquet vert, Heiner Müller / Arthur Schnitzler, A contre-courant de l’histoire », in Acteurs n°73-74, novembre-décembre 1989, p. 47.
342.
Olivier Schmitt, Le Monde, article déjà cité.
343.
Christine Hamon-Siréjols, « La Mission. Au perroquet vert : polyvalence et élasticité de l’espace », in Odette Aslan (sous la direction de), Langhoff, Les Voies de la création théâtrale, CNRS éditions, Collection Arts du Spectacle, Paris, 1994, pp. 235-246.
344.
Ibid., p. 236.
345.
A. Schnitzler, Au perroquet vert, op. cit., p. 5.
346.
Christine Hamon-Siréjols, op. cit., p. 235.
347.
Matthias Langhoff, Scènes Magazine, Lausanne, septembre 1989. Cité par Christine Hamon-Siréjols.
348.
Christine Hamon-Siréjols, op. cit., p. 236.
349.
Ibid., p. 237.
350.
Ibid., pp. 238-239.
351.
Ibid., p. 241.
352.
Ibid., p. 243.
353.
Ibid., p. 245.
354.
Pour des raisons d’équilibre interne, nous n’analysons pas ici en détails le 11 septembre 2001 de Michel Vinaver. Il est cependant évident que ce texte participe lui aussi de la cité du théâtre postpolitique, tant par la référence au poème de T. S. Eliot Wasted Land, que par le tissage des voix a priori si hétérogènes de G. Bush et Oussama Ben Laden en une même parole réversible, et plus globalement par la structure chorale et la référence à « l’oratorio » et non du théâtre-document, alors même que l’auteur s’est amplement documenté et a écrit la pièce juste après l’événement. Ce texte s’inscrit à la fois dans la réponse poélitique et dans la réponse « expressive », au chaos du monde contemporain.
Partie I. Chapitre 4. 1. b.
Un théâtre-reflet du chaos du monde contemporain :
Oxygène(I. Viripaïev/G. Stoev.)
‘« Oxygène est structuré en dix compositions musicales, interprétées par trois acteurs et un DJ.
Chacune porte un titre :
« Danses », « Sacha aime Sacha », « Non et Oui », « Le rhum moscovite », « Le monde arabe », « Comme sans sentiments », « Amnésie », « Les perles », « Pour l’essentiel », « Un casque sur la tête. »
Chaque couplet est précédé d’une thèse, une citation des Dix Commandements, tournée, retournée et détournée par la suite à la lumière des derniers événements de l’Histoire mondiale par deux personnages qui se confrontent et tentent d’articuler leurs différences profondes à travers les grands événements d’aujourd’hui :
le 11 septembre, l’opposition arabo/israélienne, le terrorisme, le globalisme, mais aussi dans leurs rapports à l’amour, à la vérité, à la conscience…
« - Avez-vous entendu ce qui a été dit aux anciens :
« Tu ne tueras point ; celui qui tue sera jugé » ?
Moi, je connaissais un homme qui était vraiment dur d’oreille.
Il n’a pas entendu quand il a été dit « Tu ne tueras point » parce qu’il avait son baladeur sur les oreilles.
Il n’a pas entendu le « Tu ne tueras point. », il prend une pelle, il va au potager et il tue. » 355 » 356 ’
Notes
355.
Ivan Viripaïev, Oxygène, trad. Tania Moguilevskaia et Gilles Morel, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2004.
356.
Galin Stoev, metteur en scène de Oxygène avec la compagnie Friction, création 2004, à propos de la pièce de Ivan Viripaïev. Texte disponible sur internet à l’adresse : www.theatre-contemporain.net/Presentation,1209
Partie I. Chapitre 4. 1. b. i.
Convoquer la réalité pour la juger vs évoquer un réel incohérent
donc inchangeable
Le spectacle Oxygène de I. Viripaïev, mis en scène par Galin Stoev en 2004, nous paraît emblématique de cette volonté assumée d’exprimer et non plus de représenter un monde présenté comme contradictoire, incohérent.
Le réel est présent, de même que sont évoqués les grands événements internationaux du tournant du XXIe siècle – le 11 septembre, le conflit israélo-palestinien, « le monde arabe. »
Mais, précisément, ces événements sont évoqués, et non pas donnés à comprendre, au contraire il s’agit de donner à voir au spectateur le regard distancié et désabusé que portent les jeunes générations sur ces événements.
Pour symboliser l’effondrement des deux tours, la comédienne mime le moment de la collision, l’une de ses mains représentant les tours et l’autre l’avion, accompagnant la gestuelle d’un bruit d’explosion, le tout de manière enfantine, la séquence s’achevant sur son rire, pareil à celui d’un enfant pris en flagrant délit d’impertinence.
Voilà pour la représentation concrète de l’événement, ludique pour les uns, de mauvais goût pour les autres.
Et la réflexion d’ordre moral de cette cinquième composition, titrée « Le monde arabe », et censée illustrer le 5ème Commandement « Prenez garde, ne faîtes pas l’aumône devant les gens afin qu’ils vous voient » 357 ,
confirme l’impression qu’il s’agit non pas de prendre de la distance pour mieux interpréter l’événement et le contextualiser, mais de porter un regard à distance, de l’extérieur, parce que cet événement confirme qu’il n’y a rien à faire, que le monde est mauvais, le monde adulte s’entend, le conseil étant :
‘« Fumez de l’herbe, mangez des pommes et buvez du jus de fruits, au lieu de vous vautrer sur le sol, ivres devant la télé, et de jurer sur le ciel, sur la terre et sur Jérusalem, que votre cœur appartient à une seule personne, parce que si votre cœur appartient à une personne, et votre corps à une autre, sur quoi allez-vous jurer ? […]
Et « oui » sera votre parole, « oui, oui » et « non, non », et ce qui dépasse, ce sera l’œuvre du Malin. » 358 ’
Notes
357.
Oxygène, Ivan Viripaïev, op. cit., p. 61.
358.
Ibid, p. 53.
Partie I. Chapitre 4. 1. b. ii.
Choc des civilisations et choc des individus :
L’impossibilité radicale du vivre ensemble.
Le texte même de la pièce donne à entendre une parole qui se veut ironique et décalée mais s’inscrit dans la théorie du choc des civilisations :
‘« … L’amour et la folie sont des choses aussi différentes que la conscience religieuse d’un musulman irakien et celle d’un juif américain. Et de la même façon que la vue d’une grosse femme en pantalon, qui se bourre l’estomac de hamburgers à la viande de porc, est désagréable pour un musulman, il est aussi désagréable pour David Hoferman de New York, de découvrir les cheveux d’une femme sur le rebord de sa fenêtre après l’explosion du 11 Septembre, juste après que la propriétaire de ces cheveux, une femme blonde et forte en pantalon, a pris la route pour l’enfer musulman, parce qu’à l’intérieur d’elle il y avait des morceaux de porc mal digérés. » 359 ’
La grosse femme en pantalon, le juif new-yorkais, le kamikaze, autant d’images d’Epinal du Choc des Civilisations. Et l’impossibilité pour les différentes civilisations à vivre ensemble renvoie dans la sphère intime à l’amour impossible entre les deux Sacha, à cause de leurs différences culturelles, mais aussi d’une impossibilité des relations humaines :
‘« Un garçon de la province russe profonde tombe amoureux d’une fille du milieu snob de Moscou (ou de n’importe quelle autre capitale). Conduit par cette passion, il tue sa femme... Les deux protagonistes se rencontrent dans le champ de leurs irréconciliables différences. L’histoire racontée constitue un prétexte pour circonscrire les paramètres de la nouvelle confusion mondiale. » 360 ’
« Irréconciliables différences » et différends scellent le divorce entre les individus et les cultures, et signent la mort de toute pensée du vivre ensemble, la mort du principe fondateur de la communauté politique… Et du théâtre comme art ontologiquement politique.
Notes
359.
Ibid, p. 62.
360.
Galin Stoev, « Etranglement du sens », entretien avec Sabrina Weldman, Mouvement.net, publié le 16 novembre 2006.
Partie I. Chapitre 4. 1. b. iii.
Le théâtre comme destruction de l’assise mentale du politique.
Là où la tragédie grecque constituait l’assise mentale du politique 361 , cette veine du théâtre contemporain prétend décrire sa destruction, et ce faisant œuvre à la détruire.
La fonction critique du théâtre est radicalisée et dépolitisée, le regard sur le monde se fait à distance de la politique et à ras du réel, hors de toute ambition d’un regard cohérent sur le monde.
La dramaturgie du texte et l’écriture scénique rompent donc naturellement avec l’esthétique aristotélicienne comme avec le théâtre épique :
‘« Viripaev n’écrit pas pour autant une pièce à thèse ni un texte manichéen, il accumule dans un rythme soutenu un trop plein de mots, une incroyable quantité d’arguments alambiqués et truffés de paradoxes. Il s’agit moins d’un texte à rendre absolument intelligible, que d’une partition, d’un canevas rythmique et énergétique qui déploie ses arguments face au monde sous la forme d’un concert au débit infernal. » 362 ’
Dans le spectacle diffusé en France la dimension de « théâtre-concert » paraît être ce qui a retenu l’attention du metteur en scène, des programmateurs et du public. Il paraît donc important de s’intéresser spécifiquement à cette caractéristique du spectacle, et à questionner sa dimension politique.
Notes
361.
Formule de Christian Meier, in De la tragédie grecque comme art politique, trad. Marielle Carlier, Histoire, Les Belles Lettres, 1999. Nous développerons cette question de la référence au théâtre antique, essentielle pour penser la cité du théâtre politique oecuménique, dans la partie suivante.
362.
Galin Stoev, « Etranglement du sens », déjà cité.
Partie I. Chapitre 4. 1. b. iv.
Entre théâtre-concert et ironie du texte :
Multiplicité de modes d’énonciation contradictoires.
Pour le metteur en scène Galin Stoev, Oxygène serait politique parce qu’énergique, prouvant que tout espoir n’est pas perdu parce que, bien que désespérée de l’état du monde, la jeunesse contient toujours en elle un potentiel indestructible :
‘« Oxygène se situe entre musique et texte politique, à la frontière du théâtre et du concert, un texte qui soulève les grands problèmes éthiques d’aujourd’hui au travers d’une fable qui jette un pont entre hier et demain, stigmatise les réalités de notre monde écartelé par ses propres contradictions.
Oxygène n’est pas une pièce de théâtre à proprement parler, mais un texte qui fixe un certain état d’hystérie vital, autodestructeur et chargé d’espoir.
Oxygène est un concentré de vie et un remède contre l’endormissement. Un texte nécessaire. » 363 ’
Nous voudrions insister sur cette utilisation de la musique et sur son caractère politique – ou non. S’il est indiscutable que ce spectacle ne suscite pas l’endormissement, le nombre de décibels peut être jugé problématique précisément au regard de son ambition politique affichée. De fait, lors de la représentation à laquelle nous avons assisté à la Ferme du Buisson en mars 2006, un grand nombre d’adolescents (environ un quart des spectateurs) étaient présents dans la salle et ont apprécié la musique, écoutant distraitement les paroles, le corps occupé par la rythmique. La volonté d’impliquer le corps du spectateur, de susciter un partage non plus de réflexions ou d’émotions mais bien de sensations physiques, est à la fois intéressante – elle fonctionne – et problématique précisément parce qu’elle est efficace, et fait adhérer les spectateurs de manière quasi inconsciente à un discours tenu sur le monde, confortant une attitude de méfiance à l’égard de la politique et un sentiment non seulement d’incompréhension mais de désintérêt. Si le texte n’est pas important aux yeux du metteur en scène, il existe et s’entend, et ses contradictions et paradoxes sont riches de sens.
Le premier décalage entre le sens de la pièce russe et celui du spectacle joué en France tient à la réception réelle : Une grande partie des spectateurs est jeune, et ne comprend donc pas l’essentiel des critiques vigoureuses qui sont portées contre la société russe (une partie des références est d’ailleurs gommée du spectacle du fait de coupes opérées par le metteur en scène.) Mais le fait que ce public apprécie – non pas malgré cela, mais bien indépendamment de cela – le spectacle dit bien le malentendu que le spectacle autorise, et témoigne d’une ambiguïté de la réception programmée par le spectacle. Car le choix du théâtre-concert non pas comme outil ponctuel mais bien comme socle de la composition d’ensemble du spectacle, accentue la possibilité de se laisser porter par la musique sans chercher à comprendre les paroles. D’autant plus que, parallèlement, le texte de Viripaïev est hautement ironique, pour dénoncer le cynisme de la société russe contemporaine. Le spectateur est sollicité dans le même temps selon deux modes contradictoires, d’une part par la musique qui incite à annihiler son esprit critique pour s’abandonner au plaisir pulsionnel du rythme, et d’autre part par le texte, qui exprime un point de vue sur le monde et active une réception intellectuelle fondée sur l’évaluation du propos suivie d’une adhésion ou d’un rejet, et qui est en plus un texte fondé sur un double langage, le sens réel étant en contradiction avec le sens apparent. La coexistence de ces deux modes d’adresse radicalement différents, l’omniprésence scénique de la musique, le jeu des acteurs qui privilégie la scansion au sens, et l’ironie du texte, articulées avec le rejet du théâtre manichéen et à thèse, font éclater le sens. Et ces différents procédés nous paraissent s’inscrire dans un héritage critique du théâtre épique, et justifier de ce fait une comparaison avec l’utilisation brechtienne de la musique, dans les songs.
Notes
363.
Galin Stoev, in Sabrina Weldman, « Etranglement du sens », art. cit.
Partie I. Chapitre 4. 1. b. v.
Du théâtre épique au théâtre-concert.
Changement de statut de la musique.
La rupture avec le théâtre épique pourrait sembler contredite par l’éclatement de la narration, par le principe de détournement de chacun des Dix Commandements, qui préside à chaque « composition », ou encore par l’utilisation qui est faite de la musique. Mais c’est précisément sur ce point que se situe la différence radicale entre les deux esthétiques : Le théâtre épique articulait narration, action et commentaires, textes et chansons, comme des temps distincts et complémentaires, créant le spectacle comme un système à plusieurs niveaux, complexe mais cohérent, au-delà (et du fait) des contradictions au sein de chaque niveau, et entre les différents niveaux. Tandis qu’à l’inverse, la coexistence au même moment du texte ironique, de la musique et du chant, exprime le chaos davantage qu’elle ne produit un discours critique sur ce chaos ou n’incite à le mettre à distance. Inspirée à Brecht par la vivacité des para-théâtres du début du siècle (le Bänkellied, le cabaret, le cirque, le théâtre de variétés) 364 ,
l’utilisation de la musique a permis la mise en œuvre d’une critique du théâtre bourgeois, en même temps qu’elle signe l’avènement d’un théâtre poétique :
‘« Cette introduction de la musique marqua une rupture avec les conventions dramatiques de l’époque : le drame s’est fait moins pesant, plus élégant en quelque sorte […] La musique, en introduisant une certaine variété, constituait par sa seule présence une attaque contre l'atmosphère lourde et visqueuse des drames impressionnistes et la partialité des drames expressionnistes. Du même coup, elle a rendu possible une chose qui n’allait plus de soi : le "théâtre poétique."» 365 ’
Progressivement, les songs vont s’imposer dans le cadre de l’esthétique épique de séparation des éléments du spectacle, et faire entendre des « réflexions et commentaires moralisants » 366
et l'effet de distanciation. Les songs jouent un rôle de rupture de l’action et de commentaire, et le song a pour fonction de susciter non pas l’émotion mais la réflexion. Il serait cependant faux d’opposer réflexion et émotion, car cette dernière n’est pas exclue, en tant qu’effet secondaire. Le principe du song ne repose donc pas tant sur une dichotomie que sur une hiérarchie entre le sens et les sens :
‘« En aucun cas … le chant ne surgit là où manquent les mots par suite de l’excès des sentiments. Il faut que le comédien non seulement chante, mais aussi montre quelqu’un qui chante. Il n’essaie pas tellement d’aller chercher le contenu affectif de son chant … débouche-t-il dans la mélodie, il faut que cela soit un événement ; pour le souligner, le comédien peut laisser nettement percer le plaisir qu’il prend lui-même à la mélodie. » 367 ’
Le principe de hiérarchie s’explique par le fait que les songs servent l’objectif du théâtre épique, qui est de donner à comprendre le monde en vue de le transformer :
‘« Le théâtre épique s’intéresse avant tout au comportement des hommes les uns envers les autres, là où ce comportement présente une signification historico-sociale (là où il est typique.) Il fait ressortir des scènes dans lesquelles des hommes agissent de manière telle que le spectateur voit apparaître les lois qui régissent leur vie sociale. En même temps, le théâtre épique doit définir les procès sociaux dans une perspective pratique, c’est-à-dire fournir des définitions qui donnent les moyens d’intervenir sur ces procès. Son intérêt est donc éminemment axé sur la pratique. Le comportement humain est montré comme susceptible d’être transformé et l’homme comme dépendant de rapports politico-économiques dont il est capable d’assurer la transformation. » 368 ’
On mesure donc l’écart entre la fonction des songs brechtiens et celle du théâtre-concert tel qu’il est manifeste dans la mise en scène par Galin Stoev et la compagnie Fraction de la pièce Oxygène, et qui, au-delà des différences formelles évidentes, mérite le même reproche que celui que Brecht faisait aux dramaturgies aristotéliciennes : Il s’agit d’un théâtre qui donne à voir un monde et des destins individuels immuables, inchangeables… Avec une nuance de taille, le fait que ce renouveau se fait sur les ruines du théâtre épique, jugé dépassé. Deux précisions s’imposent toutefois. D’une part, pour ce qui concerne la réception réelle de la musique, il importe de rappeler que l’auteur de L’Opéra de Quat’sous qui voulait exercer les « charmes » du spectacle bourgeois pour mieux les critiquer ensuite, a connu le même problème de réception lié à l’omniprésence de la musique associée à la volonté de faire un « spectacle-piège », le spectateur pouvant céder à la séduction sans voir la dénonciation dont l’auteur / metteur en scène la voulait chargée. 369
D’autre part, la réception réelle – et prolématique selon nous – du spectacle est conditionnée par le décalage entre la société russe et la société française, et par le fait que le metteur en scène, bulgare, n’a pas pris la mesure de ce décalage. Nous avons analysé ce spectacle dans la mesure où c’est le contresens qui explique en partie l’accueil dithyrambique qu’il a reçu en France, mais notre étude, qui manifeste l’importance considérable du contexte de réception d’un texte pour évaluer sa dimension politique, ne nous permet donc pas, en toute logique, de cerner la dimension politique du texte initial. Et c’est parce qu’elles nous paraissent poser des problèmes similaires, que nous ne focaliserons pas notre analyse sur les mises en scène des textes de Giannina Carbunariu, Biljana Srbljanovic ou encore sur les spectacles du Théâtre Libre de Minsk, tous artistes dont les œuvres ont été données en France, essentiellement au Studio-Théâtre d’Alfortville, dirigé par Christian Benedetti, entre 2004 et 2007. Ces deux nuances concernant la réception réelle étant apportées, il n’en demeure pas moins incontestable que la réception programmée par la composition du spectacle Oxygène vise par la musique à annihiler le sens critique du texte, et que ce dernier, par le maniement de l’ironie, ne maintient le projet critique qu’au second degré. Ce sens codé devient donc à la fois conditionnel – tous les spectateurs ne le comprennent pas – et radical, car le travail de sape s’en prend à la volonté même de faire une œuvre critique. C’est dans cette mesure qu’il importe de revenir en détails sur la définition d’un théâtre politique découplé de toute représentation cohérente et distanciée du monde.
Notes
364.
Jeanne Lorang, « Cirque, champ de foire, cabaret, ou de Wedekind à Piscator et à Brecht », in Du cirque au théâtre, Th20, L’Age d’Homme, Lausanne,1983, pp. 19-47.
365.
Bertolt Brecht, « Sur l’emploi de la musique pour un théâtre épique », in Ecrits sur le théâtre, I, L'Arche, (1963) 1972, p. 454.
366.
Idem.
367.
Bertolt Brecht, « de la manière de chanter les songs »,
« Notes sur l’Opéra de quat’sous », in Ecrits sur le théâtre, tome 2, Paris, L’Arche, (1963), 1979, p. 319.
368.
Bertolt Brecht, « Sur l’emploi de la musique pour un théâtre épique », op. cit., p. 455.
369.
Bernard Dort, « La comédie bourgeoise », Lecture de Brecht, Paris, Pierres Vives, Seuil, 1960, pp. 72-74.
Partie I. Chapitre 4. 1. b. vi.
La fin du théâtre comme hétérotopie politique.
L’interprétation caricaturale du théâtre épique comme théâtre à thèse incite donc à considérer à l’inverse la non-cohérence et la contradiction comme critères de validité du théâtre postpolitique contemporain. Le risque est alors d’aboutir à un théâtre qui, sous couvert de dénoncer, met sur la scène sans plus de commentaires une contradiction et la présente dans ce qu’elle peut avoir de fascinant ou d’attirant. Ainsi le personnage féminin d’Oxygène reproche au personnage masculin sa contradiction, et, à travers ce dialogue entre personnages fictifs, l’auteur livre ses propres doutes quant aux pouvoirs du théâtre à changer le monde :
‘ « Le mensonge, c’est que tu n’as jamais parlé aux Sacha de Serpoukhov, et que tu te fous, de comment ils vivent là-bas, et de qui ils tuent là-bas, mais tu vas raconter les larmes aux yeux, l’histoire d’une vie qui t’est étrangère. Tu vas souffrir, d’un problème qui, pour toi, n’existe tout simplement pas. Parce que, après ce genre de spectacle tu vas dans la boîte branchée Propaganda, alors que Sacha, dont tout à l’heure tu racontais l’histoire va, je suppose, aller se faire foutre ou pire. » 370 ’
Certes, il n’est pas certain que le fait d’aller au théâtre suffise à changer le monde, le contraire est même relativement acquis. Cet argument suffit-il à justifier que l’on se contente de donner à voir ce monde sur la scène de théâtre, privant ce dernier de sa possible force d’alternative ?
L’idée d’un lien entre théâtre et utopie est à la fois ancienne et complexe, aussi nous ne renverrons qu’aux réflexions qui informent directement la compréhension de l’évolution contemporaine du théâtre. A la fin des années 1960, se développe l’idée que le théâtre doit s’appréhender non comme utopie – concept dangereux parce qu’il nie potentiellement la réalité, et mensonger parce qu’il nie l’inscription du théâtre dans la cité – mais comme hétérotopie. Dans sa conférence intitulée « Des espaces autres », au Collège de France en 1967, Michel Foucault oppose précisément les utopies aux hétérotopies :
‘« Les utopies, ce sont les emplacements sans lieu réel. Ce sont les emplacements qui entretiennent avec 1'espace réel de la société un rapport général d'analogie directe ou inversée. C'est la société elle-même perfectionnée ou c'est l'envers de la société, mais, de toute façon, ces utopies sont des espaces qui sont fondamentalement essentiellement irréels. Il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute civilisation, des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont dessinés dans l'institution même de la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Ces lieux, parce qu'ils sont absolument autres que tous les emplacements qu'ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, les hétérotopies. » 371 ’
Bien que le théâtre ne soit pas mentionné directement dans ses propos, les différents principes énumérés par Foucault semblent de prime abord en faire l’exemple-type de l’hétérotopie. 372
En effet « les hétérotopies prennent le plus souvent place dans une hétérochronie » (quatrième principe), elles « supposent toujours un système d'ouverture et de fermeture qui, à la fois, les isole et les rend pénétrables […] et en général on n'accède pas à un emplacement hétérotopique comme dans un moulin » (cinquième principe), et enfin les hétérotopies « ont, par rapport à l'espace restant, une fonction. Celle-ci se déploie entre deux pôles extrêmes. Ou bien elles ont pour rôle de créer un espace d'illusion qui dénonce comme plus illusoire encore tout l'espace réel, tous les emplacements à l'intérieur desquels la vie humaine est cloisonnée. Peut-être est-ce ce rôle qu'ont joué pendant longtemps ces fameuses maisons closes dont on se trouve maintenant privé. Ou bien, au contraire, créant un autre espace, un autre espace réel, aussi parfait, aussi méticuleux, aussi bien arrangé que le nôtre est désordonné, mal agencé et brouillon. Ça serait l'hétérotopie non pas d'illusion mais de compensation. » (sixième principe).
Or le théâtre est bien ce lieu créateur d’un espace-temps précaire, à la fois partie intégrante et extérieur à l’espace social, doté d’une fonction spécifique, qui oscille entre dénonciation et compensation de l’espace-temps réel, entre illusion et représentation du réel.
Mais l’évidence de l’assimilation du théâtre à l’hétérotopie se voit nuancée quand Foucault évoque entre hétérotopie et utopie « une sorte d'expérience mixte, mitoyenne, qui serait le miroir » :
‘« Le miroir, après tout, c'est une utopie, puisque c'est un lieu sans lieu. Dans le miroir, je me vois là où je ne suis pas, dans un espace irréel qui s'ouvre virtuellement derrière la surface, je suis là-bas, là où je ne suis pas, une sorte d'ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, qui me permet de me regarder là où je suis absent - utopie du miroir. Mais c'est également une hétérotopie, dans la mesure où le miroir existe réellement, et où il a, sur la place que j'occupe, une sorte d'effet en retour ; c'est à partir du miroir que je me découvre absent à la place où je suis puisque je me vois là-bas.
À partir de ce regard qui en quelque sorte se porte sur moi, du fond de cet espace virtuel qui est de l'autre côté de la glace, je reviens vers moi et je recommence à porter mes yeux vers moi-même et à me reconstituer là où je suis ; le miroir fonctionne comme une hétérotopie en ce sens qu'il rend cette place que j'occupe au moment où je me regarde dans la glace, à la fois absolument réelle, en liaison avec tout l'espace qui l'entoure, et absolument irréelle puisqu'elle est obligée, pour être perçue, de passer par ce point virtuel qui est là-bas. » 373 ’
Le théâtre postpolitique rompt avec l’idée que le théâtre est à la fois une utopie et une hétérotopie, ou pour le dire avec Jean-Pierre Sarrazac une « enclave d’utopie au cœur du réel. Espace où rouvrir la réalité aux multiples chemins du possible. » 374
En tant que lieu où s’inventent des mondes imaginaires, en tant que lieu de représentation, le théâtre est une utopie. En tant qu’il réfère au monde réel par une médiation et en tant qu’il s’inscrit concrètement (sur le plan matériel, spatial, temporel) dans la vie de la Cité sur le mode de la présence-absence, de la parenthèse, il est une hétérotopie. Et le spectacle Oxygène récuse tout ensemble la dimension utopique et hétérotopique. De fait, si le personnage féminin critique implicitement la superficialité et l’indifférence de la Sacha moscovite et de son partenaire qui fréquente les boîtes de nuit, le spectacle recrée la situation propre à ce lieu, puisque la musique est par moment si forte qu’elle empêche d’entendre les paroles, et rend impossible parfois, accessoire souvent, l’accès aux propos – l’écrivain ayant par ailleurs fait le choix que la profondeur de ce contenu ne dépasse que rarement celle des discussions de boîte de nuit. S’il nous est apparu important d’analyser ce spectacle, et à travers lui les recours fréquents et souvent parallèles à la forme du théâtre-concert et à la rhétorique de l’ironie, c’est parce qu’ils emblématisent selon nous une évolution dans la manière de présenter le réel sur la scène mais aussi de penser la fonction politique du théâtre. Nous pensons notamment à l’utilisation de la musique qui en vient parfois à supplanter le rôle du texte, mais aussi à l’ambiguïté de formes qui se contentent de montrer, voire d’incarner avec complaisance ce qu’elles prétendent dénoncer. Nous pensons ici notamment au spectacle Big 3rd. Happy / end, de Superamas, présenté au Centre Georges Pompidou les 20 et 21 décembre 2006 dans le cadre de la 6ème édition du Festival 100 Dessus Dessous, intitulée « Vie privée / vie publique », un théâtre réalité. La compagnie dit vouloir « s’attache[r] à observer et à interroger notre condition dans un environnement technologique et marchand. … Montrer, c’est faire voir, exposer au regard. » 375
Et la critique valorise cette démarche qui consiste à montrer et non pas démontrer :
‘« Superamas s’emploie à montrer les procédés de construction d’une image. Montrer, mais surtout pas démontrer. […] Après une heure de plaisir non dissimulé à observer la beauté des danseuses, la maîtrise de la lumière et des transitions, quand le vide du propos commence à occuper tout l’espace et que l’ineptie du plaisir se présente à lui-même, c’est Derrida qui nous donnera la clé : « pourquoi s’attacher à démonter quelque chose qui est si bon ? » 376 ’ ‘
« La tête d’affiche de 100 Dessus Dessous, c’est Superamas. Un groupe … venu de la danse et du théâtre, du cinéma, du son et de la lumière, un groupe qu’on ne voit guère ailleurs en France, bien qu’ils la représentent de l’Europe aux Etats)-Unis. Dans Big 3rd episode (happy/end), on retrouve leur marque de fabrique : ready-made issus de la culture populaire et références cinéphiliques ou philosophiques, mêlés à des scénarios résolument superficiels que des comédiens rejouent en boucle. Le but, ici, c’est de jouer le décalage, pour démonter les codes de ce bonheur obligatoire (succès, sociabilité, sexe…) qu’on s’échine à singer. En résumé, du divertissement qui ne demande qu’à faire réfléchir, pour peu qu’on se prête au jeu. » 377 ’
Ce qui nous paraît matière à discussion dans le projet critique que vise le spectacle, c’est qu’en l’occurrence le divertissement est exactement le même que celui que l’on peut éprouver en regardant la télévision, et que la fascination qu'il exerce est aussi trouble. Il provient entre autres du fait de contempler des femmes – à la plastique parfaite et attirante – en dessous ou nues le plus souvent, sur talons aiguilles, dans des dialogues d’une absolue vacuité 378
ou dans une réplique des finales de « prime-time » de la Star Academy. Montrer une chose n’est pas démontrer, ni même « démonter », encore moins dénoncer. Parce qu’il est présenté sur la scène et accompagné de citations émanant d’autorités intellectuelles, le divertissement honteux à la télévision devient-il un divertissement noble et culturel ? Il est intéressant de noter que toute la responsabilité du projet critique incombe au spectateur. Dire que le spectacle est un « divertissement qui ne demande qu’à faire réfléchir » le spectateur, c’est dire qu’il ne le fait pas. Mais considérer qu’il ne s’agit pour le spectateur que d’activer un sens critique potentiel, programmé en germes par le spectacle, suppose que l’on évalue le spectacle à partir d’un sens caché. Car la partie visible, et bien visible, du spectacle c’est un divertissement qui affiche une certaine délectation à jouer le premier degré davantage qu’à suggérer le second. Le simple fait de jouer dans un lieu théâtral suffit-il donc à générer un potentiel critique supérieur à celui de la télévision, que l’on peut également regarder en exerçant son esprit critique ou en mettant à distance et en interrogeant ses propres sensations – ou pas ? La réception de ce type de spectacle par la critique paraît témoigner d’un relatif consensus au sein de l’institution culturelle. Ainsi, le spectacle de Superamas a reçu une critique unanime, et a fait figure de clou du festival 100 dessus dessous. De même, Nicole Gauthier a décidé de programmer Oxygène pendant un mois parce qu’elle estimait que « c’est ça la jeunesse d’aujourd’hui. » 379
Or, l’actuelle directrice du Théâtre de la Cité Internationale à Paris, ancienne conseillère technique de l’Office national de Diffusion Artistique (ONDA) - organisme para-ministériel chargé d’aider et de conseiller à la programmation des lieux - est réputée comme dénicheuse de talents. Elle a ainsi beaucoup aidé à la diffusion de Didier-Georges Gabily, Jean-Luc Lagarce ou de Rodrigo Garcia en France, et le Théâtre de la Cité Internationale joue un rôle considérable dans la carrière des spectacles et des compagnies, bien plus que ne le laisse supposer son rayonnement en tant que salle de spectacle. C’est en tant que « théâtre politique » du XXIe siècle que le spectacle Oxygène se revendique, et c’est ainsi qu’il est reçu, intégré et valorisé par l’institution théâtrale, parce que qu’il donne à voir des « instantanés saisissants de la vie du nouveau siècle, [le] portrait d’une génération en demandes d’explications. » 380
C’est également en tant qu’il est « générationnel » que le Théâtre de la Cité Internationale va ensuite programmer un autre spectacle écrit, mis en scène et interprété par des artistes trentenaires qui témoignent d’un même rapport ambivalent au politique et plus particulièrement au politique défini comme processus d’émancipation passant par une action politique collective.
Notes
370.
Oxygène, op. cit., pp. 65-66.
371.
Michel Foucault, Dits et écrits 1984 ,« Des espaces autres », conférence au Cercle d'études architecturales, 14 mars 1967, Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5, octobre 1984, pp. 46-49.
372.
Il mentionne « la fête ».
373.
Michel Foucault, Des espaces autres, op. cit.
374.
Jean-Pierre Sarrazac, Critique du théâtre. De l’utopie au désenchantement, Belfort, Circé, 2000, p. 27.
375.
Dossier de presse du spectacle.
376.
Léa Lescure, « BIG 3 », du collectif Superamas. Reality show », in Mouvement.net, 14.12.2006. Consultable à l’adresse : www.mouvement.net/html/fiche.php?doc_to_load=11495
377.
Cathy Blisson, Télérama n°2970, 16 décembre 2006.
378.
La source d’inspiration de la scène au gymnase-club est d’ailleurs donnée dans le générique de fin du spectacle, il s’agit de la série Sex and the City.
379.
Nicole Gauthier, commentaire fait à la sortie de la représentation à La Ferme du Buisson à Noisiel le samedi 25 mars 2006. Elle a ensuite décidé de programmer le spectacle au Théâtre de la Cité Internationale en novembre 2006.
380.
Site du Théâtre de la Cité Internationale, novembre 2006.
Partie I. Chapitre 4. 1. c.
Dire l’impossibilité de l’engagement politique :
Fées (R. Chéneau/D. Bobée.)
Partie I. Chapitre 4. 1. c. i.
Expier la faute d’une génération
La focalisation sur la réception sensorielle est une autre caractéristique de ce théâtre postpolitique, qui manifeste bien le rejet d’une cohérence et d’un discours critique articulé sur le monde.
C’est ainsi que se trouve réactivée la référence à la performance, synonyme souvent d’une souffrance au présent, intransitive, et christique, réellement éprouvée sur la scène par l’acteur – et, par procuration, par le spectateur – L’artiste souffre pour le monde et souffre sans doute aussi parce qu’il ne peut changer le monde.
Le spectacle Fées 381
de Ronan Chéneau, mis en scène par David Bobée, est écrit, mis en scène et interprété par des membres de la même génération que celle d’Oxygène, qui se définissent comme les « enfants des années 1970 coupables de ne pas savoir refaire le monde que leurs parents leur ont laissé. » 382
Cette équipe pourtant jeune peut être considérée comme l’enfant sage et mature de l’œuvre de Rodrigo Garcia. La distribution de la parole ne se répartit pas selon une logique de personnages, et l’écriture s’appuie également sur le principe des listes :
liste de stars du grand et surtout du petit écran 383 ;
liste de slogans publicitaires et politiques mélangés – le « ensemble tout est possible » 384
du candidat UMP à l’élection présidentielle de 2007 croisant le slogan « Just do it » de Nike 385 – ;
liste des sigles, hiéroglyphes incompréhensibles qui cernent l’individu dans le monde contemporain, indéchiffrable 386 ,
et pourtant indépassable.
Notes
381.
Ronan Chéneau, Fées, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 200. Mise en scène David Bobée, création CDN Caen, 2004, Théâtre de la Cité Internationale à Paris, mars-avril 2007.
382.
Dossier de presse du spectacle.
383.
Idem.
384.
Slogan qui ne figure pas dans la version publiée mais a été rajouté lors des représentations au Théâtre de la Cité Internationale, en réponse à l’actualité de la campagne électorale.
385.
Ronan Chéneau, Fées, op. cit., pp. 24-25.
386.
Ibid., pp. 54-60.
Partie I. Chapitre 4. 1. c. ii.
Un autre monde n’est pas possible.
L’espace scénique, organisé pour un rapport bi-frontal, est celui d’une salle de bain cernée par deux murs, les gradins sur lesquels les spectateurs se font face constituant les deux autres. Le spectateur est ainsi littéralement face à lui-même, tout en étant happé lui aussi par le présent de cet espace qui dit à la fois la réduction sur l’espace intime, et la solitude de l’unique personnage ayant un référent réel « un individu libre de race blanche, […] dans les 25/30, […] » 387 .
Aucun ailleurs n’est permis, et c’est ce qui fonde la neurasthénie de cette jeunesse :
‘« Fée 2. - On dit cette génération prisonnière du présent.
/ Ce qui rend la situation peu enviable…
Vu l’état du présent. / […] /
Elle n’arriverait pas à grandir, à vieillir, sortir, à se déterminer… [ 388 ]
Fée 1. – Il faudrait qu’elle lise un peu plus, qu’elle s’ouvre un peu plus à son entourage, qu’elle s’active un peu
Fée 2. – Elle arriverait difficilement à s’adapter à se bouger ?
Elle serait championne en aphasie, en apathie, en inertie, en neurasthénie, en anorexie /
Particulièrement stressée et inemployée /
Particulièrement incasable / Sauf à temps partiel… /[…] /
C’est pour ça que tu es triste ? [ 389 ]
Fée 2.- Non… C’est parce que… je voudrais être dans une comédie musicale… » 390 ’
Contradictoire, lucide et passive, cette jeunesse n’a pour horizon et pour ambition que l’univers artificiel d’une comédie musicale. Aucun ailleurs n’est possible. D’ailleurs, la bi-frontalité fait de la scène une arène, et contribue à faire de l’acteur un combattant, voire un martyre de l’absence de sens – les fées l’interrogent sans relâche sur la vacuité du sens de sa vie :
‘« Une fée, à l’homme. / Tu t’es levé… un jour / Tu t’es levé pour quoi faire ? / Tu as été microbe, animal / Vie cellulaire… / Pour quoi faire ? / […] / Homo sapiens / Pour quoi faire ? / […] / Tu as eu peur de la mort… / Tu as cherché le savoir / Tu as voulu le savoir… / Pour quoi faire ? Tu t’es levé / Un jour… / Tu t’es levé / Un jour sur tes deux pieds / Mais pour quoi faire ? / Pour quoi faire ? 391 ’
Le sens est inaccessible, et toute velléité d’action est illusoire. « Décidément, nous serons pas des héros » 392 ,
martèle le personnage masculin. Et l’acteur parait expier cette faute, rédimer sa culpabilité, quand il s’expulse de sa baignoire utérine pour échouer pesamment sur le sol et s’y ébattre – s’y débattre plutôt, comme un poisson en manque d’oxygène, hors de son élément. Après une agonie en position fœtale, il réincorpore la baignoire, puis recommence et avorte à plusieurs reprises sa naissance au monde. Chaque fois le choc de son corps sur le sol est violent, et non simulé. De même, lors d’une autre séquence, par jeu enfantin, par cruauté enfantine, l’acteur jette avec force des balles sur l’une des fées, vise la tête, une jambe, un sein. Et marque à tout coup – le corps de la comédienne, couvert de bleus, porte d’ailleurs les traces des représentations précédentes.
Notes
387.
Là encore le texte ne figure que dans le spectacle (et la feuille de salle du Théâtre de la Cité. )
388.
Pour une raison de place, nous figurons ici le passage à la ligne par un slash.
389.
Même chose.
390.
Ibid., pp. 65-66.
391.
Ibid., pp. 45-46. Ici encore, pour une raison de place, nous figurons ici le passage à la ligne par un slash.
392.
Ibid., p. 41.
Partie I. Chapitre 4. 1. c. iii.
L’impossibilité de tout engagement politique.
Dans ce spectacle, la violence n’est cependant pas purement expiatoire et intransitive. L’une des fées met un masque de la statue de la liberté et prend l’une des 100 bouteilles de shampoing vertes – de marque et de forme différentes – qui jonchent le sol. Sur une musique rock poisseuse, elle s’en verse sur les yeux et dans la bouche, et tente ensuite de rester debout à mesure que le liquide blanc et gluant dégouline par terre et la déséquilibre, composant une danse saccadée qui symbolise avec force l’aveuglement réel et l’effondrement de l’idéal incarné par l’empire nord américain. Mais la séquence peut aussi bien dire la cécité volontaire des individus contemporains qui se bouchent les yeux face à un monde trop laid, trop incompréhensible. Ce qui se trouve au cœur de ce spectacle, c’est en définitive ce qui constitue selon nous la caractéristique fondamentale de ce théâtre postpolitique, qui dénonce et réaffirme du même mouvement l’impossibilité contemporaine de l’engagement politique. La scène se passe dans une salle de bain, et le spectacle laisse une large part à un élément à forte charge psychanalytique, l’eau. Elément de la régression par excellence, l’eau peut également évoquer la décomposition des chairs, et de fait l’atmosphère blafarde est renforcée par le carrelage blanc comme par l’éclairage, d’un vert artificiel qui accentue la pâleur fantasmagorique des deux « fées ». Couleurs froides et artificielles, omniprésence de l’eau, les synesthésies scéniques disent un univers symbolique hanté par la mort et la décomposition, bercé par la caresse mortifère de la voix chuchotée des comédiennes. L’irruption dans cette atmosphère d’un éclairage rouge qui éclaire une tirade enragée de l’une des fées constitue à soi seul une révolution. Et c’est ce qu’elle réclame, « il faut la révolution » 393 ,
« la seule attitude possible, c’est le mouvement ! » 394
Mais une révolution inversée, puisque, le poing levé, c’est un discours réactionnaire que brandit l’actrice comme un étendard, qui conspue les fonctionnaires et les immigrés, mais aussi et surtout la gauche, qu’il « faut purger de ses vieux démons moisis de ses relents marxistes qui sentent la chaussette pourrie. » 395
Antiphrase ? Bien sûr, le jeu de la comédienne pousse à cette interprétation, et aucun des acteurs n’adhère à ce discours, comme le laisse entendre la réponse compatissante et apaisante de l’autre fée :
‘« Donc, si je comprends bien tu t’efforces de penser ou, t’as entendu dire quelque part pour te rassurer que la seule attitude qui t’est possible c’est le mouvement…
Et tu le dis…
Et le reprends d’une... quelconque allocution de Chirac président ?… De Sarkozy président ?… De Le Pen président ? » 396 ’
Notes
393.
Texte rajouté pour les représentations.
394.
Ronan Chéneau, Fées, op. cit.,p. 62.
395.
Ibid., p. 63.
396.
Ibid., p. 63.
Partie I. Chapitre 4. 1. c. iv.
De la revendication politique au discours millénariste
Le spectacle épingle à plusieurs reprises les dérives totalitaires d’une droite musclée qui, en France comme aux Etats-Unis, fait de la peur et de l’insécurité son fonds de commerce.
Une fée joue les Cassandre :
‘« Je veux CRIER / HAUT / Et FORT / […] / QUE ! NOUS ! /
VIVONS ! / AU ! BEAU ! MILIEU ! / DU ! / CHAOS ! / LE PLUS ! /
TYRANNIQUE ! / […] / LA PLUS MONSTRUEUSE / EPOQUE /
SE PREPARE !!! / LA PLUS MONSTRUEUSE BARBARIE ! » 397 ’
De même, une autre séquence prend des allures d’anticipation millénariste :
‘« Comme ça / J’ai imaginé qu’en 2100 / Le monde serait libre /
Qu’on y vivrait heureux / Mais d’abord ça aurait empiré / Bush / Après dix ans de guerre / Viendrait à bout de tous les intégrismes / Le monde serait / Propre / Parfaitement / Civilisé / Ce serait pour un temps /
Le règne absolu du puritanisme / […] / Le couvre-feu planétaire / […] / plus personne ne sortirait le soir / la plupart des jeunes seraient à l’usine ou au bureau / […] / le sexe aurait été aboli / la musique aurait été abolie / les drogues auraient été abolies / le corps aurait été aboli / on aurait trouvé un moyen sûr d’éradiquer le mal / […] / toute différence abolie / […] / Et puis un jour, enfin, il y aurait : /
La Révolution /En 2100 / La fin de la civilisation / Et le retour à la : préhistoire / Peut-être que ce serait ça : /
Le vrai fond de la modernité / Que des hommes / Des femmes / Nus / Que des êtres humains / Seuls, ensemble / Dans le désert / Avec le vent / Les arbres… » 398 ’
La révolution n’est pas pour demain, et qui plus est, elle n’est pensable que comme destruction de la civilisation.
L’idée véhiculée par le spectacle est que le discours que l’on peut effectivement dans une certaine mesure qualifier de « révolutionnaire », aujourd’hui, est portée par la droite et plus seulement d’ailleurs par la droite extrême.
Parce que du côté de la jeunesse, potentiellement porteuse des valeurs de la gauche, point de révolution possible.
Parce que, comme le répète le personnage masculin, « sous les pavés, il n’y a plus la plage » 399 ,
et surtout
parce que « je suis de mon temps, je suis un individualiste, c’est plus fort que moi… » 400
Notes
397.
Ibid., p. 84-85. Ici encore, nous figurons le passage à la ligne par un slash.
398.
Ibid., pp. 74-77. Même chose.
399.
Ibid., p. 41.
400.
Version du spectacle.
Partie I. Chapitre 4. 1. c. v.
Un autre théâtre n’est pas possible… Et pourtant…
Le théâtre, l’art, sont jugés incapables de constituer une alternative, parce qu’ils ne sont pas ce qu’ils auraient pu être, ne jouent plus de rôle dans la société :
‘« Est-ce que tu t’y connais en théâtre ? / Est-ce que tu t’y connais
en peinture ? / Est-ce que tu t’y connais en art ? / En littérature ? / […] /
Non ? Eh bien ça n’a aucune importance… / Pour toi ça n’a
aucune importance / Et encore moins pour nous / […] /
Ce qu’il y a de plus important au monde / Ca aurait pu être / Le théâtre… /
Ca aurait pu être / La peinture / Ca aurait pu être… / L’amour / […] /
Le monde a besoin d’une fille docile
prête à faire des ménages le dimanche /
Sous-payée /
Le monde a besoin d’une fille prête à se faire baiser /
Le monde a besoin d’une fille qui sait compter jusqu’à dix /
Pas d’une espèce de comédienne à la con ! » 401 ’
Dans ce monde sinistre et désabusé,
une lueur d’espoir vacille encore néanmoins, l’humour.
A la séquence XVI, l’une des fées chante
en prenant la webcam pour un micro.
Son visage, déformé par le gros plan se reflète donc sur les murs
de la salle de bain, tandis qu’elle chante, ou plutôt miaule
avec une voix de fausset les paroles de la chanson de Nick Cave,
Death is not the End, qu’elle tente de traduire, mal, à contretemps :
‘« Quand tu es triste et que tu te sens seul… /
Et que tu n’as pas d’ami… / Souviens-toi que la mort n’est pas la fin !/
[…] /Refrain : / […] /
Pas la fin ! Pas la fin ! / Souviens-toi, que la mort n’est pas la fin ! / […] /
Quand tu…/ Et que… tu ne…/ Souviens-toi que la mort n’est pas la fin! /
[…] / Quand les cités sont en feu… /
Avec la chair des hommes qui brûle… /
Souviens-toi que la mort n’est pas la fin ! » 402 ’
L’effet comique de cette séquence, naît du contraste entre le désespoir des paroles et les difficultés de la fée à chanter correctement les paroles, et est en quelque sort décuplé par le fait même qu’il ne masque que mal combien l’autodérision n’est qu’un maigre cache-misère face à l’étendue du désastre politique.
Et le spectacle est émaillé de ces effets comiques plus ou moins consistants, mais qui tous renvoient au même constat.
Au-delà de ce spectacle, le théâtre postpolitique, reflet d’un monde contradictoire et d’artistes englués dans un monde individualiste et qui ne peuvent plus concevoir l’engagement politique, se fait volontiers commentaire méta-discursif de sa propre impossibilité à changer le monde et même à le représenter.
Notes
401.
Ibid., pp. 50-51.
402.
Ibid., pp. 47-49.
Partie I. Chapitre 4. 1. d.
Dire le refus de dire le monde :
Les Marchands. (J. Pommerat.)
Un certain nombre de spectacles qui abordent des questions sociales
et sont porteurs d'une critique à teneur politique potentielle théorisent
désormais l'impossibilité de représenter le monde contemporain.
C'est pour cette raison essentiellement qu'ils s'inscrivent dans une relation ambivalente au théâtre épique, et que ce théâtre postpolitique s'appréhende avant tout dans sa tension dialectique à l'égard du théâtre épique brechtien.
Le spectacle de Joël Pommerat, Les Marchands 403 ,
nous paraît manifeste de ce théâtre post-épique. Le rejet de la focalisation sur un personnage-héros dont le spectateur suivrait la trajectoire est maintenu, de même que sont multipliés les procédés de distanciation.
Mais le discours critique qui est tenu, sur la question du travail notamment, est défini essentiellement par la négative, par un ensemble de négatives plus exactement, sans qu'un propos cohérent puisse en définitive être synthétisé.
‘« La voix que vous entendez en ce moment, c’est ma voix. /
Où suis-je à l’instant où je vous parle ça n’a aucune importance /
Croyez-moi. / C’est moi que vous voyez là, /
Voilà là c’est moi qui me lève / C’est moi qui vais parler… /
Voilà c’est moi qui parle… » 404 ’
Le spectacle construit un décalage
entre la réception auditive et visuelle pour le spectateur,
entre la parole en voix-off d'un personnage-narrateur féminin,
et des scènes muettes
entre les personnages qui peuplent l'univers de ce personnage (son amie, la famille de son amie, la jeune femme timide, les collègues de travail, etc.),
au travers desquels un certain monde du travail est donné à voir,
puisque toutes les vies tournent autour de l'usine Norscilor,
et les destins individuels autour de celui de l'usine.
La narratrice parle ainsi de « [s]a vie d'employée à Norscilor » 405 ,
et c'est parce que l'amie de la narratrice n'est pas employée dans l'usine
qu'elle dérive et voit des revenants.
De même, c'est pour sauver cette usine menacée de fermeture - et donc
y appartenir d'une certaine manière - que l'amie va tuer son fils. 406
La narratrice n'agit que très peu en tant qu'individu autonome,
c'est son amie qui prend en main le destin de l'usine
alors même qu'elle n'y gagnera rien,
et cet acte témoigne davantage d'une folie
que d'une conscience de classe aiguë et libératrice.
Notes
403.
Spectacle créé au TNS en janvier 2006.
404.
Joël Pommerat, Les Marchands, Arles, Actes Sud Papiers, 2006, p. 7. Nous figurons ici le passage à la ligne par un slash pour des raisons de place.
405.
Ibid, p. 28.
406.
Ibid, pp. 38-40 et pp. 45-46.
Partie I. Chapitre 4. 1. d. i.
L’impossibilité des personnages à se dire et à monter en généralité
La parole de la narratrice, elle, ne procède jamais à une montée en généralité et ne construit aucun discours critique globalisant.
Elle ne manifeste aucune conscience de classe, même la conscience de soi semble lui faire défaut, aucune prise de distance réflexive à l'égard de ce qui lui arrive, et ces manques paraissent liés à son impossibilité à dire – et donc à mettre à distance – ce qui lui arrive.
Ainsi elle ne parvient à mettre aucun mot sur l'événement qui se produit alors qu'elle est seule avec le fils de son amie, et que le spectateur ne peut manquer, lui, de mettre en relation avec l'annonce faite par la narratrice qu'elle est enceinte, à la fin du texte :
‘« Un jour qui suivit / alors que j'étais de nouveau seule avec le soi-disant
fils de mon amie, / il arriva encore une fois quelque chose, / que je ne pus
m'expliquer vraiment, / mais qui n'était pas tout à fait rien non plus. /
Je ne sus pas vraiment mettre des mots sur l'événement, / n'étant pas
tout à fait sûre qu'il se soit vraiment passé quelque / chose. /
Je ne pus donc pas trouver les mots ensuite / pour en parler avec
mon amie / alors que je sentais bien que cela avait été nécessaire. /
Ce blocage / de ma parole / me parut catastrophique. » 407 ’
C'est la seule occurrence où la narratrice ébauche un discours sur ce qui lui arrive, et ce discours dit l'incompréhension de sa propre situation.
Plus globalement, hormis celle de la narratrice, la parole des personnages est toujours indirecte, et leur mutisme renvoie à leur aliénation et à leur incapacité à se dire.
Notes
407.
Ibid, p. 27. Nous figurons le passage à la ligne par un slash.
Partie I. Chapitre 4. 1. d. ii.
Démultiplication des filtres
qui obscurcissent l’accès
à la parole politique,
et vacuité de la parole directe.
La seule parole directe - exceptées les onomatopées et les échos de la voix-off amplifiés par micro mais qui ne donnent à entendre que des bruits inarticulés - ce sont des chants sirupeux, celui des parents morts de l'amie, quand ils lui apparaissent, ou celui du parent de l'amie.
Ce dernier personnage constitue l'unique relais des autres avec la sphère politique institutionnelle comme avec un discours critique sur le monde :
‘« Je l'avoue bien volontiers la politique ne me passionnait pas / mais un jour il y eut de petites élections / et un homme que nous connaissions un peu car il était un parent / éloigné de la famille de mon amie se proposa. / Il se rendait chez les gens / pour leur présenter ce qu'il appelait / ses intentions / au cas où il serait élu. / Nous étions très flattés / car c'était la première fois que nous risquions de connaître un / homme politique. / C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire / qui avait d'énormes talents que nous avions eu l'occasion / d'apprécier à maintes reprises. / Il avait un pouvoir d'animateur formidable / et c'était un vrai passionné. » 408 ’
C'est en tant qu'il est tenu par un parent, en vertu des liens familiaux donc, que le discours politique est approché par des personnages a priori définis par leur écart à la politique - comme sphère, comme type de préoccupation, comme type de personnes, comme type de discours. Après l'accident à l'usine, le « parent » est le seul à tenir un discours d'interprétation globale de l'événement qui le sorte de la tragédie pure pour en faire un objet politique :
‘« Il nous apprit que / la catastrophe qui venait de se dérouler / pourrait être suivie d’une catastrophe encore bien plus grande. / Il n’était pas certain que l’usine puisse rouvrir un / Jour / Non / Pas certain. / Il se trouvait qu’en très haut lieu des personnages / qui ne connaissaient sans doute pas bien la vie / avaient décrété / que notre entreprise était devenue dangereuse… / Il se trouvait que d’autres individus encore plus mal intentionnés / Reprochaient également à cette entreprise / De produire des matières suspectes / Comme par exemple / Des matières permettant la fabrication / D’armes violentes / Et radicales. / Pardon mais / C’était vraiment faux ! / Nous n’avions tout de même pas inventé la guerre / La cruauté, la violence. / […] / Aujourd'hui ils ont tué quatre-vingt personnes / mais ils en nourrissent vingt mille aussi. / Voilà ce que disait le parent de mon amie. / Nous étions choqués. » 409 ’
L'emploi du style indirect libre et de la première personne du pluriel laissent planer un doute quant à l'énonciateur de la tirade, et suggèrent un temps que ce sont la narratrice et les autres ouvriers de l'usine qui s'élèvent contre les arguments en faveur de la fermeture de l'usine, dans un procédé d'enchâssement de la parole. Seules les deux dernières phrases établissent avec certitude l'identité de l'énonciateur – le parent de l'amie – et renvoient les autres personnages à leur mutisme caractéristique, le rendant aussi choquant pour le spectateur que ces personnages sont choqués par l'événement. Et c'est parce qu'il interprète l'accident et le constitue en objet politique, et non en simple « catastrophe », que le parent propose ensuite de lutter contre ce qui paraît aux autres inéluctable : « Le parent de mon amie dit qu'il allait se battre. / Il en appelait à réunir toutes nos forces. / C'était un combat pour la vie. / Pour sauver la vie donc / sauver notre travail. » 410
A l'inverse de ce comportement, le comportement de l'amie de la narratrice, qui converse avec les morts et recherche des ressemblances entre les gens 411 ,
manifeste son besoin désespéré de trouver du sens et de la cohérence au monde dans lequel elle vit.
Notes
408.
Ibid, p. 26. Nous figurons le passage à la ligne par un slash.
409.
Ibid, p. 30.
410.
Ibid, p. 31. Ici encore, nous figurons le passage à la ligne par un slash.
411.
Ibid, pp. 15-16. Même chose.
Partie I. Chapitre 4. 1. d. iii.
Mise à distance critique
de l’aliénation des personnages, ou fable poétique ?
Le comportement des personnages, allié au procédé scénique de dissociation de la parole et des gestes, concourt donc en définitive à la description de personnages aliénés, et partant, incite à la construction d'une vision surplombante du spectateur. Mais, si l'attitude des personnages est mise à distance par la dramaturgie et l'écriture scénique tout ensemble, et présentée comme manifestation implicite d'une aliénation, la pièce et le spectacle manifestent le refus de dire le monde et de tenir un propos tranché comme l'incrédulité face au pouvoir de la lutte politique. D'une part, le personnage de l'homme politique échoue à faire changer les choses, c'est l'acte meurtrier de l'amie, et plus encore l'entrée en guerre de la France - bien que les personnages ne saisissent pas la hiérarchie des motifs, énième preuve de leur incompréhension du monde - qui remettent en question la fermeture de l'usine :
‘« On nous annonça / qu'après un temps qui serait même / le plus rapide possible / l'activité de l'entreprise Norscilor / allait reprendre./ Ce jour-là on s'autorisa à penser que l'acte de mon amie qui nous / avait tant choqués / cet acte abominable de tuer son enfant avait porté ses fruits. /Il avait bien permis, /[…] de résoudre la crise et ainsi sauver nos emplois. /Comment ne pas se réjouir ? / Ce jour-là, également, par le hasard de la vie, / nous avons appris par les informations / cet autre événement : / UNE VOIX DANS LA TELEVISION. " Cette nuit donc, il était 4 h 38 du matin, dix-neuf Mirages de notre armée ont décollé de la base de Verbon-sur-Cône… A 4 h 49, nos Mirages survolaient leurs objectifs ; et à 4 h 51 les premières bombes sortaient des appareils, faisaient leurs premiers dégâts… Sur le terrain l'on commençait à dénombrer alors les premières victimes…" » 412 ’
D'autre part, dans la note liminaire, Joël Pommerat théorise le refus de la cohérence de la fable au profit de l'indécidabilité du sens, de l'imagination et du rêve :
‘« Dans Les Marchands, qui est une fable théâtrale, une histoire est racontée aux spectateurs de deux manières simultanément : la parole d’une narratrice (la seule retranscrite dans le texte ici publié) et une succession de scènes muettes mêlant les actions des différents personnages, dans différents lieux. L’écriture de cette pièce est donc constituée par l’ensemble de ces deux dimensions, qui ne seront réunies qu’à l’occasion des représentations du spectacle. Les scènes qui accompagnent, sur le plateau, le récit de la narratrice ne sont pas simplement illustratives. Elles complètent cette parole, ou la remettent aussi parfois en question. Cette parole n’est pas d’une simple objectivité, au contraire, et les faits exprimés en résonance avec elle viennent même la démentir nettement dans certains cas. Sa fiabilité n’est vraiment pas garantie. Il appartiendra au lecteur de ce livre de combler cette part encore floue pour lui grâce à l’imagination et de compléter ou même de rêver le sens de la fable. » 413 ’
L'imagination qui prime sur la description du monde réel, et il s'agit pour le spectateur de rêver le sens d’une fable dont la fiabilité n’est pas garantie. Il y a un refus de donner une solution mais même une interprétation cohérente du réel, parce qu'il y a mise en doute de la notion même de réalité. On pourrait qualifier de brechtienne la démarche de J. Pommerat, selon la lecture qu'a fait Althusser de Brecht dans « Le Piccolo, Bertolazzi et Brecht. Notes pour un théâtre matérialiste » 414 ,
au sens où le spectacle construit une dialectique infinie du sens qui ne s'épuise pas à la fin de la représentation, mais la mise en doute de la réalité même constitue une différence radicale d'avec le théâtre épique. Cette évolution est particulièrement visible dans le traitement que fait J. Pommerat de la question du travail. Concrètement, le travail de la narratrice est d'emblée perçu par le spectateur comme une cause de souffrance puisque le personnage porte un corset. D'ailleurs elle en a conscience, relativement : « Ce petit problème touchait ma santé / Et il était lié sans doute / A mon activité professionnelle. / Dès que je rentrais chez moi / Après le travail / Une certaine souffrance commençait alors à se manifester / Et j’aurais hurlé je l’avoue. » 415
Mais, loin d’être perçu comme la cause de sa souffrance, le travail est surtout vécu par ce personnage comme une chance que cette souffrance pourrait lui faire perdre : « Bien sûr pour m'aider, il m'était bien facile de penser à toutes les personnes qui étaient, /elles, / privées d'emploi / et qui n'avaient pas la chance que j'avais moi de travailler… / J'y pensais / et cela m'aidait » 416
Le travail est présenté comme une chance comparativement à ceux qui n'ont pas de travail, mais aussi comme un bien en soi, en tant que source de sociabilité : « Je serais restée à la maison, et ma place aurait été perdue, / Car c’est ça la vie… / Je n’aurais eu plus qu’à compter les mouches sur le parquet, / Pendant que les autres auraient continué leur vie à l’entreprise / Sans moi. / Voilà le plus terrible, / C’est quand je pensais à ça. » 417
Le travail est donc pensé par le personnage comme une source de bonheur et la conséquence d'une chance : « J'étais tellement heureuse d'avoir / ce travail qui me tenait debout / qui m'aidait à bien me tenir droite /et à me respecter. / Je mesurais vraiment bien la chance que j'avais. / Depuis l'enfance, / personne ne sachant vraiment dire pourquoi. » 418
Certes, étant donné que ce personnage porte un corset, l'image de la rectitude est comprise par le spectateur comme la marque d'une ironie de l'auteur quant à l'absence de conscience politique du personnage. Pourtant, l'amie souffre de ne pas avoir de travail, et le bonheur qu'éprouve la narratrice à travailler est réel. L'homme politique théorise d'ailleurs la nécessité philosophique du travail pour l'homme :
‘« Le parent de mon amie me consola. / Il me dit que tout le monde avait besoin de travail / Que tous les hommes avaient besoin de travail / Comme de l’air pour respirer./ Car me dit-il si l’on prive un homme de son travail on le prive de respirer. / A quoi pourrait bien servir notre temps nous dit-il si nous ne l'occupions pas principalement par le travail ? / Car notre temps sans le travail ne serait rien, ne servirait à rien même. / Nous nous en apercevons bien lorsque nous cessons de travailler. / Nous sommes tristes. / Nous nous ennuyons. / Nous tombons malades. / Oui. / Le travail est un droit mais c'est aussi / un besoin, / pour tous les hommes. / C'est même notre commerce à tous. / Car c'est par cela que nous vivons. / Nous sommes pareils à des commerçants, / des marchands. / Nous vendons notre travail. / Nous vendons notre temps. / Ce que nous avons de plus précieux. / Notre temps de vie. / Notre vie. / Nous sommes des marchands de notre vie. / Et c'est ça qui est beau, / Qui est digne et respectable / Et qui nous permet / surtout / de pouvoir nous regarder dans une glace avec fierté. » 419 ’
Un doute plane quant à l'univocité du discours de ce personnage ou du moins de l'interprétation à faire de ce discours. Si le crédit à accorder à la première partie est indubitable, plus ambigu est le sens de la seconde, et notamment de l'assimilation par glissements successifs de l'affirmation « nous vendons notre travail » à l'idée que « nous sommes les marchands de notre vie. »
En effet cette dernière affirmation du personnage pourrait tout à fait faire l'objet d'un jugement distancié de l'auteur ou du spectateur. Si Joël Pommerat n'y donne pas directement son point de vue sur le travail, le dossier pédagogique du spectacle témoigne quant à lui de la volonté de porter un discours beaucoup plus complexe et profond sur cette question, et convoque pour ce faire de nombreux ouvrages.
Notes
412.
Ibid, p. 48. Nous figurons le passage à la ligne par un slash.
413.
Ibid, p. 5.
414.
Louis Althusser, « Le Piccolo, Bertolazzi et Brecht. Notes sur un théâtre matérialiste » (Maspero, 1965) in Pour Marx, avant-propos de Etienne Balibar, Paris, La Découverte, 1996, pp. 148-149.
415.
Ibid, p .14. Nous figurons le passage à la ligne par un slash.
Ibid, p. 5.
416.
Ibid, p. 24.
417.
Ibid, p. 14.
418.
Ibid, p. 10.
419.
Ibid, pp. 31-32. Nous figurons chaque passage à la ligne par un slash.
Partie I. Chapitre 4. 1. d. iv.
Une réflexion sur le travail ?
Hétérogénéité du texte
et du para-texte
Dans le dossier de presse, les textes de Simone Weil interrogent la condition ouvrière et font de l'absence de conscience de soi et de classe de certains ouvriers la conséquence d'un travail aliénant :
‘« L’ouvrier ne sait pas ce qu’il produit, et par suite il n’a pas le sentiment d’avoir produit, mais de s’être épuisé à vide. Il dépense à l’usine, parfois jusqu’à l’extrême limite, ce qu’il a de meilleur en lui, sa faculté de penser, de sentir; de se mouvoir ; il les dépense, puisqu’il en est vidé quand il sort ; et pourtant il n’a rien mis de lui-même dans son travail, ni pensée, ni sentiment, ni même, sinon dans une faible mesure, mouvements déterminés par lui, ordonnés par lui en vue d’une fin. Sa vie même sort de lui sans laisser aucune marque autour de lui. L’usine crée des objets utiles, mais non pas lui, et la paie qu’on attend chaque quinzaine par files, comme un troupeau, paie impossible à calculer d’avance, dans le cas du travail aux pièces, par suite de l’arbitraire et de la complication des comptes, semble plutôt une aumône que le prix d’un effort. L’ouvrier, quoique indispensable à la fabrication, n’y compte presque pour rien, et c’est pourquoi chaque souffrance physique inutilement imposée, chaque manque d’égard, chaque brutalité, chaque humiliation même légère semble un rappel qu’on ne compte pas et qu’on n’est pas chez soi. » 420 ’
Le travail, à tout le moins le travail à l'usine, est donc présenté comme un espace-temps d'aliénation, et par opposition, le temps de non-travail, y compris potentiellement le temps de non-travail non-voulu, est donné à penser comme le temps d'un épanouissement, d'autant plus à mesure que ce temps s'accroît et ne constitue plus un simple temps de récupération nécessaire à la survie du travailleur :
‘« À mesure, en effet, que s’étendent les plages de temps disponible, le temps de non-travail peut cesser d’être l’opposé du temps de travail : il peut cesser d’être temps de repos, de détente, de récupération ; temps d’activités accessoires, complémentaires de la vie de travail ; paresse, qui n’est que l’envers de l’astreinte au travail forcé, hétéro-déterminé ; divertissement qui est l’envers du travail anesthésiant et épuisant par sa monotonie. À mesure que s’étend le temps disponible, la possibilité et le besoin se développent de le structurer par d’autres activités et d’autres rapports dans lesquels les individus développent leurs facultés autrement, acquièrent d’autres capacités, conduisent une autre vie. Le lieu de travail et l’emploi peuvent alors cesser d’être les seuls espaces de socialisation et les seules sources d’identité sociale ; le domaine du hors-travail peut cesser d’être le domaine du privé et de la consommation. De nouveaux rapports de coopération, de communication, d’échange peuvent être tissés dans le temps disponible et ouvrir un nouvel espace sociétal et culturel, fait d’activités autonomes, aux fins librement choisies. » 421 ’
La réflexion sur le non-travail suscite donc une interrogation sur le travail en tant que forme et condition de la sociabilité :
‘« Tentons de comprendre si c’est le travail en soi qui est générateur de lien social ou s’il n’exerce aujourd’hui ces fonctions particulières que « par accident ». Réglons d’un mot la question de la norme : dans une société régie par le travail, où celui-ci est non seulement le moyen d’acquérir un revenu, mais constitue également l’occupation de la majeure partie du temps socialisé, il est évident que les individus qui en sont tenus à l’écart en souffrent.
[…] Mais, nonobstant la question de la norme, le travail est-il le seul moyen d’établir et de maintenir le lien social, et le permet-il réellement lui-même ? Cette question mérite d’être posée, car c’est au nom d’un tel raisonnement que toutes les mesures conservatoires du travail sont prises : lui seul permettrait le lien social, il n’y aurait pas de solution de rechange. Or, que constatons-nous ? Que l’on attend du médium qu’est le travail la constitution d’un espace social permettant l’apprentissage de la vie avec les autres, la coopération et la collaboration des individus, la possibilité pour chacun d’entre eux de prouver son utilité sociale et de s’attirer ainsi la reconnaissance. Le travail permet-il cela aujourd’hui ? Ce n’est pas certain, car là n’est pas son but, il n’a pas été inventé dans le but de voir des individus rassemblés réaliser une oeuvre commune. […]
Si le travail ne fonde pas par nature le lien social, alors peut-être devrions nous réfléchir au système qui pourrait s’en charger, et de manière plus efficace que le travail. Mais auparavant, sans doute est-il nécessaire de s’entendre sur la notion de lien social. Quelle est notre conception du lien social pour que nous puissions aujourd’hui considérer que le travail est sa condition majeure ? Quel type de représentation en avons- nous pour que le lien établi par le travail – qui relève plus de la contiguïté que du vouloir-vivre ensemble – soit confondu avec lui ? Nous sommes les héritiers de la représentation léguée par l’économie et que nous voyons à l’œuvre chez Smith d’abord, chez Marx ensuite. » 422 ’
Comme dans le spectacle, la parole est réfractée et le discours indirect, mais dans le dossier pédagogique Joël Pommerat procède par juxtaposition de citations qui tissent une réflexion philosophique profonde sur le travail, dont on peut présumer qu'elle est celle de J. Pommerat, qui est l'auteur du montage-collage des citations. Certains éléments de ce discours sont distillés dans le spectacle, mais de manière non synthétique, et l'on ne peut pas à proprement parler qualifier ce dernier de spectacle dialectique, en ce que les différentes conceptions du travail n'y sont pas présentées comme des modèles contradictoires qui s'affrontent. Tout comme il y a un décrochage entre la parole - la voix-off linéaire - et les personnages représentés sur la scène, il y a décrochage entre le discours du dossier pédagogique et le propos, ou plus exactement le non-propos, tenu dans le spectacle. Par citation interposée, J. Pommerat récuse un art de loisir qui serait hors du sens de l'Histoire et revendique un art comme lecture de l'aujourd'hui, qui à la fois s'inscrive dans l'Histoire et propose un point de vue sur elle :
‘« Si l’art se veut une lecture de l’aujourd’hui, s’il entend proposer un point de vue sur l’Histoire dans laquelle il s’inscrit, pourquoi la plupart des démarches artistiques contemporaines s’acharnent-elles à travailler des dimensions de l’imaginaire qui ne trouvent leurs formes que dans le temps du non-travail, dans le temps libre ? […] Si l’art ignore le temps et le champ de la production de l’Histoire, faut-il en déduire que son champ d’interrogation se limite au temps et au champ de la consommation, au temps et au champ de la détente, du plaisir ou de la jouissance – une détente, un plaisir et une jouissance qui s’opposeraient à la peine et à l’aliénation du travail ? […] L’art resterait-il coupé de l’Histoire, accroché aux seules filiations de l’histoire de l’art ? Une histoire qui continuerait son évolution sans prendre en compte les effets que les récentes mutations économiques ont pu avoir sur nos existences ? Une histoire parallèle, inconsciente des conditions historiques et des nouvelles données de l’expérience? Se maintenir en dehors de l’Histoire de la croissance et du temps de travail, dans ses questionnements et ses interrogations, revient à s’assigner consciemment ou inconsciemment une place, ou plutôt une plage, spécifique dans l’Histoire : celle du temps libre. Faut-il alors se résoudre à l’idée d’un art du temps libre ? » 423 ’
Davantage que la représentation d'un monde contradictoire ou la confrontation de points de vue contradictoires sur le monde, le spectacle de J. Pommerat nous paraît en lui-même ambivalent et contradictoire. Il met en scène des personnages aliénés et, par la dramaturgie et l'écriture scénique, incite le spectateur à la mise à distance de leur parole, mais refuse de poser, même en les affrontant, des discours globalisants cohérents, et refuse d'accéder au discours politique proprement dit, alors même que l'auteur théorise dans son dossier pédagogique une réflexion sur le travail et assume dans des entretiens l'appellation « théâtre politique ». Et la multiplicité d’interprétations contradictoires suscitées par le spectacle, et dont le seul point commun réside dans le fait que leurs auteurs ont apprécié le spectacle, nous paraît manifester cette polysémie du spectacle, qui confine à l’équivocité.
Notes
420.
Simone Veil, La Condition ouvrière, Paris, Gallimard, 1951. Cité dans le dossier pédagogique du spectacle Les Marchands, p. 16.
421.
André Gorz, Métamorphoses du travail, Folio Essais, 2004, pp. 151-152. Cité dans le dossier pédagogique des Marchands, p. 11.
422.
Jean-Charles Massera, Amour, gloire et CAC 40, Paris, P.O.L., 1999, pp. 326-327. Cité dans le dossier pédagogique des Marchands, pp. 12-14.
423.
Idem.
Partie I. Chapitre 4. 1. d. v.
Des réceptions contradictoires
autorisées par un spectacle équivoque
Un grand nombre de critiques voient dans Les Marchands l'alchimie réussie des préoccupations artistiques et politiques :
‘« Avec Les Marchands qui, un peu plus d'un siècle après les Trois Soeurs de Tchekhov, examine ce qu'il reste de la valeur travail, Joël Pommerat réussit une alchimie rare entre scène politique et théâtre d'art. » 424 ’
C'est le questionnement sur son propre engagement et sur les possibilités de l'art que les critiques apprécient chez Pommerat, la complexité formelle, énonciative surtout, servant à leur yeux un propos dialectique, fin et nuancé :
‘« Comment représenter ce que l’on vit aujourd’hui ? » Cela n’a rien d’évident. Personne ne veut esquiver la réalité mais la représenter sans recul ? Un questionnement d’importance puisque le risque est que l’objet du débat ne porte que sur le sujet, ignorant l’écriture ou faisant fi de la forme. « Cela ne suffit pas de créer pour « la bonne cause. » De dire que la guerre c’est moche ou le capitalisme c’est pourri. Cela ne suffit pas pour faire du théâtre. La question de l’engagement dans un art lui-même engagé n’est pas simple. Faire du théâtre pour ceux qui sont d’accord par avance, n’a aucun intérêt. On ne peut pas dire que l’art agit concrètement sur le monde. Il peut aider à le comprendre ». Plutôt que d’esquiver ce questionnement, Pommerat le prend à bras-le-corps : « Troubler son point de vue en tant qu’auteur, c’est presque une stratégie pour convaincre. Dans mes pièces, il est impossible d’identifier d’où je parle. Car il s’agit de révéler les contradictions. Épouser une pensée qui n’est pas mienne, voilà qui est intéressant. » Pommerat assume « l’étiquette » de théâtre politique « comme l’est celui de Shakespeare, sans restriction ni limitation. On a pourtant envie de se défaire de cette étiquette. Le théâtre raconte l’humain. On ne se place pas comme ayant un regard objectif, ce qui ne veut pas dire qu’on ne traite pas de la subjectivité, du rapport du visible et de l’invisible, ce qui ne signifie pas qu’on fait un théâtre social ou à thèse. Le poète Mahmoud Darwisch dit que pour un Palestinien, la politique est une question existentielle. Elle l’est, et pas que pour les Palestiniens ». 425 ’
La politique est une question existentielle, mais la pièce à thèse et la prétention d'aboutir à un discours interprétatif objectif sur le monde sont invalidées. C'est pour cette raison que le spectacle peut faire l'objet d'interprétations contradictoires. Sans surprise, l'Humanité voit dans le spectacle une réflexion sur le travail :
‘« Il est très étonnant, Joël Pommerat, lorsqu'il parle du travail. Il ne croit pas que travailler sauve. «Cela me touche et me révolte que l'on ne propose rien d'autres aux gens que d'essayer de les persuader que l'identité humaine ne peut se concevoir qu'à travers le travail. » Il rêve d'un monde dans lequel on ne verrait plus les ouvriers pleurer leur usine fermée, mais sourire devant la perspective d'années libres. Un peu d'idéal. » 426 ’
A l'inverse, Fabienne Darge dans Le Monde récuse tout ensemble l'appellation théâtre politique et l'idée que le spectacle traite du monde du travail :
‘« Malgré la matière qu'il travaille ici de façon riche et subtile, le théâtre de Joël Pommerat n'est pas politique. Pour couper court clairement à tout malentendu, Les Marchands ne sont pas un spectacle sur le travail et sur sa perte dans notre société. L'expérience sociale est là pour ce qu'elle représente, mais aussi pour ce qu'elle recouvre et empêche dans l'existence des êtres. » 427 ’
Ces interprétations contradictoires nous paraissent légitimées par un spectacle qui, tout en revendiquant d'aborder des questions sociales et politiques comme celle du travail, théorise l'indécidabilité du sens et le refus de porter un regard globalisant et cohérent sur le monde, construisant comme le théâtre épique une tension dialectique, mais dont la visée n'est plus politique. Le théâtre post-épique, qui théorise le refus de dire le monde, est donc aussi postpolitique et débouche sur un théâtre profondément méta-discursif, qui interroge sa propre possibilité, ses enjeux, ses limites.
Notes
424.
Maïa Bouteiller, « L'apport du vide », Libération, Mardi 11 juillet 2006.
425.
Marie-José Sirach, « À la recherche d’un théâtre politique », L’Humanité, 25 septembre 2006.
426.
Armelle Héliot, « Joël Pommerat, une éthique de la scène », Le Figaro, 20 juillet 2006.
427.
Fabienne Darge, « L'audace formelle de Pommerat », Le Monde, 22 juillet 2006.
Partie I. Chapitre 4. 1. e. i.
Dé-composition de la fable,
du personnage et du discours
sur le monde : Atteintes à sa vie. (M. Crimp/J. Jouanneau.)
i. Théâtre post- et méta-théâtre
Nous avions déjà noté la présence du commentaire méta-discursif dans Oxygène. Certains spectacles poussent le procédé jusqu’à le constituer en principe fondateur de la dramaturgie. C’est le cas dans Atteintes à sa vie de Martin Crimp 428 ,
notamment dans la séquence qui contient l’extrait que nous avions cité en introduction de cette partie. 429
Le titre même de cette séquence est évocateur, elle est « Sans titre (100 mots) » parce qu’il est impossible de prétendre à un regard définitoire, et plus encore définitif, sur l’art : « Ce que nous voyons ici, ce sont les divers objets liés aux tentatives de suicide de l’artiste au cours des derniers mois. Par exemple : flacons de médicaments, dossiers d’admission à l’hôpital, Polaroïds d’hommes séropositifs avec qui, de façon délibérée, elle a eu des rapports sans protection, morceaux de verre cassé… » 430
Cette séquence se construit sous la forme d’un dialogue entre deux voix incarnant deux voies d’appréciation de l’art, qui débattent de cette « œuvre », à laquelle l’une des voix (voix/e A dirons-nous par commodité) aurait précisément tendance à dénier ce statut, estimant que la souffrance de l’artiste ne suffit pas à ce qu’il y ait art, tandis que celle-ci constitue pour l’autre (voix/e B) une condition nécessaire et suffisante. La verbalisation du conflit confère à ce dernier un caractère humoristique :
‘« Je trouve ton commentaire frivole et inexcusable sur ce qui est manifestement une œuvre marquante. C’est émouvant. C’est actuel. C’est angoissant. C’est drôle. C’est morbide. C’est sexy. C’est profondément sérieux. C’est divertissant. C’est lumineux. C’est sombre. C’est très personnel et en même temps cela soulève des questions essentielles sur le monde dans lequel nous vivons. » 431 ’
S’il est impossible de dire avec certitude à qui M. Crimp donne sa voix, il est certain que la description de l’œuvre en question par B, qui progresse sur le mode oxymorique, revêt un caractère comique, de même que son rejet de l’œuvre « à propos » :
‘« Moi je pense qu’elle trouverait tout ce concept de « viser un propos » ridiculement démodé. Si un propos doit être visé, c’est bien le propos que le propos qui est visé n’est pas le propos et n’a en fait jamais été à propos. C’est sûrement le propos que de viser un propos est hors de propos et que tout le propos de l’exercice – c’est-à-dire ces atteintes à sa vie – vise à démontrer mon propos. Cela me rappelle le proverbe chinois : l’endroit le plus sombre est toujours sous la lampe. » 432 ’
Mais la donne se complique dans la mesure où, par un glissement méta-discursif à partir de l’exemple de cette œuvre fictive réalisée par ce « personnage » fictif Anne, l’argument du refus d’un propos paraît valoir comme justification de l’œuvre que constitue Atteintes à sa vie. Et ce propos lui-même doit être mis à distance, le sens de l’œuvre ne gît pas non plus dans ce nihilisme radical, mais dans l’infinie contradiction et l’infinie spécularité des discours, procédé accentué encore dans la mise en scène par la situation créée par Jouanneau : Les acteurs en smoking discutent, une coupe de champagne dans une main, et… le flyer du spectacle Atteintes à sa vie mis en scène par Joël Jouanneau dans l'autre. La pièce se construit autour de dix-sept scénarios de la vie du personnage féminin dont le nom échappe (Anne / Anna / Anny) comme le sens de sa vie, dix-sept tentatives (« attempts ») qui échouent à atteindre un point de vue cohérent sur le personnage et sur le monde, mais réussissent à dire une perception éclatée du moi de l’individu, de la fable théâtrale, de l’histoire et du monde, un théâtre post-moderne.
Notes
428.
Spectacle mis en scène par Joël Jouanneau en décembre 2006 au Théâtre de la Cité Internationale. En tournée à la MC2 Grenoble du 16 au 20 janvier 2007.
429.
Martin Crimp, Atteintes à sa vie, op. cit., p. 175.
430.
Ibid, p. 169.
431.
Ibid, p. 170.
432.
Ibid, p. 171.
Partie I. Chapitre 4. 1. e. ii.
Eclatement du moi individuel,
du personnage et des points de vue
sur le personnage
Dans Atteintes à sa vie, non seulement le personnage, mais les regards sur le personnage se démultiplient et se dérobent, se démultiplient parce qu’ils se dérobent, et se dérobent à force de se démultiplier.
Le titre original, Attempts on her Life, dit bien le double sens programmé par le texte, attentat contre la vie – contre l’intimité – d’un personnage féminin, attentat contre la notion même de personnage, mais aussi tentative de cerner le personnage, sa vie, sa psyché. Et la confrontation de ces deux acceptions du substantif fait émerger l'hypothèse que toute interprétation est une violence faite au réel. De fait, la dramaturgie construit la mise à distance de la notion même de personnage. La première séquence, « Tous les messages sont effacés », fonctionne comme matrice dramaturgique du texte. A travers une série de messages téléphoniques laissés sur le répondeur de Anne, un échantillon de toutes les voix, de tous les personnages, de tous les points de vue, qui s’exprimeront ensuite à propos de Anne au fil des différentes séquences est donné à lire / entendre au lecteur / spectateur. Une galaxie de personnages centripètes, dont Anne est à la fois le centre et le trou noir : un amant, un ami, un terroriste, les parents, un proxénète ou un dealer, un agent artistique. La séquence introduit également un fort suspense et une grande violence, à la fois parce que l’on se demande si Anne est effectivement morte – ce que les messages de menace (« Nous savons où tu habites petite pute […] tu vas souhaiter ne jamais être née. » 433 )
comme les messages inquiets (« Et si tu étais allongée là, Anne, déjà morte ? Hein ? C’est cela le scénario que je suis censé imaginer ? Un cadavre en train de pourrir près du répondeur ? […] » 434 )
laissent supposer. Et la séquence s’achève sur une triple incertitude : Anne est-elle vivante ou morte ? Si elle est morte, est-ce un suicide ou un meurtre ? Si elle est vivante, est-ce elle qui efface les messages, quelqu’un d’autre, ou s’effacent-ils automatiquement ?
‘« C’était votre dernier message. Pour sauvegarder tous les messages, appuyer sur « un. »
(Pause).
Tous les messages sont effacés. » 435 ’
La parole qui clôt la séquence, celle de la voix enregistrée anonyme du répondeur, laisse planer le doute sur l’intentionnalité du geste qui efface tous les messages, toutes les paroles. Or ce geste permet une tabula rasa à partir de laquelle le texte va ensuite reconstruire du sens, des sens, en même temps qu’elle ouvre sur une temporalité multiple. Si Anne est morte, tout ne sera que flash-back, si elle est vivante, la pièce sera tendue vers la volonté de retrouver le personnage. Cette séquence augure donc une construction à multiples niveaux dramaturgiques a priori exclusifs les uns les autres, mais qui en l’occurrence vont se combiner, l’objectif étant d’atteindre Anne, avec toute l’ambivalence que ce terme contient, mais aussi d’attenter aux attentes du lecteur / spectateur. 436
Tout au long du texte, la voix de Anne se fera entendre de manière indirecte, et c’est en tant que personnage qu’elle a l’occasion de dire qu’elle n’en est pas un… Paradoxe donc, puisque si son point de vue a de la valeur, c’est en tant que personnage, y compris quand elle dit n’en n’être pas un. Mais peut-être n’est-ce pas véritablement ce qu’elle dit mais simplement la façon dont sa parole est rapportée : « Elle dit qu’elle n’est pas un vrai personnage comme dans les livres ou à la télé mais un non-personnage, une absence – comme elle dit – de personnage. » 437
Le nom « Anne », qui se transforme d’ailleurs au gré des séquences (Annie, Anya…), renvoie-t-il à un référent du réel, et sur le plan intradiégétique désigne-t-il plusieurs personnages potentiels, une même personne à différents âges (« Ensuite elle veut devenir une terroriste, n’est-ce pas ? » 438 ),
les différents étages d’une conscience (sa vie réelle, ses fantasmes, ses regrets), ou plusieurs points de vue sur un même personnage ? Tout cela, son contraire aussi, et autre chose encore puisqu’il peut même désigner non pas un personnage humain mais une voiture dans la séquence 7 « La nouvelle Anny. » (« On nous informe que nos enfant seront en sécurité et heureux sur le siège arrière de l’Anny, tout comme les adultes seront relax et confiants au volant. » 439 )
La focalisation est incertaine, ainsi dans la séquence 6, le titre « Maman et papa » suggère que le point de vue est celui de leur enfant, de Anne donc. Pourtant Anne est ici encore présence-absence, personnage indirect, réfracté dans le regard d’autrui. Mais cette dernière catégorie s’avère elle-même aussi mouvante et insaisissable. En effet, l’on pourrait croire dans un premier temps que la séquence donne à entendre la parole des parents, renvoyant l’absence actuelle de leur fille à une série de fugues faites durant son enfance :
‘« - Ce n’est pas sa première tentative.
- Cela ne devrait pas être sa première tentative. Elle a déjà essayé plusieurs fois. Même avant de quitter la maison / elle essaie. » 440 ’
L’utilisation de l’article défini sans adjonction d’un complément précisant à qui appartient la maison (du type « la maison familiale » ou « la maison de ses parents ») suggère le caractère évident de cette appartenance pour l’énonciateur, et donc qu’il s’agit de la parole des parents. Mais le mode conditionnel du verbe (« cela ne devrait pas ») suggère une incertitude et une distance plus grande. Les énonciateurs oscillent au cours de la séquence entre focalisation interne, focalisation externe, et omniscience (« Une des choses qu’elle dit à sa Maman et à son Papa lorsqu’elle est enfant : « j’ai l’impression d’être un écran. » 441 ) Dans le monde post-, le théâtre-miroir se décompose en kaléidoscope de points de vue contradictoires sur le personnage, et tout comme l’art doit se redéfinir, les points de vue sur l’homme volent en éclat tout comme le monde est éclaté et violent.
Notes
433.
Ibid, p. 127.
434.
Ibid, p. 128.
435.
Idem.
436.
Nous n'évoquerons ici que le texte et non la mise en scène de J. Jouanneau, qui a fait le choix de représenter Anne à certains moments, ce qui nous paraît aller à l'encontre du sens du texte. Ce refus de rompre avec la logique d'incarnation peut se comprendre comme la volonté des acteurs, qui ont visiblement pris plaisir à incarner tel ou tel personnage, allant jusqu'à créer de toutes pièces des personnages récurrents, comme celui de la petite Kosovar et celui de l'inspecteur, parodie de Columbo.
437.
Martin Crimp, Atteintes à sa vie, op.cit.., p. 149.
438.
Idem.
439.
Ibid, p. 155.
440.
Ibid, p. 145.
441.
Ibid, p. 148.
Partie I. Chapitre 4. 1. e. iii.
Un monde éclaté et conflictuel
Le monde est présenté comme un espace violent, fragmenté, ravagé par des conflits, économiques, politiques et sociaux, à l’échelle locale comme internationale, (inter-)étatique et transnationale. Le personnage de Anne pourrait ainsi être entre autres celui d’une terroriste, d’une prostituée, ou d’une fille de classe moyenne occidentale, hippie pacifiste après l’heure et après l’âge, soucieuse de découvrir le monde, puis figure christique ou Pasionaria terroriste, en tout cas suicidaire, voulant expier en sa chair les inégalités dont elle se sent coupable au nom de sa civilisation :
‘« - Puis, la voilà partie faire le tour du monde. Une minute en Afrique, la suivante en Amérique du Sud, ou en Europe. […]
- […] avec ce même grand sac rouge.
- Et cette même chevelure qui a quarante ans lui tombe jusqu’à la taille comme si elle en avait encore vingt – comme une jeune fille, tu ne trouves pas sur / sur certaines photos.
- Même à quarante ans, son aspect et ses vêtements sont encore ceux d’une jeune fille de vingt ans.
- Mais ce qui est vraiment décisif, c’est que le sac est plein de pierres.
Ce qui s’avère être fascinant en effet, c’est que le sac s’avère être plein / de pierres.
- Les pierres sont là pour la maintenir au fond même si elle se débat, et si les anses du sac sont attachées à ses chevilles. » 442 ’
Les conflits présentés ne renvoient pas uniquement à la perception du personnage, et le tableau dressé par M. Crimp est aussi celui d’un monde en guerre. Dans la séquence « Foi en nous-mêmes » sont ainsi suggérés plusieurs conflits armés récents. Les « collines », l’évocation de « machettes » suggèrent le génocide rwandais, de même que le fait que « le frère a violé la sœur » 443
et que les enfants, devenus soldats, « regardent en riant [les morts ] […] et pourtant ce sont leurs parents. » 444
D’autres éléments ( à commencer par le nom que prend Anne dans cette séquence, « Anya », suggèrent davantage les pays de l’Est et en filigrane le conflit en ex-Yougoslavie. Dans sa mise en scène, J. Jouanneau, à qui la pièce de Crimp permet de « dire quelque chose du monde qui [l']entoure » 445
a d’ailleurs souligné cette dimension référentielle, notamment en faisant porter aux acteurs l’uniforme des Casques Bleus, et plus globalement en précisant et en actualisant un certain nombre de références au monde contemporain, en se focalisant sur la situation des plus vulnérables, qui subissent les injustices les plus atroces, les prisonniers de Guantanamo, et les femmes dont le corps est marchandisé. Ce qui a particulièrement marqué J. Jouanneau dans l'œuvre de M. Crimp, c'est la condition des femmes, et c'est pourquoi il a fait le choix, dans le spectacle, de tracer le parcours d'une jeune femme kosovar, « qui a d'abord subi les violences faites par les Serbes, puis les bombardements de l'OTAN, avant d'arriver dans un camp de réfugiés, où elle se fait finalement attraper par la mafia albanaise, et se retrouve sur les trottoirs occidentaux.. » 446
Mais l'actualisation des références au monde contemporain ne débouche sur aucun plan d'action politique. Ce que J. Jouanneau apprécie chez Crimp, c'est le fait précisément qu'il s'agit d'un « théâtre non affirmatif même si les pièces sont assez politiques » 447 ,
et que « la forme labyrinthique [du texte] correspond au monde dans lequel nous vivons. » 448
Dans la pièce, et plus encore dans la mise en scène de J. Jouanneau, le monde contemporain se présente comme les ruines d’un passé révolu qui sonne presque comme un âge d’or :
‘« - Mais à présent, c’est le désastre.
Silence.
- Comment ?
- Le désastre. L’harmonie de générations entières / a été détruite.
- Exactement. Ce monde fermé, protégé, a été anéanti.
- L’harmonie de générations entières a été détruite. » 449 ’
Tout regard cohérent sur le monde est annihilé, de même que toute possibilité de changement. Pour J. Jouanneau, « le texte propose une critique de tous les discours, discours humanitaire, politique, hollywoodien, religieux, sécuritaire. En ce sens, c'est un texte assez libertaire » 450
Pourtant, un discours existe avec toute sa force, c'est le discours médiatique, véritable filtre dans notre perception du réel. Sur scène; micros, appareil photo, caméras et écran qui projette les images vidéo représentent concrètement ces filtres. Ce discours est représenté et dénoncé (caméra qui filme les comédiens, appareil photo, micro et figure du présentateur), mais en même temps, et c'est toute l'ambiguïté du spectacle, l'on mesure combien ces références ont contaminé la représentation du monde du metteur en scène et des acteurs. Si J. Jouanneau a vu dans la pièce de Crimp et notamment dans le sous-titre, « dix-sept scénarii pour le théâtre », une « formidable incitation au mélange des genres (du policier au burlesque en passant par la comédie musicale ou la science-fiction) tout comme aux croisements des arts (de la danse à la vidéo ou au chant) », l'on ne peut que s'étonner de la pauvreté et de la concordance des références de spectacles présentes, de la série policière (le personnage du policier se situe « entre l'inspecteur Columbo et Jack Bauer » comme le précise Jouanneau), au concert de rock ou à la musique rap, en passant par le peep-show, la référence cinématographique à Mulholland Drive se résumant au rapport érotique trouble entre les deux comédiennes, l'une portant une perruque blonde et l'autre une brune. C'est pour cette raison qu'il importe de bien distinguer le texte et la mise en scène de J. Jouanneau. Malgré son caractère assez sombre, la description du monde contemporain ne débouche pas dans la pièce sur un regard nostalgique ou un désespoir absolu. Car, et c’est l’une des tensions les plus intéressantes dans le texte de M. Crimp, de ce tableau apocalyptique émerge une réflexion universelle et l’idée non d’une simple « sympathie », mais d’une « empathie » et donc d’une communauté :
‘« - […] Tout est complètement anéanti. Un mode de vie anéanti. Une relation / à la nature anéantie.
- Voilà pourquoi nous éprouvons de la sympathie.
- Pas seulement de la sympathie, mais de l’empathie aussi. De l’empathie parce que…
- Oui.
- … Parce que la vallée d’Anya est notre vallée. Les arbres d’Anya sont nos arbres. La famille d’Anya est la famille à laquelle nous appartenons tous.
- C’est quelque chose d’universel. C’est sûr.
- Une chose universelle dans laquelle nous reconnaissons, c’est étrange, nous nous reconnaissons. Notre propre monde. Notre propre peine.
- Notre propre colère.
- Une chose universelle qui, c’est étrange… Comment, comment, comment dire ?
- Qui, c’est étrange, fait renaître -
- Qui, c’est étrange, fait renaître – oui, c’est bien ça – la foi en nous-mêmes. » 451 ’
Si le monde est anéanti, l’humanité ne l’est donc pas totalement, de même que persiste une pensée de l’universalité. La progression même de la parole au cours de la séquence dit cette communauté, elle avance par collaboration entre les deux interlocuteurs, dont les répliques ne s’opposent pas mais construisent ensemble une même pensée. La séquence 5 « la caméra vous aime » met également en scène la communauté, d’une manière ambivalente, qui dépend de la lecture qu’en fait la mise en scène. En effet, si l’interprétation donne à cette séquence une tonalité ironique et cynique, cette communauté peut faire songer à la « communauté du "on" » que l’on retrouve chez d’autres auteurs britanniques contemporains, tels Gregory Motton 452 ,
une communauté qui porte atteinte au sujet et le décompose. Mais dans Atteintes à sa vie, le « on » accède à la dignité du pronom personnel et du véritable collectif, « nous », et l’on peut donc considérer, au contraire de la première interprétation, que cette communauté réaffirme l’empathie comme un besoin, au-delà du caractère factice et voyeuriste que peut comporter la démarche d’atteindre à la vie de Anne, tenter de la cerner, mais aussi attenter à son intimité, comme le fait la télé-réalité :
‘« La caméra vous aime / La caméra vous aime / La caméra vous aime / Nous avons besoin de sympathie / Nous avons besoin d’empathie / Nous avons besoin d’informer / Nous avons besoin de réaliser / Nous sommes de braves gens / Nous sommes de braves gens / Nous avons besoin de sentir / Que ce que nous voyons est réel / Ce n’est pas seulement un jeu / Nous parlons réalité / Nous parlons humanité / Nous parlons d’histoire qui va / Nous ACCABLER par l’absolue totalité / Et l’entière crédibilité de la tri-dimensionnalité / LA TRI-DIMENSIONNALITE / De toutes les choses qu’Anne peut être /TOUTES LES CHOSES QU’ANNE PEUT ETRE ! » 453 ’
L’éclatement du personnage n’est donc pas uniquement l’écho d’une fragmentation du monde et du sens, mais le signe d’une richesse infinie de potentialités, qui ouvrent donc sur un avenir, au moins imaginaire :
‘« Nous avons besoin d’imaginer / Nous avons besoin d’improviser / Nous avons besoin de synthétiser […] /Nous disons que nous voulons être/ ACCABLES par l’effarante multiplicité / OUI L’EFFARANTE MULTIPLICITE / De toutes les choses qu’Anne peut être / TOUTES LES CHOSES QU’ANNE PEUT ETRE » 454 ’
Et le principe de construction d’ensemble du texte fait également émerger ce « nous », la communauté de ceux qui tentent de comprendre Anne et de comprendre le monde, au-delà de leurs différences d’interprétations. Le texte de Martin Crimp se révèle donc très complexe, et ambivalent, en ce qu’il maintient la référence aux catégories de communauté, d’universalité, en même temps qu’il construit l’impossibilité de l’unité du point de vue sur le personnage et sur le monde et qu’il interroge les pouvoirs politiques de l’art. La dramaturgie infiniment spéculaire induit également une ironie mise au service d’un regard composite sur le monde, et non d’un regard décomposé, ce que dit d’ailleurs la note liminaire à l’intention des metteurs en scène, qui insiste sur la notion de collectif et d’unité, y compris d’ailleurs dans la construction de la mise en scène, puisque Martin Crimp convoque la notion de troupe :
‘« Pièce pour une troupe d’acteurs dont la composition devrait refléter la composition du monde, au-delà du théâtre. Chaque scénario – le dialogue – se déroule dans un univers bien distinct – un décor qui fasse au mieux ressortir son ironie. » 455 ’
Des deux positions opposées quant à la possibilité d’un personnage, d’un point de vue et d’un monde unifiés – positions dont la tension dialectique anime le texte de M. Crimp – un certain nombre de pièces et de spectacles contemporains ne conservent que celle fondée sur la dé-composition du personnage et la fragmentation des regards. La mise en scène de J. Jouanneau, qui s'achève sur une alternance de gros plans de l'œil et de la bouche d'une comédienne fardée à l'extrême et qui subit le regard de la caméra comme un viol, témoigne de cette interprétation possible du texte de Crimp. Et cette dé-composition du personnage se traduit concrètement par une perception de l’éclatement physique, preuve que l’incapacité à atteindre un point de vue unifié demeure perçue comme une violence au besoin de compréhension qui habite les humains, de même qu’elle illustre la perception d’un monde chaotique et violent en état de guerre permanent.
Notes
442.
Ibid, pp. 150-151.
443.
Ibid, p. 137.
444.
Idem.
445.
Idem.
446.
Joël Jouanneau, rencontre avec le public à l'issue de la représentation d'Atteintes à sa vie, le jeudi 18 janvier 2007 à la MC2 Grenoble.
447.
Idem.
448.
Idem.
449.
Martin Crimp, Atteintes à sa vie, op. cit., p. 137.
450.
Joël Jouanneau, entretien déjà cité.
451.
Ibid, p. 140.
452.
Au tout début de la pièce Loué soit le progrès, On retrouve cette même communauté désubjectivisée du « on », dont l’unité n’est assurée que par l’autre – en l’occurrence l’étranger – défini uniquement dans son altérité, non en tant que sujet. Sept hommes sont là, munis de pierre, qui disent chercher à repêcher un poisson tombé à l'eau – en réalité, un étranger poussé dans le fleuve. Ils se présentent ainsi : « - Monsieur Baron : Quelle sorte d’hommes êtes-vous ? - Quatrième homme : [...] L’homme ordinaire de sang et de pierres. […] - Troisième homme : […] On est juste des types ordinaires. […] - Quatrième homme : On est des voisins, la clique banale. Lui c'est le voisin, lui c'est le voisin, lui c'est le voisin et lui c'est le voisin, mon vieux. » Grégory Motton, Loué soit le progrès, in Chat et souris (moutons), Loué soit le progrès, trad. Nicole Brette avec la collaboration de Harold Manning, Paris, Éditions Théâtrales, 1999, p. 69.
453.
Atteintes à sa vie, op. cit., p. 143. Nous figurons ici le passage à la ligne par un slash.
454.
Ibid, pp. 143-144. Ici encore, nous figurons les passages à la ligne par un slash.
455.
Ibid, p. 122.
Partie I. Chapitre 4. 1. f.
Une esthétique de la violence :
Dé-composition de l’individu et du corps dans les pièces
Le Crime du XXI e siècle (E. Bond) et
Le Diable en partage (F. Melquiot.)
La remise en question de l’intégrité physique est souvent l’expression de la condition humaine contemporaine, reflet microscomique d'un monde éclaté.
Sans mener un recensement systématique des corps kaléidoscopiques et décomposés, citons deux exemples, Le Diable en partage 456
de Fabrice Melquiot et Le crime du XXIe siècle de Edward Bond 457 ,
qui mettent en scène des corps découpés, morcelés, mutilés.
Notes
456.
Fabrice Melquiot, Le diable en partage, Paris, L’Arche, 2002.
457.
Edward Bond, Le crime du XXIe siècle, Paris, L'Arche, 2000.
Partie I. Chapitre 4. 1. f. i.
Le corps, reflet d’un monde contradictoire et violent
Dans Le Diable en partage, les étapes de l'enlisement de la guerre en ex-Yougoslavie se lisent sur le corps d'Alexandre, l'ami de la famille de Lorko, enrôlé comme son ami, mais sincère et fidèle défenseur de la cause serbe. Il n'est pas anodin que ce soit lui, et non le déserteur en fuite, dont le corps porte les stigmates de la guerre. Il est d'abord privé de ses yeux par un éclat d'obus :
‘« VID. […] Y'a pas de trou dans les murs, les murs tiennent, le seul trou c'est dans tes yeux Alex, tu t'es fait péter un truc à la gueule c'est malin, l'éclat d'obus tu l'as pris où ? […]» 458 ’
Puis c'est son oreille que la guerre emporte, sans qu'il songe d'ailleurs à s'en plaindre. Progressivement le personnage d'Alexandre se décompose, mais se recompose aussi, puisqu'il devient en quelque sorte le frère siamois du frère de Lorko, Jovan, soldat lui aussi, nationaliste lui aussi, dont l'esprit va se décomposer comme le corps d'Alexandre, tous les deux partageant l'aveuglement dans la vengeance et la violence. Ces deux personnages n'en font plus qu'un, monstre physique et moral, comme si l'humain devenait monstrueux au contact de la violence du monde. Les étapes de la transformation sont en effet à chaque fois marquées par le retour vers la maison après un séjour à l'extérieur, dans le monde en guerre :
‘« Apparaissent Jovan et Alexandre, couverts de boue.
Armés.
Jovan soutient Alexandre qui rit.
Alexandre, une oreille coupée.
JOVAN. Faut l'asseoir…
ALEXANDRE. Pas besoin !
[…]
ELMA. Alex, ton oreille…
ALEXANDRE. On a faim !
[…]
VID. Faut que je note comment t'étais avant, Alex.
SLADJANA. Vid !
VID. Quel taré.
JOVAN. Bâtards ! La balle lui a arraché l'oreille. Un peu plus, il était mort.
[…]
JOVAN. Je l'ai descendu, le bâtard qui a fait ça, enfin je l'ai touché, dans la jambe, ça oui je l'ai touché, demain je le descends.
ALEXANDRE. C'est moi qui le descends.
JOVAN. Avec tes yeux, c'est pas évident.
VID. On se demande comment tu fais…
ALEXANDRE. Je suis un héros de guerre. C'est dans le sang. » 459 ’
Tout comme les différents morceaux de son corps se détachent les uns des autres, le personnage semble se désolidariser de ce qui arrive à ce dernier, et cette mise à distance génère une ironie comique.
Notes
458.
Ibid, p. 31.
459.
Ibid, p. 37.
Partie I. Chapitre 4. 1. f. ii.
L’effet comique d’une violence mise à distance par son absurdité même
Le comique de la scène s'entend à deux degrés. Le dévouement aveugle d'Alexandre à la cause nationaliste le rend insensible à son sort individuel, donc à son corps, c'est pour cela qu'il rit de sa propre souffrance, qui lui paraît dérisoire au regard du statut de héros qu'elle lui permet d'acquérir. Mais l'ironie que manifestent les propos des autres personnages et le double sens de l'expression « je suis un héros de guerre. C'est dans le sang » traduit quant à elle le ridicule de ce détachement, met à distance cette distance, en même temps qu'elle rapproche de la souffrance physique que le discours même du personnage blessé nie. Pas de héros sans sang, pas de héros sans mort. Le personnage d'Alexandre est rendu aveugle par la guerre au sens propre comme au sens figuré, tout comme il est rendu sourd aux remarques de son entourage - la question de Vid « je me demande comment tu fais » contient en effet un reproche que suggérait sa réflexion préalable « quel taré », auquel Alexandre est insensible. Cette surdité est présentée non pas comme un refus d'entendre, mais pire, comme une véritable incapacité. De même plus tard Jovan se ferme aux liens du sang et manque de violenter Elma, dans un moment d'égarement, ne voyant plus en elle qu'une musulmane et non la femme de son frère :
‘« Jovan s'approche d'Elma.
ELMA. Arrête Jovan, si tu me touches…
JOVAN. Te toucher, beurk !
Jovan avance. Elma recule, se heurte aux murs de la cave. l'ampoule électrique vacille.
ELMA. je suis Elma Ljevic. N'aie pas peur. Je veille sur toi. Tu me connais. Je t'aime comme on aime un frère.
JOVAN. Je n'ai plus de frère. Et de sœur encore moins. Tu es de l'autre côté, et de l'autre côté il n'y a qu'une brume où les corps ne sont pas comme le mien. A le serpe, à la hache, la brume je la découpe. Les corps de l'autre côté, je les connais bien, les corps de tes frères, Allah est grand comme ma poche. Enlève ta robe. Je veux voir si ton corps est comme ceux dans la brume, terne, maigre et nauséaE. Bond comme le corps de ceux que je vois de l'autre côté de mon arme.
ELMA. Tu es malade.
JOVAN. J'ai des doutes. Je vérifie.
[…]
VID. Jovan, il faut te taire.
JOVAN. Papa, regarde-moi, regarde le dessein de mes muscles et le fond de mes yeux. Que vois-tu ?
VID. Toi.
JOVAN. Un diplomate ? Un avocat ? Un médecin ?
VID. Une petite frappe.
JOVAN. Tu veux me botter le cul, botte-moi le cul !
Jovan tend un revolver à son père.
JOVAN. Botte-moi le cul !
Silence.
VID. Il n'a plus toute sa tête, mais ce geste là, il ne l'oubliera pas.
ALEXANDRE. Quel geste ? Je ne vois rien !
ELMA. Je vais le faire.
Silence.
JOVAN. Quoi ?
ELMA. Enlever ma robe.
JOVAN. Enlever ta robe ? Tu veux enlever ta robe ? Devant tout le monde ? Qu'est-ce qui te prend ? Tu es la femme de mon frère, et si mon frère savait ça, que sa femme veut enlever sa robe devant tout le monde, alors qu'on ne lui demande rien, je crois que mon frère m'en voudrait terriblement de laisser faire une chose pareille. Ces Musulmans, aucune pudeur. » 460 ’
A l'inverse de celui d'Alexandre, le corps de Jovan est intègre, mais en contrepartie lui « n'a plus toute sa tête », parce que le seul moyen pour lui de ne pas mourir est de perdre toute lucidité sur lui-même, sur ses actes, et sur la cause de ses actes, la Cause qu'il sert. Il est frappant que ces deux personnages soient les seuls à s'engager activement dans les conflits du monde, à l'inverse de Lorko qui déserte, ou du reste de la famille, qui demeure à l'intérieur de la maison, d'ailleurs présentée comme un havre de paix avant que les deux soldats ne reviennent. L'ironie des autres personnages se fait donc de plus en plus mordante à mesure que se décomposent le corps d'Alexandre et la psyché de Jovan, qu'ils se transforment et perdent l'usage de leurs sens - vue, ouïe, puis toucher pour Alexandre - comme de leur sensibilité (pour Jovan). Mais progressivement l'espace intérieur se voit contaminé par cette violence du monde extérieur qu'apportent les deux soldats :
‘« La cuisine. / Elma met la table. / Sladjana tricote. / Vid boit un verre. / Tous fument./ Soudain. / Jovan et Alexandre. / Jovan soutient Alexandre qui n'a plus qu'une main. [ 461 ]
JOVAN. Faut l'asseoir…
ALEXANDRE. Pas besoin.
SLADJANA. Mes garçons !
ELMA. Alex, ta main....
ALEXANDRE. On a faim !
SLDJANA. Embrasse-moi, Jovan, embrasse-moi !
JOVAN. Maman, je n'en peux plus.
VID. Faut que je note comment t'étais avant, Alex. Tu changes tellement vite. Je suis taré. » 462 ’
Alexandre nie toujours ses mutilations, Jovan ne peut plus embrasser sa mère, il n'est plus un enfant mais un uniquement un soldat, mais Vid estime désormais que c'est lui qui est « taré » et non plus son fils et l'ami de celui-ci. Derrière le comique pointe le désespoir du personnage du père, qui va d'ailleurs se suicider à la fin de la pièce. Alexandre lui, meurt parce que Jovan lui a lâché la main, la tête rongée par la sauterelle qu'il avait perdue :
‘« Alexandre, l'arme au poing qui lui reste ./ Avance à tâtons. / Des bombes. / Des coups de feu. [ 463 ]
ALEXANDRE. Jovan ?… Jovan, fuck you ! Jovan, donne-moi la main, je vais tomber, je ne verrai pas l'ornière devant moi et sans ta main je tomberai, oh frangin ! Je tomberai sur une mine peut-être bien si je n'ai pas ta main pour me dire : suis-moi.
[…]
Je suis un héros.
Jovan, ça gratte… Un trou dans la tête ! Là, un trou. Jovan, c'est mouillé, ça saigne on dirait… Jovan ! Oh, Jovan, j'ai retrouvé ma sauterelle ! Moi qui croyais… Jovan, elle mord, elle a les bras tordus, elle va me manger tout cru comme si je n'étais plus son maître. Jovan, écrase-là ! […] » 464 ’
Le personnage meurt de son aveuglement à se croire un héros, de son aveuglement qui le rend dépendant des voyants, et de son aveuglement à ne pas voir que la guerre rompt toutes les solidarités. Il meurt de croire qu'une fois libérée, la sauvagerie humaine - dont la sauterelle est la métaphore - peut être contrôlée, peut reconnaître et épargner ses maîtres, tout comme il meurt d'appeler Jovan « frangin » alors que pour celui-ci désormais le fait d'être un homme se mesure uniquement à l'aune de l'endurcissement, au risque de l'inhumanité :
‘« JOVAN. Tiens, tu es mort. Alexandre. Tiens, ta sauterelle ! Tu dois être super aux anges. Elle te fait des fêtes, tu sais, elle t'embrasse… Je m'étais juste caché pour que tu flippes un peu, une petite chair de poule, je te regardais de loin m'appeler et de loin je trouvais ça marrant. Te voir te cogner aux arbres et gueuler mon prénom comme si j'étais ta fiancée. Faut devenir toujours plus dur et encaisser, sinon on ne tient pas, avoir le cœur froid, j'ai pensé. Alors je t'ai laissé crier et te cogner. C'est pour son bien, faut s'endurcir… Et puis t'es tombé. Et maintenant, t'es mort. Reviens ! On va s'amuser. J'ai une arme chargée et pas peur de tuer. On a eu de bons moments, on va pas s'arrêter. La guerre, qu'est-ce qu'on en fait ? Les Croates, les Musulmans, qu'est-ce qu'on en fait ? Alexandre… Alors c'est comme ça. on ne joue plus ? Un jour il neige, le lendemain on crève ? » 465 ’
Notes
460.
Ibid, pp. 68-69.
461.
Nous figurons ici le changement de ligne par un slash.
462.
Ibid, p. 49.
463.
Nous figurons ici aussi le changement de ligne par un slash.
464.
Ibid, pp. 76-77.
465.
Ibid, pp. 77-78.
Partie I. Chapitre 4. 1. f. iii.
Théâtre postpolitique ou renouveau d’un projet critique porteur d’espoir politique ?
Pour Jovan, s'amuser c'est tuer, la guerre est un jeu pour cet enfant monstrueux, parce qu'elle ne sert à rien, et qu'il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas à quoi elle sert et la considère comme une fin en soi.
Mais, alors que la trajectoire de ce personnage a été fortement mise à distance au fur et à mesure de la pièce, sa sortie de scène pourrait faire croire qu'il est censé refléter le sentiment d'incertitude, d'incompréhension, qu'éprouvent les spectateurs face au monde chaotique et violent :
‘« Jovan enlève son treillis.
Nettoie la boue sur son visage.
Caresse les cheveux d'Alexandre.
Sort de scène, se mélange à ceux qui regardent, assis, les hommes qui tombent. » 466 ’
Le fait d'ôter son costume, de quitter la scène et surtout de se mêler aux spectateurs tend à suggérer que c'est moins la psyché individuelle du personnage qu'incarnait l'acteur qui était problématique que le monde lui-même, dans lequel les hommes tombent, un monde qui tue les hommes mais aussi l'humanité.
Mais ce constat d'un pessimisme radical est ensuite nuancé par la scène ultime de la pièce entre Lorko et Elma, ou plus exactement entre les deux acteurs qui jouaient ces personnages, sur scène encore, mais dépouillés de leurs costumes et de leur caractère fictionnel, pour rejoindre la communauté des hommes-spectateurs :
‘« Lorko apparaît.
L'homme face à la femme.
Tous deux retirent un vêtement, comme Jovan avant de quitter la scène. » 467 ’
La fin de la pièce interroge à la fois la fin de la guerre et la fin de la représentation théâtrale, le sens du spectacle de la violence, et plus précisément encore la frontière entre la scène et la salle, entre acteurs et spectateurs :
‘« LORKO. Où est-ce qu'on est ?
ELMA. A la fin.
LORKO. C'est plein de trous ici. On voit de l'autre côté.
ELMA. On va attraper la mort, à cause des courants d'air.
Silence.
LORKO. Il y a des gens qui nous regardent.
ELMA. Des passants. Ils ont vu de la lumière.
LORKO. Tout le monde est mort, il n'y a rien à voir.
ELMA. Ils attendent une chute.
LORKO. Tout le monde est mort.
ELMA. Pas nous.
LORKO. Nous on ne joue pas. Partez.
ELMA. Une chute et ils oublieront… » 468 ’
S'il y a refus d'une chute de l'histoire, c'est qu'il y a refus de représenter un monde clos sur lui même et donc en dernière instance cohérent.
Mais en même temps, tout espoir quant à l'avenir n'est pas annihilé, l'idée d'une reconstruction paraît même possible :
‘« Elma s'approche de Lorko. hésite. Ne peut pas le prendre dans les bras. Recule.
ELMA. Tu aimes ma robe ?
LORKO. J'aime toutes tes robes.
ELMA. Je l'ai mise exprès pour toi. Si tu veux, je l'enlève pour toi exprès.
LORKO. Après. On pensera à ça après. D'abord, je vais couper du bois, si je trouve un arbre.
ELMA. On va reconstruire.
LORKO. Tu crois vraiment ?
ELMA. Dépêche-toi…
Elma s'approche de Lorko.
Le prend dans ses bras.
Le serre, enfin, comme un enfant qu'on rassure.
On ne sait pas s'il pleure ou s'il sourit.
D'un piano, quelque part, montent quelques notes, si haut qu'elles se cassent la gueule.
Près des cascades, dans les champs de mine, les enfants jouent à saute-mouton. » 469 ’
Si le futur demeure envisageable sans que le pire ne soit certain, c’est peut-être précisément parce que ce dernier est possible, donc évitable. C'est parce que, même s’il peut être occasionnellement violé, et peut-être parce qu’il peut être violé, le lien interpersonnel demeure intangible, qu'il s'agisse de la relation amoureuse, explicite, ou du lien de filiation, conséquence naturelle de cette relation, suggérée en filigrane dans le texte par la référence aux enfants. L'équivocité de la dernière phrase est significative de l'ambivalence de la pièce de F. Melquiot. D'un point de vue intra-diégétique, le fait que des enfants jouent dans les champs de mine peut susciter un suspens angoissant pour le spectateur et la crainte d'une fin tragique. Mais, sur le plan métadiégétique cette fois, la coexistence des mines et des enfants peut être source d'un espoir d'ordre philosophique, celui qu'à côté du pire subsiste la potentialité d'un avenir meilleur. Le pessimisme du Diable en partage n'est pas radical ni ontologique mais conjoncturel et historique, ce qui est cohérent avec le fait que la guerre qui s'y trouve décrite est une vraie guerre, qui a réellement eu lieu, et qui aurait pu être évitée. La décomposition des personnages de soldats ne renvoie donc pas à l'ensemble de l'(in)-humaine condition mais à des choix individuels, à une vision du monde et à une manière de s'engager dans ce monde, avec lesquels l'auteur du texte manifeste sa distance et son désaccord. Le Diable en partage, écrit comme le précise F. Melquiot à Sarajevo en 2001, et dont l’action se déroule en Serbie durant la guerre entre les anciens peuples de l’ex-Yougoslavie, manifeste encore la volonté de représenter, de penser telle ou telle guerre, tel ou tel conflit, et si le texte de F. Melquiot nous paraît donc ressortir essentiellement au théâtre postpolitique, tout espoir de changer le monde n'en a pas totalement disparu. La pièce manifeste bien la porosité des différentes cités, du fait de la coexistence de visions du monde contradictoires chez un même auteur, y compris au sein d'un même texte. A ce titre, la vision du corps humain et du monde dont témoigne Le crime du XXI e siècle de Edward Bond, nous paraît à la fois plus cohérente et plus pessimiste. La pièce met en scène un « site », « espace ouvert qui a été autrefois une cour ou deux ou trois pièces en rez-de-chaussée » et se situe « dans la zone nettoyée, un vaste désert de ruines qui s'étire sur des centaines de kilomètres, entièrement rasé pour décourager toute tentative de réoccupation. » 470
Le soldat Sweden, déserteur, s'est enfui du « site » où il avait temporairement trouvé refuge, à la fin de la séquence 4, par peur que l'armée ait retrouvé son mouchard – que l'armée implante dans chaque soldat et que Sweden avait réussi à arracher de ses entrailles – et ne soit à ses trousses. Il revient séquence six, après qu'il a été rattrapé et défiguré par d'autres soldats :
‘« Sweden chancelle et tombe au sommet de la rampe. Il a les mêmes vêtements que lorsqu'il est parti mais ils sont plus sales et plus déchirés. Ses bottes sont attachées avec des ficelles. Il y a du sang séché sur le devant de sa veste, de ses jambes de pantalon et sur sa chemise blanche sale. Ses mains sont sales, la paume et le dos de ses mains sont coupés et éraflés. Ses cheveux sont encore plus en bataille et son visage livide sous la saleté. Il se met maladroitement sur ses pieds. Il n'a plus d'yeux. Deux énormes cavités ont été peintes avec de la peinture noire mat. Il ouvre la bouche pour crier mais s'arrête et elle se ferme lentement.
SWEDEN. […] L'armée a pris mes yeux. M'ont laissé sur les ruines pour effrayer les traînards - tous ceux qui se cachent. Plus facile de les tuer quand ils sortent. Donne-moi de l'eau. Ils ont peint mes yeux. A vie, s'en ira jamais. Pour que ça panique encore pire. […] » 471 ’
Comme dans Le Diable en partage, c'est le soldat, celui qui est engagé dans le monde et dans ses combats donc, qui est aveugle, qui ne peut plus voir ce monde. Mais ici, il n'est pas question d'aveuglement individuel, et l'aveuglement concret ne renvoie à aucune métaphore, puisque c'est l'armée qui est directement responsable et coupable de cet aveuglement. C'est à elle qu'incombe la faute, et dans le monde totalitaire, dont cette armée est à la fois l'instrument et le symbole, le corps de l'individu est le premier vecteur de son oppression. Après ses yeux, ce sont ses jambes que l'armée va voler à Sweden dans la séquence 9 :
‘« Sweden tire en arrière les pans de son manteau. Ses jambes ont été sciées au niveau des chevilles et leurs extrémités sont nouées dans des chiffons épais.
SWEDEN. Mutilé. L'armée.
GRIG regarde fixement en silence.
SWEDEN. Des moignons.
GRIG. Ils ont coupé - ?
SWEDEN. Il fait noir. C'est devenu noir quand ils ont pris mes yeux. Ca n'arrête pas de devenir plus noir. » 472 ’
Comme dans Le Diable en partage, l'esthétique de la mutilation rappelle celle de l’expressionnisme allemand, inspirée des gueules cassées par la Première Guerre Mondiale. Mais il s'agit moins ici d'une référence historique que philosophique, à resituer dans le contexte plus général de désenchantement du monde. La mutilation, le manque inscrit physiquement dans le corps de l'homme vaut comme preuve de l'impossibilité de la société et comme symbole de l’incomplétude et de la blessure originelle de l’homme. Cette esthétique nourrit désormais moins une réflexion historique ni un choix politique – le pacifisme ou le combat révolutionnaire – qu’un imaginaire de « l'état de guerre » 473
perpétuel. La remise en question de l’idéologie du progrès de la civilisation et de l’humanité, articulée à l’affirmation de l’échec de tout projet critique orienté vers l’action et le changement politiques, fondent un théâtre de l’échec de l’humanité, et à ce titre l'œuvre de E. Bond nous paraît constituer un paradigme du théâtre postpolitique contemporain.
Notes
466.
Ibid, p. 78.
467.
Ibid, p. 79.
468.
Idem.
469.
Ibid, pp. 79-80.
470.
Edward Bond, Le crime du XXIe siècle, trad. Michel Vittoz, Paris, L'Arche, 2006, p. 11.
471.
Ibid, pp. 43-44.
472.
Ibid, p. 77.
473.
David Lescot, « Troisième partie : Dramaturgies de l'état de guerre », in Dramaturgies de la guerre, Belfort, Circé, 2001.
Partie I. Chapitre 4. 2.
Un théâtre de l’échec de l’humanité.
L’œuvre de Edward Bond comme paradigme
« Je me tiens à l'écart de la politique des théâtres (je suis trop absorbé par le théâtre politique pour me mêler de politicailleries ». 474
On note chez Edward Bond la même opposition que chez S. Braunschweig ou M. Touré entre le politique – occupation noble – et les bassesses de la politique réduite à des relations de pouvoir et d'intérêts. E. Bond nous paraît représentatif la définitions postpolitique du « théâtre politique » (appellation qu'il revendique) qui prévaut aujourd'hui, en ce qu'il jouit d'une importante renommée en France. En témoigne la longue collaboration de ce dramaturge avec le directeur du Théâtre National de la Colline à Paris Alain Françon, qui, depuis les Pièces de guerre en 1995, met régulièrement en scène les pièces de E. Bond dans son théâtre comme au Festival d'Avignon. Les représentations de Naître à La Colline en décembre 2006 ont été entourées de nombreux débats et rencontres, qui ont mis en lumière le crédit dont l'auteur jouit non seulement auprès du monde artistique mais de l'Education Nationale et du monde intellectuel :
‘« Pourquoi étudier, lire et jouer E. Bond à l'école ? » Table-ronde en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale. Avec Pascal Charvet, Inspecteur général de Lettres et de Théâtre au Ministère de l'Education Nationale, Alain Françon, Michel Vittoz, David Tuaillon, chercheur, dramaturge, Marion Ferry, professeur de Lettres, responsable de l'option théâtre au lycée Victor Hugo. Mercredi 13 décembre 2006. »’ ‘« Débat en partenariat avec Le Monde Diplomatique, animé par Dominique Vidal, rédacteur en chef adjoint du Monde Diplomatique avec Philip S. Golub, enseignant à l'Institut d'Etudes Européennes de l'Université Paris VIII et Jean Radvanyi, directeur de l'Observatoire des Etats post-soviétiques. Ces spécialistes de géopolitique seront invités à interroger le monde à la lumière des spectacles d'Edward Bond aux côtés d'Alain Françon et de Michel Vittoz. Dimanche 17 décembre 2006. »’
L’on pourrait s’étonner qu'une œuvre d'une violence aussi grande que celle de E. Bond soit conseillée aux lycéens, de même que l'on peut de prime abord être surpris de voir des spécialistes de géopolitique invités à interroger le monde contemporain à partir d'une œuvre qui se situe délibérément dans un futur apocalyptique. L'on doit donc à la fois constater qu'il s'agit d'une œuvre de référence et s'interroger sur les enjeux de cette élection. Pour mieux comprendre l'œuvre de E. Bond, nous avons fait le choix de nous appuyer essentiellement sur le long entretien accordé au Théâtre de la Colline à l'occasion de la création de Naître au festival d'Avignon 2006 475 ,
avant d'analyser son théâtre à partir des héritages qu'il revendique et qu'il conteste, notamment celui du théâtre épique brechtien.
Notes
474.
Edward Bond, « Lettre à Adrian Noble », trad. Jérôme Hankins et Séverine Magois, in L'énergie du sens. Lettres, poèmes, essais, textes réunis et présentés par Jérôme Hankins, Montpellier, éd. Climats et Maison Antoine Vitez, 2ème édition, 2000, p. 65.
475.
Nous verrons pourquoi il nous paraît important de prendre en compte la position de l’auteur la plus récente possible, afin de prendre en compte son évolution de 1989 à 2007.
Partie I. Chapitre 4. 2. a.
Fondements post-modernes du théâtre de E. Bond :
Partie I. Chapitre 4. 2. a. i.
Un théâtre post-moderne
de l'échec des Lumières et de la raison
‘« Il y a 300 ans, c’était l’époque des Lumières. Kant dit :
« Tu dois raisonner. Tu dois réfléchir. Tu es fait pour ça et aucune autorité ne peut te dire ce que tu dois penser. »
Mais nous ne vivons plus dans l’esprit des Lumières.
Nous vivons dans l’ombre des Lumières ou dans leur crépuscule.
Au lieu de raisonner, nous calculons.
Nous ne réfléchissons pas à nos problèmes.
Nous trouvons des solutions techniques. […] » 476 ’
E. Bond s'inscrit dans une époque post-moderne, critique les Lumières, la technologie et la raison, dégradées en pur calcul, et auxquelles il oppose la logique de l'imagination : «L'imagination est plus logique que la raison. La raison clone les faits et accumule le savoir-faire pour que la science puisse rendre notre ignorance utile. Quand la raison détruit l'imagination nous devenons fous » 477
La référence au postmodernisme est revendiquée par E. Bond, mais par la négative, comme une donnée subie et non choisie, mais indubitable, et qui informe à ce titre la compréhension de son théâtre :
‘« Je pense que dans nos sociétés modernes la nature de la scène a changé. Elle n’est plus le lieu de l’idéologie. A l’époque des Grecs, la scène était un espace sacré. C’est dans son espace que l’idéologie de la société était représentée et questionnée. C’est encore vrai du théâtre de Molière ou de Shakespeare. Mais nous, nous n’avons plus d’idéologie. Nous sommes devenus des consommateurs. Ce qui reste, peut-être, c’est le postmodernisme. Le postmodernisme dit qu’il n’y a pas de définition, qu’il n’y a pas de valeurs, que tout est au même niveau. Il n’y a plus que de l’ordure en somme, un monde de junkies. Mais en fin de compte un monde fallacieux qui ne tient pas la route intellectuellement car illogique. En effet, si on affirme que la vérité n’existe pas, on a encore besoin de la vérité pour vérifier ce jugement. Donc en tant qu’idée, le postmodernisme est logiquement impossible. C’est une pratique, c’est un marché ; ce n’est pas de la liberté, c’est une forme de toxicomanie. » 478 ’
La place du théâtre a changé, parce que le monde a changé, nous dit E. Bond , parce qu'il est un monde sans idéologies, sans valeurs et sans hiérarchie. La définition qu'il donne du postmodernisme, son interprétation plutôt, que Lyotard récuserait sans aucun doute, nous paraît intéressante en ce qu’elle exprime une contradiction qui nous paraît être travaillée par une grande partie des artistes de théâtre – et des intellectuels - contemporains. E. Bond entérine et récuse d'un même mouvement la vision postmoderne du monde, et de ce fait invalide à la fois le monde existant et toute critique de ce monde, toute possibilité d'alternative donc. Et c'est pour cette raison, sans nul doute, que son œuvre se situe dans un futur apocalyptique.
Notes
476.
Edward Bond, Avignon, juillet 2006, entretien publié dans le dossier Le théâtre d’Edward Bond, publication du Théâtre National de la Colline, décembre 2006, p. 7.
477.
E. Bond, Le Crime du XXIe siècle, op. cit., p. 85.
478.
Edward Bond, Avignon, juillet 2006, entretien déjà cité, p. 5.
Partie I. Chapitre 4. 2. a. ii.
Un monde post-apocalypse.
Le double spectre de Auschwitz / Hiroshima et du marxisme
Au moment d'entrer dans l'œuvre de E. Bond, il importe de préciser qu'elle a considérablement évolué depuis les premières œuvres de la fin des années 1980, démentant par là même l'idée d'une fin de l'histoire qui annihilerait toute possibilité de changement. En 1990, E. Bond privilégie encore une représentation du monde réel, et préconise un théâtre « non transcendantal ». 479 Le titre de la pièce La Compagnie des hommes, publiée la même année, mêle par la polysémie du substantif Compagnie / Company les deux angles de réflexion économico-politique - la compagnie au sens d'entreprise - et anthropologique - interrogation des rapports au sein de la compagnie que constitue l'humanité. L'action se passe encore « de nos jours, à Londres et dans le Kent » 480 et comporte une interrogation sur le marché international, sur la dureté du monde de l'entreprise, au travers de l'histoire d'une succession qui mêle l'histoire économique et l'histoire familiale (le père PDG et le fils adoptif.) L'humanité est certes déjà présentée dans sa mesquinerie mais elle est encore analysée et non donnée à voir d'emblée comme telle. La ruine est déjà là, dans le paysage (les unités 5 et 9 se déroulent ainsi dans une « maison en ruine » 481 ), et certains cœurs humains sont déjà décrits comme des « terrain[s] vague[s] » 482 , mais la dévastation n'est présente que de manière encore sporadique. De même l'apocalypse n'y est encore évoquée qu'au conditionnel, et par le seul personnage de Bartley, ancien soldat d'un sous-marin nucléaire passé devant la Cour Martiale parce que le reste de l'équipage militaire a jugé son attitude barbare (prouvant par là-même qu'eux ne le sont pas - encore) :
‘« Une fois qu'on aurait fait sauter la planète, on s'rait plus que des corps en trop qui ont même plus d'planète à faire sauter. Les gars pourraient mal le prendre… Se r'tourner vers les officiers… Ou simplement s'imaginer qu'ils commandent durant les quelques jours qui restent. Pendant la dernière guerre, les boches se servaient des prisonniers pour gazer les youpins. De temps en temps, ils gazaient les prisonniers. […] L'équipage d'un sous-marin nucléaire, c'est comme les prisonniers. Même boulot, même salaire. » 483 ’
Dès la fin des années 1980, E. Bond estime qu'il « écri[t] dans une époque de destruction massive, inimaginable auparavant » 484 , et dès La Compagnie des hommes, le monde est un espace de différends irréconciliables et les liens inter humains en voie d'atomisation, mais le mal demeure pensé comme historique ou potentiel, au passé ou au conditionnel. Dans les œuvres ultérieures, la guerre atomique va radicaliser de manière irrémédiable la décomposition des liens et de l'humain. L'on peut dater de 1995 – avec la création des Pièces de guerre au Festival d'Avignon dans la mise en scène d'Alain Françon – le début de l'immense notoriété hexagonale de E. Bond, or cette trilogie contient en son sein le tournant de l'œuvre, qui oscille entre le discours de révolte contre la misère et de critique de la propriété encore visible dans la dernière section de la Furie des Nantis – proche par ses accents de certains textes des Manuscrits de 1844 du jeune Marx comme l'a judicieusement souligné David Lescot 485 – et la description d'un monde post-apocalyptique et d'une humanité désolée. La conception du temps va se modifier profondément, et s'instaure peu à peu une logique abstraite et futuriste qui fonctionne selon le principe d'avant / après, dont le point de référence, le « pendant », correspond à une Apocalypse irreprésentable et non représentée, au passé, mais qui hante à jamais le présent de la scène. L'espace devient alors post-apocalyptique :
‘« Le site est un espace ouvert qui a été autrefois une cour ou deux ou trois pièces en rez-de-chaussée. Il est situé dans la « zone nettoyée », un vaste désert de ruines qui s’étire sur des centaines de kilomètres, entièrement rasé pour décourager toute tentative de réoccupation. » 486 ’
Dans la mesure où ce pessimisme anthropologique n'est pas premier dans l'œuvre de E. Bond, on peut s'interroger sur ses fondements. La chronologie tend à accréditer l'hypothèse que nous émettions dans notre premier chapitre, selon laquelle c'est l'effondrement du communisme réel et par ricochet, celui du marxisme, qui vient essentialiser l'événement historique de la Shoah et de Hiroshima, l'élevant à la hauteur d'une rupture irrémédiable. Il est à noter que E. Bond insiste tout autant sur Hiroshima, fondateur de sa méfiance à l'égard de la science et de la raison autant que de la civilisation et de la société :
‘« On peut dire : la science, c’est une évolution ; l’homme, c’est une histoire. Pour Hegel ainsi que pour de nombreux marxistes, il y a entre les deux une connexion, qui est même inversable. Pour moi, cette connexion n’a jamais existé. » 487 ’
Plus encore que la référence clamée à Auschwitz et Hiroshima, c'est la rupture avec le marxisme qui, quoiqu'elle soit beaucoup moins explicitée, nous semble fondatrice de la remise en question par E. Bond de l'histoire conçue comme progrès de l'humanité.
Notes
479.
E. Bond, « Lettre à René Loyon », in L'énergie du sens, op. cit., p. 71.
480.
Edward Bond, (In the Company of men, 1990), La compagnie des hommes, trad. Malika B. Durif, Paris, L'Arche, 1992.
481.
Ibid, p. 8.
482.
Ibid, p. 49.
483.
Ibid, pp. 66-67.
484.
E. Bond, « Lettre à Gulsen Sayin », in L'énergie du sens, op. cit., p. 28.
485.
David Lescot, Dramaturgies de la guerre, op. cit., pp. 230-231.
486.
E. Bond, Le Crime du XXIe siècle, op. cit., p. 11.
487.
E. Bond, 2006, entretien déjà cité, p. 7.
Partie I. Chapitre 4. 2. a. iii.
Fin de l'histoire et présentisme
‘« Le problème est de savoir comment Babi Yar - et Auschwitz - ont pu être possibles. Les explications historiques et sociales n'expliquent rien, elles fournissent des causes qui auraient pu avoir des effets différents. Auschwitz n'a aucune histoire. Il existe toujours au présent. Auschwitz est le berceau dans lequel nous endormons nos enfants. » 488 ’
La remise en question du marxisme et la référence à l'apocalypse technologique (Hiroshima) de l'humanité (Auschwitz) nourrit un présentisme paradoxal chez E. Bond. En effet, alors que le concept élaboré par F. Hartog décrit un présent qui semble s'ouvrir sur un avenir infini de la démocratie libérale, E. Bond semble se situer dans l'envers de ce mythe et met en scène l'infinie horreur, véritable au-delà de l'apocalypse, non-temps et non-lieu dont témoigne la séquence du Crime du XXI e siècle paradoxalement intitulée « le site » :
‘« Autrefois les tyrans transformaient l'histoire mais en ce / temps il n'y avait pas de tyrans - pas d'histoire / - pas de besoin - pas d'origine / […] / L'espèce humaine mourut / Et donc des prisons furent construites / […] / Maintenant le mirage dans le désert n'est plus une oasis / de fontaines et de palmiers / Mais les gibets - les fosses - les ombres enchaînées au mur / […] / Un jour l'humanité est morte / Il n'y avait pas de futur - nulle part - pas d'origine […] » 489 ’
Le travail sur la concordance des temps et les adverbes trouble la référence temporelle et mine de l'intérieur la tentative de chronologie, de sorte que passé et futur s'invalident mutuellement, ne laissant qu'un présent qui n’a pas de fin, qui n'a plus ni terme ni sens en vue, dans un monde où la possibilité même du politique est annihilée par l'absence de lien interhumain.
Notes
488.
Edward Bond, Auprès de la mer intérieure (At the Inland Sea, 1997). Trad. Catherine Cullen et Stuart Seide. Paris, L'Arche, 2000.
489.
Le Crime du XXIe siècle, op. cit., pp. 85-87. Nous figurons le passage à la ligne par un slash.
Partie I. Chapitre 4. 2. a. iv.
Un monde post-politique
Nous avons déjà constaté l'ambivalence du rapport de E. Bond à la politique. Il manifeste le même mouvement de défiance à l’égard de l’idéologie, ce dont témoigne sa définition du terme, qu'il corrèle à la définition qu'il fait de son théâtre :
‘« L’idéologie, c’est la culture, c’est ce qui relie l’individu à la société et donne le droit à la société de tuer et autres choses de ce genre.
C’est ce qui requiert de l’individu qu’il coopère avec la société quand cette dernière l’exige.
Ce que j’ai fait, qui ne s’était encore, je crois, jamais fait au théâtre, c’est que j’ai supprimé l’idéologie. » 490 ’
E. Bond superpose idéologie, culture et société, et rejette d'un même mouvement ces trois concepts qu'il juge totalitaires en germes, et dont il détache l'individu. On mesure donc la radicalisation de sa pensée depuis les années 1980, où il disait déjà écrire « des pièces qui critiquent la société » 491
mais visait encore les défauts d'une société existante, et non le principe même de société. Les conséquences de cette radicalisation sont profondes, et les pièces les plus récentes de E. Bond se situent toutes dans un monde totalitaire dans lequel la communauté humaine est impossible, sans que l'on sache en définitive si c'est la société qui détruit l'humanité dans l'homme ou si c'est le mal présent dans l'homme qui empêche toute fondation d'un lien autre qu'intéressé ou lié à une forme de relation de pouvoir sado-masochiste. La communauté politique est tout simplement impossible, impensable même, car la nature de l'être humain a changé et que « l'hantologie » 492
tient désormais lieu d'ontologie. Dans Naître les deux types de communauté qui survivent, celle fondée sur les liens du sang (la famille) comme celle fondée sur le travail (les soldats) se disloquent, aucune solidarité ne peut jouer. Le fils n'hésite pas à trahir ses parents pour lesquels il paraît n'éprouver aucun sentiment filial, tout comme les soldats tuent l'un des leurs. La seule communauté qui semble possible est celle des morts, mauvaise conscience des vivants, témoins au sens étymologique, martyrs qui viennent rappeler la faute de l'humain – leur figuration ne peut qu'aviver le souvenir des ombres des victimes de l'explosion nucléaire sur les murs d'Hiroshima. 493
Envers de l'humanité, communauté en creux, paradoxale, réunie par ce qui sépare à jamais, le chœur des morts ne figure pas une communauté politique mais au contraire la preuve irrémédiable de ce qui empêche désormais toute fondation d'une communauté politique. Si les pièces de E. Bond décrivent des mondes où le politique s'est dissout dans un régime totalitaire, peut-on considérer ce théâtre d'anticipation comme une mise en garde, dotée d'une fonction politique par le rappel à la communauté existente de ce qui l’attend si elle ne ré-agit pas ?
La dilection de l’auteur des Enfants pour le théâtre en milieu scolaire pourrait nous inciter à cette interprétation d’un théâtre pédagogique, qui annonce le pire pour l’empêcher d’advenir. Mais Edward Bond valorise l’enfance en ce qu’elle n’est pas encore socialisée, pas encore corrompue et il creuse donc un fossé en forme de Chute de l’enfance à l’âge adulte, socialisé, civilisé – et irrémédiablement corrompu. Ce fossé est d’ailleurs fondateur du principe dramaturgique et scénique de la pièce Les Enfants 494 ,
puisqu’alors que « les rôles de la Mère et de l’Homme […] sont à interpréter tels qu’ils sont imprimés », « l’auteur affirme vouloir laisser aux enfants-interprètes la liverté d’improviser à partir des répliques données ». 495
L’expérimentation que constitue le théâtre d’Edward Bond nous semble donc se situer aux confins du théâtre politique, dans la mesure où il n’y a pas de véritable remise en question possible puisque la société totalitaire est décrite comme une « machine » dont la mise en place ne semble imputable à personne en particulier tant il y va de la faute ontologique de l’humanité :
‘« […] Il n'y a pas de justice
Il y a la machine
Elle satisfait nos besoins pour qu'il n'y ait plus de besoins
Notre faim grandit et pour la satisfaire la machine dévore la terre » 496 ’
D'ailleurs E. Bond conçoit son théâtre comme une rupture radicale avec les dramaturgies passées, tout comme le monde et l'humanité sont devenus radicalement autres :
‘« La nécessité d’un nouveau théâtre est indubitable dit Bond, car le théâtre que donnent à voir les salles actuelles s’est construit sur une vision caduque de l’homme. Bond proclame "l’ancien théâtre" défunt au sens où il ne remplit plus la fonction qui lui incombe, fonder l’humain. Il se construit sur des concepts obsolètes, qui ne sont plus aptes à dire la complexité de l’humain dans ce monde de l’Après.» 497 ’
Dans la mesure où la rupture est sur-revendiquée par E. Bond, il nous paraît intéressant d'aborder sa dramaturgie en partant de l'optique inverse, à partir des différents héritages que l'on peut y trouver, afin de nous interroger sur la réalité de la rupture et les enjeux des emprunts et resémantisations éventuels.
Notes
490.
Edward Bond, entretien déjà cité, p. 5.
491.
Edward Bond, « Lettre à Terry Hands », in L'énergie du sens, op. cit., p. 22.
492.
Jacques Derrida, Spectres de Marx. Paris, Galilée, 1993, p. 31 : « Cette logique de la hantise ne serait pas seulement plus ample et plus puissante qu'une ontologie ou qu'une pensée de l'être. […] Elle abriterait en elle, mais comme des lieux circonscrits ou des effets particuliers, l'eschatologie et la téléologie même. » Cité par E. Angel Perez, Voyages au bout du possible, op. cit., p. 206, note 23.
493.
C'est à ce titre que la gestuelle du chœur des morts dans Naître nous paraît inspirée du Butô, « danse des ténèbres » née au Japon après 1945, à partir de cette même fondation.
494.
Edward Bond, « Avant-propos », Les Enfants, in Edward Bond, traduction Jérôme Hankins, Les Enfants, suivi de Onze débardeurs, Paris, L’Arche, 2002.
495.
Il existe également une explication plus pragmatique, qui tient au fait que la pièce a été conçue par E. Bond pour tourner avec deux comédiens professionnels pour les rôles d’adultes, qui font l’intégralité de la tournée, tandis que les enfants sont des amateurs, qui changent selon les lieux, et ont de fait moins de temps pour apprendre le rôle. Mais cette explication ne permet pas à elle seule d’expliquer ce choix de l’improvisation pour les enfants, car l’on pourrait arguer du fait que les enfants sont capables d’apprendre un rôle, qu’il y aurait même un intérêt pédagogique à exercer leur mémoire. En outre, cette raison n’est pas celle revendiquée dans le texte publié.
496.
E. Bond, Le Crime du XXIe siècle, op. cit., p. 83.
497.
Elizabeth Angel Perez, « L’humain au fil de la trame : Edward Bond et la nécessité du théâtre », in Le théâtre sans l’illusion, Revue Critique n°699-700, août-septembre 2005, p. 696.
Partie I. Chapitre 4. 2. b.
La dramaturgie bondienne :
démultiplication et décomposition des héritages.
Partie I. Chapitre 4. 2. b. i.
La question de la fable et
l'héritage du théâtre aristotélicien
Au sein des dramaturgies post-, celle de E. Bond peut sembler radicale sur le plan de la conception de l'humain, mais en revanche elle est à première vue moins novatrice que d'autres sur le plan dramaturgique, puisqu'elle recourt à la structure de la fable, à la différence par exemple d'Atteintes à sa vie. Dans la mesure où E. Bond estime qu'il n’y a plus d’idéologies et de méta-récits, se pose toutefois à lui le problème du contenu de la fable :
‘« S’il n’y a plus d’idéologie sur la scène, le problème est : comment raconter une histoire ? […] Donc tout ce qu’il reste à faire, c’est à raconter une histoire qui traite de la fondation de l’humain en soi. C’est une forme de récit qui est bien plus fondamentale et les Grecs s’en sont approchés au plus près. C’est pourquoi ils ont créé ce que nous appelons aujourd’hui le théâtre. » 498 ’
Alors même qu'il s'inscrit dans la rupture anthropologique, E. Bond convoque la référence théâtrale par excellence, au prix d'une interprétation fausse de ce qu’a été le théâtre pour les Grecs puisque, précisément, il n'était pas question de fonder l'humain en soi hors de tout système politique, et que le théâtre grec a fonctionné comme socle fondant le lien politique en gestation sur des méta-récits. De la même façon, E. Bond fait une autre référence tout aussi incongrue a priori qu'instructive pour comprendre cet univers postpolitique : toujours à partir de l'évocation des Grecs, il convoque la notion d’espace public, dont il regrette la disparition, non pas dans la société mais dans l’homme :
‘« Je fais ce que disaient les Grecs, à savoir : ce qui se passe sur scène, c’est vous. Vous ne regardez pas un spectacle, la pièce est en vous, si en vous demeure un espace public. Mais cet espace public, nous ne l’avons plus, et c’est un autre problème. Nous avons privatisé le moi. » 499 ’
Que ce soit la faute de l'homme ou de la société, le fait est là, incontestable, l'homme n'est plus qu'un individu isolé, l'inverse absolu de l'athénien qui existait prioritairement dans et par sa relation aux autres. 500 Ce que E. Bond conserve de la dramaturgie aristotélicienne, ce n'est donc pas sa vocation politique mais deux éléments, le moment du renversement par un effet violent, et le principe de la catharsis, qu'il transforme et recycle – procédant d’ailleurs a un syncrétisme entre cette référence et celle, pourtant peu compatible a priori, au théâtre épique.
Notes
498.
E. Bond, entretien déjà cité, pp. 5-6.
499.
E. Bond, même entretien, p. 6.
500.
Voir à ce sujet Jacqueline de Romilly, Patience, mon cœur, (1984) Paris, Les Belles Lettres, 1991.
Partie I. Chapitre 4. 2. b. ii.
L'aggro-effect, transposition post-moderne de la catharsis ou construction contre, tout contre le théâtre épique ?
Ce que E. Bond conserve du renversement par un effet violent, c'est uniquement l'effet violent, décontextualisé, qui ne renvoie plus à un sens global de la fable mais fonctionne de manière autonome :
‘« L'aggro, en plaçant le public devant des actes horribles, odieux, ou tout simplement extrêmes, veut être une véritable agression qui - loin de ne chercher qu'à procurer une sensation forte ou un choc gratuit - vise à impliquer pleinement le spectateur en faisant appel à l'émotion, mais afin de susciter en lui une réflexion, voire un raisonnement, quant à la signification de ce qui a lieu sur scène, une analyse, voire une mise en question, de ses causes et de ses mécanismes, etc. » 501 ’
Cet aggro-effect doit donc tout autant être interprété comme référence, sous forme de rejet, au théâtre épique. G. Bas le définit ainsi comme « un procédé anti-brechtien, autrement dit l'opposé de l'effet de "distanciation." » 502
E. Bond s'oppose au théâtre épique brechtien en ce qu'il ne met pas à distance la catharsis mais la recycle, la cite, conforme en cela à l'esthétique post-moderne décrite par J.-F. Lyotard et Y. Michaud. Alors que Brecht s'opposait au théâtre aristotélicien en construisant un modèle alternatif, E. Bond renvoie dos à dos ces deux modèles comme dépassés, et les fait jouer l'un contre l'autre. Nous rejoignons ainsi les analyses de C. Naugrette sur le post-cathartique, qu'elle décèle chez E. Bond mais également dans d'autres dramaturgies post- :
‘« D’une certaine façon on pourrait dire que si la catharsis en tant que telle a effectivement disparu dans le drame, il y a aujourd’hui du cathartique – voire même du postcathartique – et que ce cathartique fait partie des matériaux recyclés par le théâtre moderne ou postmoderne, au même titre que les mythes ou les figures des héros antiques. » 503 ’
Ce qui s’apparente de prime abord à la catharsis en termes d’affects et de relation énergétique n'a plus la même fonction dramaturgique parce que le procédé ne joue plus uniquement sur le plan intradiégétique, entre spectateurs et personnages, mais engage frontalement la relation réelle qui se joue entre spectateurs et acteurs, d'être humain à être humain : « La violence n’est plus comme dans le théâtre grec ce qui permet la catharsis et le phénomène de reconnaissance, mais l’objet même de cette reconnaissance. La violence ne se constitue plus comme ce qui donne à voir, mais ce qui se donne à voir et à identifier. » 504
C'est donc au sens strict qu'il faut considérer l'affirmation de E. Bond selon laquelle « les concepts de tragédie, solution, catharsis, [sont] dépourvus de sens à présent. » 505
Il renoue avec la catharsis à ce détail lourd de conséquences près que la souffrance éprouvée par le spectateur ne provient plus prioritairement de la représentation d’un récit émouvant, mais de la mise en présence directe du spectateur avec une violence extrême montrée et non mise à distance par la médiation d’un récit orienté vers une fin. Et si E. Bond emprunte au drame aristotélicien la construction d'une fable cohérente, ce n'est pas dans l'optique de faire émerger un sens mais d'interdire le principe épique de dé-composition de la fable, d'empêcher toute attention au déroulement, et d'empêcher que fonctionne le principe épique que Benjamin avait baptisé du terme d'étonnement. 506
Or celui-ci repose sur « des enjeux déjà à l'œuvre dans La Poétique d'Aristote. A l'instar de la catastrophe aristotélicienne, le dénouement du théâtre épique est le lieu où s'esquisse ce que Paul Ricoeur nomme une « conversion du regard » 507 ,
qu'il revient au spectateur de prolonger dans le monde réel de l'éthique et de la politique » 508 ,
alors que E. Bond voudrait réduire le théâtre brechtien à un didactisme de « salle de classe » 509 ,
où la fin de la fable affirmerait un sens et clôturerait le débat. On peut mesurer tout l'écart entre son interprétation de Brecht et celle qu'en a donné Bernard Dort, qui insistait quant à lui sur l’opposition du drame épique au drame aristotélicien :
‘« Au drame clos et délimité […] l'action du théâtre épique substitue un récit continu et illimité. La chaîne des comportements et des paroles, généralement désaccordés, ne comporte pas de conclusion. […] Ici, nul apaisement définitif ne clôt l'œuvre : il n'y a ni rétablissement d'un ordre ancien, ni établissement d'un ordre nouveau, ni "réalisation du rationnel et du vrai en soi." […] Les contradictions fondamentales subsistent. Elles sont seulement devenues plus "lisibles" pour le spectateur. » 510 ’
E. Bond caricature à la fois le théâtre aristotélicien et le théâtre épique, les fait jouer l'un contre l'autre, pour mieux les faire fonctionner comme des mythes dépassés, et pour mieux détruire toute idée d'une fin de la fable. La souffrance du personnage et du spectateur est à elle-même sa propre fin, parce que la fable n'a plus ni terme ni sens.
Notes
501.
Georges Bas, « Glossaire », in Edward Bond, La Trame cachée. Notes sur le théâtre et l'Etat, trad. Georges Bas, Jérôme Hankins et Séverine Magois, Paris, L'Arche, 2003, p. 295.
502.
Idem.
503.
Catherine Naugrette, Paysages dévastés. Le théâtre et le sens de l'humain, Belfort, Circé, 2004, p. 146.
504.
Idem.
505.
Edward Bond, Lettre à Cassandra Fusco, citée par Jérôme Hankins, « La raison du théâtre selon Edward Bond : des outils esthétiques pour une nouvelle pratique de la scène », Thèse de Doctorat, Université Paris III, 2002, p. 51.
506.
Walter Benjamin, « Qu'est-ce que le théâtre épique ? », in Essais sur Bertolt Brecht (1939), traduction Paul Laveau, Petite collection Maspero, 1969, p. 29.
507.
Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 286.
508.
Hélène Kuntz, Poétiques de la catastrophe dans les dramaturgies modernes et contemporaines, Thèse de doctorat sous la direction de Jean-Pierre Sarrazac, Université Grenoble 3, 2000, tome I, p. 306.
509.
Edward Bond, entretien déjà cité, p. 5.
510.
Bernard Dort, « Pédagogie et forme épique », op. cit., pp. 195-196.
Partie I. Chapitre 4. 2. b. iii.
La faim sans fin
des pièces de E. Bond
C'est sur la question de la fin des pièces que l'on est d'abord tenté de situer le point de décrochage d'avec la dramaturgie aristotélicienne, mais une analyse de détail révèle que E. Bond rompt davantage encore avec la dramaturgie hégélienne ainsi qu’avec la dramaturgie épique. Rappelons ici encore que l’œuvre de E. Bond est à saisir dans son évolution, car sa position quant à la possibilité de représenter le monde et de s’inscrire dans l’histoire théâtrale d’un théâtre politique a évolué, ce que son œuvre récente, très cohérente, aurait tendance à faire oublier. Les premières Pièces de guerre sont encore référées à un contexte socio-historique plus ou moins précis. C’est donc sans surprise qu'elles travaillent la référence au théâtre épique et au théâtre d’agit-prop 511
comme en témoigne l’utilisation du gestus bien décrite par David Lescot. 512
Mais l’on assiste à une dé-contextualisation progressive, qui s’accompagne d’un retour dramaturgique corollaire au dramatique. Cette évolution est visible au sein même de la trilogie, entre Rouge, noir et ignorant écrit en 1984 et Grande Paix, écrit en 1990.La première pièce « oscille entre notre présent et un futur proche : le contexte social ainsi reproduit rassemble à dessein les signes de notre contemporanéité, condition sine qua non du fonctionnement de la légère anticipation présidant à la fiction d’une guerre nucléaire » 513
à l’inverse de la dernière, qui manifeste un retour au personnage et à la structure dramatique – en tous les cas à une structure non épique.
Le processus est manifeste à l’échelle de l’œuvre entière de E. Bond. Dans Café (Coffee, 1995), « E. Bond franchit un pas supplémentaire dans l’absence de notations historiques » 514
et « l’humain apparaît […] dépouillé de tout déterminisme historique, social et politique. » 515
Dans Le crime du XXI e siècle (The crime of the XXI th century, 1999), Chaises (Chair, 2000) ou Naître (Born, 2006), l’on constate ainsi le retour à une dramaturgie du drame, que l’on peut interpréter comme la conséquence de la perte de la croyance dans la possibilité de changer le monde et dans la capacité du théâtre à constituer une « propédeutique de la réalité. » 516
Mais s’il s’agit d’un retour au dramatique par opposition à l’épique, il ne s’agit pas d’un retour à la dramaturgie aristotélicienne. Parce que désormais il n’y a plus d’Histoire, donc plus d’action dramatique dont le déroulement serait tendu vers une fin. La perte de la fin et la perte du sens s’accompagnent l’une l’autre. A ce titre, la fin qui n’en finit pas de Naître est assez éloquente. Toute la séquence Cinq, qui se situe dans la même pièce que la première, peut être considérée comme une démultiplication de la fin. Le personnage de Donna a reconstitué à la fois son rôle de mère et un semblant de communauté, et donne à manger à des morts, qu'elle gâte comme elle ne peut plus gâter son fils disparu. Quand l'enfant prodigue revient, elle ne le reconnaît plus, et refuse de lui donner à manger, parce qu'il est vivant. La seule parole de Luke, « j'ai faim », correspond pourtant à la demande primordiale de l'enfant à sa mère. La mère ne veut pas, ne peut pas, combler la faim de son enfant, parce qu'à ses yeux seuls les morts ont vraiment faim. Mais même cette fragile communauté se révèle inhumaine et la mère du bébé que Luke a tué dans la séquence 3 finit par déchirer le bébé que le chœur des morts lui avaient reconstitué dans une « nativité » 517
dérisoire et touchante, parce qu'elle a faim :
‘« La Femme ouvre le poing du B é b é en le déchirant. Elle prend comme une griffe la nourriture qu'il y a dedans. L'engouffre dans sa bouche. S'enfonce la main dans la bouche pour forcer la nourriture à descendre. Ses gestes sont tendus et efficaces. » 518 ’
Cette faim renvoie bien sûr au premier degré à la misère des personnages dans un monde en état de guerre perpétuel. Mais, elle renvoie également, sur un plan symbolique, à la faim de sens qui continue d'habiter l'homme. Notons que cette faim symbolique dévorante est également à l'œuvre dans Le Crime du XXI e siècle, où elle est plus explicitement corrélée au besoin de sens et de justice :
‘« Il est juste que nous mangions mais manger ne nous rendra pas juste
Nous aurons faim de justice
Sans justice notre faim grandit jusqu'à nous faire dévorer la terre » 519 ’
Dans Naître, la faim qui anime le personnage de Luke peut être considérée comme la manifestation ultime de la faim de sens qui l'anime dès qu'il est adulte. Parce que la vie et le monde n'ont pas de sens, le personnage recherche le sens de la fin : « Je veux savoir : comment c'est à la fin ? Le corps, je sais ce qui lui arrive. Je sais tout ça. Je l'ai vu. Je veux savoir comment c'est dedans. Ce qui se passe dans la tête à la fin. Où c'est qu'on est. » 520
Et c'est cette quête acharnée du sens qui le rend inhumain, plus qu'une cruauté ontologique. C'est pour cela qu'il est amené à tuer le bébé de « la femme » d'une manière particulièrement cruelle à la séquence 3. Cet acte n'est pas un acte de violence gratuite, tout au contraire, c'est un moyen en vue d'une fin très précise : obtenir une réponse quant au sens qui pourrait surgir à la fin de l'existence d'un individu à défaut de pouvoir viser le sens de la fin de l'homme et plus encore le sens de l'humanité. L'effet comique de la persistance d'une parole de douceur en contraste absolu avec l'horreur de la situation, procédé à l'œuvre dans ces deux séquences (Luke avec le bébé, Donna avec les morts), conduit le spectateur à mettre à distance son émotion. Et cette violence qui dure, qui s'éternise, dans la séquence 3 comme dans la séquence 5, finit par désensibiliser le spectateur, par l'anesthésier pourrait-on dire, peut-être parce qu'il est placé dans le même état de choc que les personnages de mères (la mère du bébé et Donna), censément les plus humains, mais peut-être aussi parce qu'il est, par l'accumulation de violence, conduit par E. Bond sur la voie de la réflexion. C'est toute la gageure de l'esthétique bondienne, qui se situe encore dans le champ de la représentation et interroge l'humain, bien que la violence qui s’y manifeste puisse parfois paraître intransitive :
‘« Bien qu'ayant une incontestable dimension éthique et politique, ce mélange paradoxal d'émotion et de réflexion sur lequel repose l'aggro en fait un procédé risquant de provoquer malentendus ou incompréhensions. Diverses scènes de nombreuses pièces de E. Bond, tout au long de sa carrière, jugées insupportables ou scandaleuses, en sont la preuve. » 521 ’
De même la démultiplication de la fin peut tout simplement lasser le spectateur, au lieu qu'il y voie le sens profond de la pièce et de la quête de E. Bond. Car, à l'inverse de l'unicité et de l'unité de « l'événement théâtral », le sens d'une pièce comme Naître nous paraît sourdre dans le délitement de sa fin, sans espoir, qui laissent littéralement les personnages et le spectateur sur leur faim. Le personnage de Donna, affamé lui aussi, trouve une miette, microscopique, mais tangible. Possible métaphore d'un espoir en germe, celui d'un rassasiement de la faim inextinguible de l'homme par un personnage christique ?
‘« Une miette. Elle va vers la miette. La regarde par terre. Nous vivrons. Nous devons vivre ! Tous. Elle ramasse la miette. Elle est à vous - c'est pour ça qu'elle est là. Mangez-là. Ceci est la miette qui nous était promise. La tend vers les morts. Prenez-la. Mangez. Ensuite je la prendrai pour nourrir ceux qui ont faim. Je la partagerai dans le monde. Pour que tous mangent - ils ne mangent pas - si un seul d'entre vous la mange - ça suffira. Mangez-la même si c'est du poison. Mangez-la même si c'est plus amer que la faim. » 522 ’
Donna n’est pas Jésus, et toute à sa logorrhée, elle finit par perdre la miette, et quand enfin elle la retrouve et la mange, elle s'étouffe. Trop-plein ou trop peu, absence ou excès, le rapport de l'homme à sa faim, au monde, à lui-même, à l'espoir, n'est jamais adéquat. Et le personnage ne parvient même pas à mourir, ce qui mettrait un terme à cette souffrance qui s'éternise. Donna est réveillée par son mari qu'elle ne reconnaît pas, et quand enfin elle finit par mourir brusquement, sans sommation, à la dernière page, l'acte est donné au spectateur comme un non-événement, il tient en une didascalie et a lieu hors-scène : « Dehors, deux coups de feu isolés. » 523
Est-ce à dire que la mort du personnage n'est pas digne de représentation, ou qu'il est déjà mort ? Peut-être que cette démultiplication de la fin a pour fonction de déplacer l'attention du lecteur-spectateur sur sa faim de sens et sur son horizon d'attente quant à la fin d'une pièce.
Notes
511.
David Lescot, « Dramaturgies des guerres passées, présentes et futures », in Dramaturgies de la guerre, Paris, Circé, 2001, p. 218 et p. 268.
512.
Ibid, p. 219.
513.
Ibid, p. 223.
514.
Ibid, p. 224.
515.
Ibid, p. 218.
516.
Bernard Dort, « Une propédeutique de la réalité », 1968, in Théâtres, Paris, Point, 1986, pp. 275-296.
517.
E. Bond, Naître, op. cit., p. 80.
518.
Ibid., pp. 80-81.
519.
Le Crime du XXIe siècle, op. cit., p. 83.
520.
Ibid., pp. 32-33.
521.
Georges Bas, « L'aggro-effect », in La Trame cachée, op. cit., p. 295.
522.
E. Bond, Naître, op. cit., p. 88.
523.
Ibid, p. 91.
Partie I. Chapitre 4. 2. b. iv.
De l'héritage au recyclage
On le voit, qu'il s'agisse de la dramaturgie aristotélicienne ou du théâtre épique, E. Bond se situe dans une ambivalence.
C'est surtout à l'égard de Brecht que la dette s'avère problématique pour E. Bond, comme en témoigne cette lettre à Rudolph Rach :
« Vous savez que j’estime avoir subi l’influence de Brecht et il va de soi qu’il continuera de m’influencer. Mais il s’agit d’une influence au sujet de laquelle j’ai toujours éprouvé – et exprimé – un certain malaise. » 524
S'il estime le drame aristotélicien inutile et ne permettant pas de penser l'homme post- et le monde post-, il va plus loin encore concernant le théâtre brechtien, estimant qu'il peut être tenu pour coupable ou à tout le moins complice de la catastrophe. « Auschwitz, c’est le théâtre de l’effet-D [l’effet de distanciation ] tout comme le Goulag et Babi Yar » 525
et réciproquement « la distanciation, c’est le théâtre d’Auschwitz. » 526
E. Bond justifie par cet argument son rejet global de toutes formes théâtrales antérieures, de l’identification stanislavskienne comme celui de la distanciation brechtienne ou la performance artaudienne, par le fait qu’aucune d’entre elles n’a été capable d’empêcher Auschwitz :
‘« L’art de la « performance », les happenings, le rituel, le drame mystique, le cri primal, […] l’Absurde, le théâtre de la cruauté, […] recourir à l’émotion plutôt qu’à la raison au lieu de recourir à la raison (à ce que signifie la situation) pour créer l’émotion – de telles choses ont moins à voir avec l’art que l’honnêteté de cet orchestre qui jouait à Auschwitz. » 527 ’
La raison pour laquelle E. Bond s'oppose au théâtre épique brechtien, la raison pour laquelle il ne parvient pas à le lire autrement qu'en le caricaturant, c'est que la rupture entre ces deux dramaturgies se situe dans leur fondation anthropologique. La matière première de la dramaturgie épique, c'est l'homme dans ses relations aux autres et à la société, l'homme en tant qu'il est dans l'Histoire, dans un monde socio-économique en devenir et qu'il peut contribuer à changer : « Le théâtre épique s'intéresse avant tout au comportement des hommes entre eux, là où ce comportement présente une signification historico-sociale, autrement dit dans ce qu'il a de typique. » 528
Et à l'inverse la matière première du théâtre de E. Bond c'est l'individu et la société considérées comme des entités. Ce théâtre en définitive moins politique que moral voire moraliste renoue avec une logique de la faute et de la culpabilité éternelle, avec pour seule nouveauté la perte absolue et irrémédiable de tout espoir de rédemption. L'opposition entre E. Bond et Brecht devrait cependant être nuancée, dans la mesure où il nous paraît que le pessimisme anthropologique de E. Bond affleure déjà, en germe, dans certains textes de Brecht, sous forme d'une interrogation inquiète. Homme pour Homme questionne de fait la nature de l'homme et la responsabilité qu'il partage avec la société dans sa propre évolution, à travers la transformation consentie du paisible Galy Gay, qui prend l'habit et le rôle du soldat Jeraiah Jip, jusqu'à devenir tout aussi féroce et inhumain que l'original. Comme l'analyse Dort, « pour être Jeraiah Jip, Galy Gay doit enterrer le vieux Galy Gay. Plus exactement : il faut qu'il démonte Galy Gay et remonte Jeraiah Jip, à partir des pièces détachées de Galy Gay. » 529
Cette description d'un personnage qui se dépèce et se rapièce pourrait contenir en germes une inquiétude quant à la dé-composition de l'humain, voire de l'humanité, et la version de 1936 de la pièce pourrait anticiper le basculement d'une réflexion socio-historique à une réflexion ontologique sur la nature de l'homme.
Face à la montée du national-socialisme, Brecht oriente le sens de la pièce vers une réflexion sur l'influence de la masse sur l'individu.
Mais dans la première version, qui date de 1928, l'influence historique qui prédomine est celle de la guerre, et l'influence esthétique l'expressionnisme, que Brecht récusera ensuite mais qui nourrit toutes ses premières œuvres, de même qu'elle informe la compréhension de l'œuvre de E. Bond.
Notes
524.
Edward Bond, La trame cachée, trad. Georges Bas, Jérôme Hankins, Séverine Magois, Paris, L’Arche, 2004, p. 260.
525.
Ibid.., p. 258.
526.
Ibid, p. 283.
527.
Ibid., p. 223.
528.
Bertolt Brecht, « De l'emploi de la musique pour un théâtre épique », Ecrits sur le théâtre, texte français de Jean Tailleur, Gérald Eudeline et Serge Lamare, Paris, L'Arche, 1964, p. 96.
529.
Bernard Dort, Lecture de Brecht, op. cit., p. 53.
Partie I. Chapitre 4. 2. b. v.
Le théâtre expressionniste, passerelle anthropologique et esthétique entre Brecht et Bond
Nombre des caractéristiques de la dramaturgie E. Bondienne peuvent être interprétées comme un héritage du théâtre expressionniste : les « personnages érigés en types », qui fonctionnent moins comme des catégories sociales que comme des essences « neutres » (l'enfant, la mère) 530 , la référence au drame à stations, autour du personnage de mère à l'enfant : dans la seconde partie de Grande Paix et dans Naître. Surtout, deux éléments fondamentaux rapprochent l'esthétique expressionniste du théâtre E. Bondien, le surnaturel et la violence. Rappelons que dans Les Marchands de Pommerat, le surnaturel est présent comme le seul espoir de sens dans lequel le personnage de l’amie de la narratrice trouve refuge, et donc de manière distanciée – puisque le personnage finit par tuer son fils et se retrouve dans une institution psychiatrique. Chez E. Bond, le pas est franchi, de la conscience mise à distance d’un personnage à la construction dramaturgique, et, comme dans le théâtre expressionniste, les morts parlent – et ce dès la première des Pièces de guerre, construite autour du personnage du Monstre, coryphée du chœur des morts : « Le Monstre de la première pièce est, en vérité, un plus-que-mort : arraché au ventre de sa mère durant l'apocalypse nucléaire, il n'a pas même vécu et c'est en non-vivant, en non-existant, en promesse de vie mort-née qu'il va décliner de scène en scène cette existence à laquelle il n'a pas eu accès. » 531 La danse macabre est de même un topos de l'œuvre E. Bondienne, et l'analyse menée par Jean-Pierre Sarrazac sur les Pièces de guerre 532 pourrait être prolongée jusqu'à Naître. L'atmosphère macabre provient non seulement de la présence des morts au milieu des vivants, mais du rapport de causalité, des modalités du passage de l'une à l'autre condition. Comme dans le théâtre expressionniste, la violence à l'œuvre chez E. Bond peut paraître gratuite, créant une impression de raptus généralisé, l'« impulsion violente et soudaine pouvant conduire un sujet délirant à commettre un acte grave (homicide, suicide, mutilation) » 533 prenant l'allure d'une catastrophe planétaire. On retrouve ainsi une atmosphère d'apocalypse, de « fin de monde » qui inspire un « pathos de la révolte contre la société » 534 Mais la différence d'avec le théâtre expressionniste demeure en définitive la même que celle qui sépare E. Bond du théâtre aristotélicien ou épique. Ici il n'y a plus « l'aspiration messianique vers un autre monde » ni l'auto-proclamation corollaire du « héros de lumière en marche vers l'éternité, prophète de la « fraternité universelle », perdu dans un sentiment cosmique et intemporel du monde » 535 , de même qu'il n'y a plus la confiance dans le Nouveau contre l'Ancien ni dans le peuple, le personnage populaire prenant souvent chez E. Bond l'aspect du « hooligan autodestructeur. » 536 Ce décalage considérable entre les enjeux du théâtre expressionniste et ceux du théâtre post-humain de E. Bond incite à s'interroger sur les motivations de cette référence. Jean-Michel Palmier constate avec d'autres la résurgence de l'expressionnisme sur la scène théâtrale contemporaine – le propos date de 1995, mais l'engouement des metteurs en scène pour certains auteurs expressionnistes et leurs précurseurs, comme les emprunts de certains dramaturges, E. Bond en tête, aux techniques expressionnistes, ne se dément pas au début du XXIe siècle. Cette actualité du théâtre expressionniste et de l'expressionnisme dans les dramaturgies contemporaines, est analysée par J.-M. Palmier comme un symptôme idéologique lié à un désenchantement à l'égard de Brecht, qui s'explique à la fois par la médiocrité d'un certain brechtisme mais aussi, et surtout, par le fait que « le monde n'apparaît plus comme transformable alors que pour Brecht il ne pouvait être montré, sur les planches d'un théâtre, que comme tel. » 537 L'analyse de Jean-Michel Palmier nous incite à nous interroger plus globalement sur les enjeux et les conséquences de ce changement de paradigme idéologique à l'œuvre dans le théâtre contemporain, et à nous interroger sur le basculement d'un théâtre politique à un théâtre post-politique par son ancrage idéologique, mais anté-politique par les héritages dramaturgiques qu'il convoque, qui emprunte à l'expressionnisme sa violence et radicalise la révolte contre la société en pessimisme anthropologique. S’il demeure pétri de références aux formes antérieures de théâtre politique comme à l’ambition d’un théâtre propédeutique à l’action politique, le théâtre postpolitique est marqué au sceau de la rupture esthético-idéologique. L’effondrement de l’espoir d’un progrès de la civilisation et l’abandon du projet critique se manifestent au théâtre par le rejet d’une esthétique de la représentation distanciée du monde orienté par et vers ce projet. Le théâtre postpolitique se fait volontiers commentaire méta-discursif qui théorise et représente son impossibilité à dire le monde, dans une esthétique de dé-composition des formes traditionnelles de théâtre politique, le théâtre épique en tête. Quoi qu’il en soit, il s’agit toujours de renoncer à la représentation critique cohérente du monde au profit d’une expression de son caractère contradictoire et violent. Le changement de paradigme axiologique est également manifeste en termes de réception programmée par les spectacles. Puisque dire le monde, en donner une représentation critique cohérente au premier degré n’est plus possible, deux alternatives concentrent désormais tout l’univers des possibles, entre lesquelles il ne s’agit d’ailleurs souvent pas de trancher, les spectacles jouant du double-sens, et de l’équivoque, entre ironie et second degré d’une part, et d’autre part annihilation de l’esprit critique d’un spectateur pris dans le présent de ses sensations physiques – dont le théâtre-concert constitue un exemple, et la vision de la violence un autre.
Notes
530.
Voir Jean-Michel Palmier, « Déclin et résurrection du théâtre expressionniste ? », in Actualité du théâtre expressionniste, textes réunis et présentés par Jean-Pierre Sarrazac, Louvain-La-Neuve, Etudes Théâtrales n°7, 1995, p. 11 et p. 12.
531.
Jean-Pierre Sarrazac « Résurgences de l'expressionnisme, Kroetz, Koltès, E. Bond », in Actualité du théâtre expressionniste, op. cit., p. 150.
532.
Idem.
533.
Ibid, p. 152.
534.
Jean-Michel Palmier, « Déclin et résurrection du théâtre expressionniste ? », in Actualité du théâtre expressionniste, textes réunis et présentés par Jean-Pierre Sarrazac, Louvain-La-Neuve, Etudes Théâtrales n°7, 1995, pp. 9-15.
535.
Ibid,, pp. 12-13.
536.
Jean-Pierre Sarrazac, op. cit., p. 151.
537.
Catherine Naugrette, Paysages dévastés. Le théâtre et le sens de l'humain, op. cit, p. 14.
Partie I. Chapitre 4. 3.
La violence comme esthétique, ou la rupture du pacte avec le spectateur
Au delà de l'aggro-effect théorisé par E. Bond, nombreuses sont les dramaturgies et les écritures scéniques contemporaines qui ne conçoivent plus le théâtre comme lieu de représentation mais de présentation d'une cérémonie rituelle expiatoire. « Scène barbare » 538 , « brutopie » 539 , « spectacles à l’estomac » 540 , ou « esthétique du coup de poing » 541 ,
les qualificatifs abondent pour décrire cette esthétique théâtrale.
Toutes ces formules sont centrées sur le type d’affect que ce théâtre vise à provoquer chez le spectateur et suggèrent que l’enjeu n’est plus de susciter la réflexion et le plaisir mais, comme premier temps de la réception du moins, un choc physique.
Si ce théâtre est postpolitique sur le plan dramaturgique au sens où il est post-épique, sur le plan scénique et anthropologique il peut être qualifié d'anté-politique au sens où il se situe avant la fondation de la représentation politique et théâtrale.
Cette tendance d'un certain théâtre contemporain qui ne représente plus le monde mais présente la violence d'un réel post-apocalyptique, est relayée par d'importants ouvrages critiques qui font la part belle à ce théâtre post-humain.
C'est pourquoi nous souhaitons à présent nous intéresser plus précisément à la littérature critique ainsi qu'à la place du spectateur programmée par ces dramaturgies et écritures scéniques, et aborder ce théâtre postpolitique sous l'angle de l'esthétique de la réception.
Notes
538.
Elisabeth Angel Perez, Voyages au bout du possible, op. cit., p. 13.
539.
Brutopia est le titre de l’une des pièces de Howard Barker.
540.
Formule de Jean-Pierre Han à propos de Jan Fabre. Jean-Pierre Han, « La fausse querelle d'Avignon », Les Lettres Françaises, Paris, 2005.
541.
Traduction du titre de l’ouvrage de Aleks Sierz, In-yer-face Theatre, London, Faber and Faber, 2001.
« Violent et impudique, le théâtre coup-de-poing agresse le spectateur retranché dans le confort anonyme de la salle. Souvent hyperréaliste, il s’élabore dans une esthétique de l’abjection dont le dessein est de choquer. » Elizabeth Angel Perez, in « L’humain au fil de la trame : Edward Bond et la nécessité du théâtre », op. cit., p. 700.
Partie I. Chapitre 4. 3. a.
La construction d'un « paysage dévasté »
Si un grand nombre de dramaturgies et écritures scéniques contemporaines renvoie sans conteste à un théâtre d'après la catastrophe, nul doute que la critique théâtrale et le monde universitaire amplifient le phénomène par leur attention sélective, et contribuent - à leur corps défendant sans doute - à peindre le paysage qu'ils disent vouloir décrire. Mais la sélection ne peut être toujours qualifiée de fortuite.
Comment expliquer autrement que par un choix politique le fait que nombre de dramaturges et metteurs en scène (David Edgar, David Hare entre autres) 542
tout aussi prééminents voire davantage à l'heure actuelle en Grande Bretagne qu'Edward Bond, Sarah Kane ou Howard Barker ne soient, eux, que très peu connus à l'heure actuelle en France, alors même que les universitaires anglo-saxons y consacrent une grande partie de leurs réflexions ?
C'est donc en maintenant présente à notre esprit la réserve que le cadre n'englobe pas la totalité du monde et du monde théâtral que nous pouvons souscrire à la description désolée qui court dans nombre d'ouvrages critiques contemporains.
Notes
542.
Mais aussi, quoique moins connus : Howard Brenton et Tariq Ali avec Ugly Rumours, satire du New Labour, Michael Frayn avec Democracy, Joe Penhall et sa pièce Blue Orange (2000), et Judy Upton avec Sliding with Suzanne (2001).
La guerre en Irak a été l'occasion d'un renouveau du théâtre politique, singulièrement sous la forme du théâtre documentaire, mais aussi du théâtre d'agit-prop comme Embedded de Tim Robbins. Le Tricycle Theatre a également réalisé deux pièces-procès à propos de la guerre en Irak : Half the Picture (1994), (basée sur l'enquête écossaise de ventes d'armes à l'Irak) et Justifying War (2003).
Pour la description du théâtre politique anglais, nous nous appuyons sur les travaux du groupe Political Performances, dirigé par Avraham Oz (Université de Tel Aviv), Working Group de la FIRT, et notamment sur les travaux de Paola Botham, qui achève en 2007 un PhD sur le Théâtre politique britannique contemporain.
Partie I. Chapitre 4. 3. a. i.
Auschwitz comme naufrage de la notion d’humanité
Catherine Naugrette, dans son sombre et bel essai au titre évocateur, a mis en lumière à quel point Auschwitz opère pour une grande partie des dramaturges contemporains comme fondation radicale d’une post-humanité, ne laissant que des Paysages Dévastés :
‘« Si l’on s’en tient à l’esprit de la déclaration d’Adorno, on voit se dessiner avec clarté l’un des principes historiques et politiques fondateurs de l’art contemporain. Et surtout peut-être de son esthétique. Son point de départ, ou plutôt de non-retour : Auschwitz. Ce que représente, ou plutôt ne parvient pas à représenter Auschwitz, soit, pour reprendre la notion kantienne souvent citée à propos de la Shoah, le Mal radical. Auschwitz et/ou peut-être ce que l’on pourrait appeler son corollaire technologique : Hiroshima. » 543 ’
Ce qui inscrit le théâtre que nous dirons contemporain en rupture irrémédiable avec toutes les esthétiques précédentes, c’est cette fondation historique et philosophique que constitue la Shoah. Et Catherine Naugrette d’énumérer la longue liste d’artistes pour lesquels « toute pratique artistique est déterminée et définie par Auschwitz » 544 ,
incontournable et intolérable commencement du monde contemporain : E. Bond bien-sûr, mais aussi Heiner Müller, Didier Georges Gabily, Claude Régy… 545
De même les Voyages au bout du possible de Elisabeth Angel Perez consacrés aux « théâtres du traumatisme de Samuel Beckett à Sarah Kane » s’ouvrent sur une citation sans équivoque de E. Bond : « Je suis un citoyen d’Auschwitz et de Hiroshima. » 546
Ces ouvrages s'inscrivent de la sorte sur les ruines de l'histoire et d'une conception optimiste de l'homme, et c’est sous ce prisme qu’ils décrivent les contours d'un théâtre hanté par la question du mal.
Notes
543.
Catherine Naugrette, op. cit., p. 15.
544.
Heiner Müller, Heiner Müller, Fautes d’impressions. Textes et entretiens choisis par Jean Jourdheuil, texte français d’Anne Bérélowitch, Jean-Louis Besson, Jean Jourdheuil, Jean-Pierre Morel, Jean-François Peyret, Bernard Sobel et Bernard Umbrecht, L’Arche, Paris, 1991, p. 192.
545.
Catherine Naugrette, Paysages dévastés, op.cit., pp. 15-16.
546.
Elizabeth Angel Perez, Voyages au bout du possible. Les théâtres du traumatisme de Samuel Beckett à Sarah Kane, op. cit., p. 11.
Partie I. Chapitre 4. 3. a. ii.
D'un Mal comme moyen à un mal métaphysique et anti-politique
En appuyant légèrement le trait, l’on pourrait dire que nous sommes passés d’un mal conçu comme un moyen nécessaire pour revitaliser une civilisation dégénérée à l’idée contemporaine d’un triomphe du Mal, seule fin d'un monde postmoderne. Certes dans les années 1930 Artaud estimait que « comme la peste il [le théâtre] est le temps du mal, le triomphe des forces noires. » 547
Il existe de fait toute une lignée d'artistes pour qui le théâtre ne se contente pas de représenter le mal mais a partie liée avec le mal : Sade, Baudelaire, Lautréamont, Bataille. Pour Artaud et Bataille notamment le Mal est nécessaire comme étape vers un renouveau et un retour aux sources de la vie. Et Catherine Naugrette de citer dans Paysages Dévastés l'analyse que fait Monique Banu-Borie de la violence chez Artaud comme moyen « indispensable pour rejoindre la force du rebrassement intérieur et extérieur qu'implique tout vrai retour aux sources de la vie. Car telle est la tâche qu'Artaud assigne au poète comme au peintre authentiques - à ces artistes-initiés, seuls capables, dans notre culture, de retrouver encore le chemin du monde perdu. » 548
Mais le Mal a changé de visage désormais, il n’est plus pensable dans les dramaturgies en question comme un moyen – choisi – mais comme la fin monstrueuse et inévitable du monde et de l’Histoire qui rompt avec l’ « utopie de l’art ». 549
L'homme contemporain a fait l'expérience irrémédiable du mal à la fois radical 550 et banal 551 ,
et de la conjonction de ces deux notions est né le paradoxe violent que doit désormais affronter l'individu, « qu'à l'incommensurable monstruosité du mal absolu réponde l'apparente « normalité » sociologique et clinique des criminels. » 552
Telle est la condition de l'homme postmoderne :
‘« La vérité, aussi simple qu'effrayante, est que des personnes qui, dans des conditions normales, auraient peut-être rêvé à des crimes sans jamais nourrir l'intention de les commettre, adopteront, dans des conditions de tolérance complète de la loi et de la société, un comportement scandaleusement criminel. » 553 ’
Et une partie du théâtre contemporain se fonde sur les ruines de toute utopie et laisse donc la cruauté à nu, immanente dans un monde privé de toute eschatologie :
‘« Une telle utopie [l’utopie d’un mal-moyen au service d’une fin de régénération présente chez Artaud] me semble avoir aujourd'hui disparu chez les artistes d'aujourd'hui. Si le théâtre moderne et peut-être surtout postmoderne porte bien en lui des traces de la cruauté artaudienne, s'il en est bien, dans une large mesure, l'héritier, la violence qui le définit est désormais coupée de toute vision utopique. Là où l'approche du Mal était encore chez Artaud fondée sur le rêve d'un théâtre nouveau et l'espérance d'une vraie vie, dans le théâtre de l'après Auschwitz, chez Sarah Kane, comme chez ses contemporains, mais tout aussi bien déjà chez Beckett, E. Bond, Müller ou Gabily, le Mal est devenu le paradigme d'un monde sans but ni devenir. Un monde sans joie. Désenchanté. Désolé. Dévasté. » 554 ’
Cinquante ans après, la Shoah hante toujours les consciences et tout spécifiquement celles des auteurs de théâtre, marqués de manière indélébile par cet « inconsolable de la pensée. » 555
Cet événement fonctionne désormais non pas comme un fait historique mais comme un traumatisme indépassable, symbole de la barbarie, cette nouvelle condition humaine. Il ne peut se mettre au passé, parce qu’il ne saurait s’inscrire dans l’histoire.
Notes
547.
Antonin Artaud, Le théâtre et son double, Paris, Folio Essais, Gallimard, 1985, p. 44.
548.
Monique Borie, Antonin Artaud, le théâtre et le retour aux sources, Une approche anthropologique, NRF, Gallimard, Paris, 1989, p. 87.
549.
Catherine Naugrette, Paysages dévastés, op. cit., p. 158.
550.
Formule de Kant dans La religion dans les limites de la simple raison.
551.
Formule de Hannah Arendt à propos du procès d'Eichmann à Jérusalem.
552.
Myriam Revault d'Allonnes, Ce que l'homme fait à l'homme. Essai sur le mal politique, La couleur des idées, Seuil, Paris, 1995. p. 38.
553.
Hannah Arendt, La Condition de l'homme moderne, Agora Pocket, Calmann-Lévy, Paris, 1961 et 1983, p. 79.
554.
Catherine Naugrette, Le lieu du drame, in Le théâtre et le mal, Registres n°9-10, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, hiver 2004 - printemps 2005, p. 12.
555.
Myriam Revault d’Allonnes Fragile humanité, Paris, Aubier, 2002, p. 151.
Partie I. Chapitre 4. 3. a. iii.
La fin de l’Histoire et de la politique. Un théâtre éthique
La Shoah est en définitive cause d’une remise en question de la conception de l’Histoire orientée vers une fin et avançant selon la notion de progrès :
‘« Les auteurs dramatiques contemporains mettent […] en évidence le fait que le phénomène d’Auschwitz échappe à un strict ancrage dans le temps et dans l’espace.
La théorie anti-historiciste que Walter Benjamin soutient dans « Sur le concept d’histoire » en 1940 peut être convoquée à l’appui de ce point de vue. Benjamin développe en effet l’idée qu’il est naïf de penser l’histoire en fonction de la notion de « progrès » (thèse XIII), laquelle nous aveugle sur les barbaries passées, et que l’historien historiciste, qui croit que le passé doit s’analyser à la lumière du seul passé, ne peut que risquer de perdre la vérité (VII) en perdant le passé et l’image du passé à tout jamais […]. » 556 ’
Si le paysage théâtral contemporain apparaît dévasté, c’est en réplique à la dévastation d’un monde dans lequel le Mal a succédé au progrès. Inutile de décrire le monde, il est mauvais. Sur les ruines de l'anthropologie humaniste, de la politique et de l'Histoire, seule demeure l'histoire du théâtre, monument toujours debout quoiqu'en ruines lui aussi.
Notes
556.
Elisabeth Angel Perez, Voyages au bout du possible, op. cit., p. 18.
Partie I. Chapitre 4. 3. a. iv.
Le théâtre postpolitique, un méta-théâtre
L'analyse du méta-théâtre menée dans d’Oxygène de Ivan Viripaïev ou dans Atteintes à sa vie de Martin Crimp, est une constante du théâtre postpolitique. Nous voudrions développer un dernier exemple, qu’il nous paraît pertinent de souligner ici en ce qu’il explicite le caractère de réponse à la situation politique ouverte en 1989 que constitue cette esthétique. Il s’agit du discours liminaire de Didier-Georges Gabily à sa pièce Ossia, qui se construit autour d’une double trame, dont chacune tient au fait que deux acteurs répètent une pièce différente. La première pièce raconte « quelques moments clés de la vie d’Ossip Mandelstam, poète soviétique disparu en 1938 dans un camp de transit quelque part en Sibérie orientale. » 557
Mais cette trame est discontinue car il « faut imaginer deux acteurs [les mêmes] essayant de répéter dans le même temps une autre pièce ; celle d’un homme, ancien militant ou compagnon de route d’un quelconque parti communiste occidental, rendant visite vers la fin des années 1970 à la femme du poète – et qui a survécu, elle, Nadejda, là-bas, dans un Moscou qui était encore celui de la glaciation. » 558
L’omniprésence du « quelconque », qui vient corriger la précision historique de la référence, dit combien le sort des militants communistes est devenu emblématique de la posture intenable de l’engagement des intellectuels et des artistes. Revenant après la Chute du Mur sur sa pièce écrite en mars 1989, l’auteur précise :
‘« Aujourd’hui que certains murs ont été, dit-on, battus en brèche, peut-être mesurons-nous mieux à quel point cette pièce – morceaux de répétitions offerts à tous les vents – avait une nécessité. Pièce sérielle, elle donne à voir toutes les errances, toutes les fragilités qui présidèrent à sa construction. Et dans l’histoire d’aujourd’hui (trouble, troublée, troublante), n’était-ce pas la façon la plus humble de leur rendre hommage, à eux, Ossip et Nadejda Mandelstam ? On imaginera deux acteurs… » 559 ’
Il s'agit non plus de représenter à distance et avec un regard critique, mais de « donner à voir» non plus tant le monde que l’impossibilité qu’il y a à le représenter, dans une dramaturgie spéculaire à l’infini. Comme chez E. Bond, la mise en question de l'héritage passe aussi et surtout, dans le discours de Gabily, par une remise en question de la notion même de représentation. La mise en crise de la représentation constitue une donnée récurrente des dramaturgies et des écritures scéniques postpolitiques. Pour mieux saisir les enjeux actuels d'une esthétique qui ne représente plus un monde violent mais l’exprime directement, un rappel des conditions d'émergence de l’esthétique de la performance, fondée non sur la représentation de la violence mais sur son expression directe.
Notes
557.
Didier Georges Gabily, « Avant-propos », Ossia, Arles, Actes Sud-Papiers, 2006, p. 7.
558.
Idem.
559.
Idem.
Partie I. Chapitre 4. 3. b.
Remise en question des codes de représentation :
Vers une esthétique de la performance.
Partie I. Chapitre 4. 3. b. i.
Historique du corps comme texte : « Et le verbe s'est fait chair »
Sans nous attarder sur les origines de l’esthétique de la performance dans les années 1910-1920 560 ,
insistons sur le contexte des années 1960-1970, quand le slogan « tout est politique » de Gramsci va réactiver les ambitions esthétiques et politiques de la performance.
La formule du philosophe marxiste italien signifie que toutes les composantes de la société, y compris celles qui ressortissent en apparence à la sphère privée, peuvent opérer comme objets politiques en ce qu’elles sont des lieux où se jouent des relations de pouvoir. Le corps, et plus encore le corps de l’opprimé - corps opprimé de femme, corps d’ouvrier, corps d’homosexuel – s’appréhende désormais comme lieu possible voire privilégié de manifestation des enjeux de pouvoir, et si l’on accepte de suivre Bourdieu dans ses Méditations pascaliennes 561
on peut même avancer que « les injonctions sociales les plus sérieuses s’adressent non à l’intellect mais au corps. » Tout en demeurant dans le registre de la représentation, les dramaturgies ressortissant à ce que qui s’est nommé le « théâtre du quotidien » vont manifester la réfraction des relations de pouvoir dans les sphères privée et intime, le conditionnement gestuel qui en vient à définir l’ouvrier dans toute son existence, y compris hors des heures pointées à l’usine, comme en témoignent des pièces comme L’entraînement du champion avant la course 562 ,
Travail à domicile 563 ou encore Loin d’Hagondange. 564
Ce déplacement de la focale – manifeste également dans la prédilection de ces dramaturgies pour le thème du fait divers articulé à l’incapacité des personnages à se dire, phénomènes décrits comme individuels mais dont le lecteur-spectateur ne peut que supputer les causes sociales 565
– témoigne aussi et surtout de la difficulté grandissante qu’éprouvent les artistes à aborder les questions politiques dans une perspective globale et synthétique, du fait de l’effritement progressif de la philosophie politique marxiste 566
et démontre l’importance d’une analyse du contexte politique pour appréhender les évolutions d’un théâtre à ambition politique.
Cette mise en exergue du corps s’avère propice au retournement de perspective ou à tout le moins à un corps-à-corps serré entre le personnage et l’acteur, et à travers cette incarnation dédoublée, entre le texte et la mise en scène. De fait, dans les années 1960 et surtout 1970 va se développer une forme d'art vivant spécifique, point de rencontre esthétique entre le théâtre, la danse et les arts plastiques, mais aussi point de rencontre entre une forme d'art et « une attitude existentielle. » 567
En réaction contre le mythe de l'artiste démiurge, génie extra-ordinaire, certains vont revendiquer le corps banal et le geste quotidien, anti-héroïque et anti-dramatique, ce décentrement participant d'une désacralisation de l'œuvre, mais qui va paradoxalement passer par une forme de ritualisation du corps de l'artiste, matériau des performances et happenings. Le corps de l'artiste devient corps artistique, et le plus souvent, lieu de militantisme, le « corps authentique » s'opposant au corps normé, conforme. (Corps de femme, corps jeune, corps afro-américain, par opposition au modèle dominant de l'individu de sexe masculin blanc, hétérosexuel, installé dans la société, dans le monde et dans la quarantaine.) Mais la relation entre ces deux types de corps n'est pas de pure opposition, et la position critique de l'artiste fait place à une forme d'intersubjectivité corporelle, le corps authentique souffrant pour l'expiation des péchés des uns et par compassion avec les tourments des autres, victimes des premiers, tels les Vietnamiens agressés par les Etats-Unis et au-delà d'eux toutes les victimes de l'impérialisme occidental à travers le monde. 568
L'automutilation des actionnistes viennois attaque de front les tabous, et participe de l'idée que le politique n'est pas un champ spécifique, que le personnel, le privé, est politique. Ce qui est vécu par le corps comporte une dimension politique, et réciproquement, tout engagement politique met le corps en jeu. 569
La violence comme réalité et comme métaphore se trouve ainsi au cœur de la performance comprise comme espace-temps non plus de représentation mais de relation interpersonnelle, la violence réciproque de ce que l'artiste montre au spectateur et celle que le spectateur peut faire subir à l'artiste 570
opérant comme métaphore de la violence non seulement politique mais ontologique des hommes entre eux. Une tendance masochiste apparaît donc dans l'art corporel, qui retrouve une nouvelle vigueur dans les années 1980 et surtout 1990 à mesure que se répand l'épidémie de Sida, le corps malade étant exposé à la fois pour témoigner et pour que la représentation l'apaise, selon une conception d’ordre chamaniste. 571
Dort parle à juste titre de « transes corporelles » des interprètes, qualifiant l’objet théâtral obtenu de « fête noire. » 572
L'évolution considérable qu'apporte la performance à la conception du corps de l'artiste semble avoir par contiguïté infléchi la perception que s’en font en France aujourd’hui les artistes de théâtre plus conventionnels dans leur rapport à la représentation, du fait notamment de la croyance commune dans la mission du théâtre, expiatoire pour l’individu - spectateur ou artiste - et sacrificielle pour l’artiste. Et ce sont à la fois la dramaturgie et l’écriture scénique des spectacles qui s’en trouvent bouleversées.
Notes
560.
Nous renvoyons ici essentiellement aux travaux de Roselee Goldberg.
561.
Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997.
562.
Michel Deutsch, L’entraînement du champion avant la course, Théâtre ouvert Stock, 1975.
563.
Franz-Xaver Kroetz, Travail à domicile, L’Arche, 1991.
564.
Jean-Paul Wenzel, Loin d’Hagondange, Théâtre Ouvert Stock, 1975.
565.
Voici notamment ce que dit Franz Xaver Kroetz à propos des personnages de Travail à domicile : « Leurs problèmes ont des causes si profondes et sont tellement loin d’être résolus qu’ils ne sont pas capables de les exprimer par des mots. Ils sont introvertis. La société en porte une large responsabilité, les traitant sans égard et les laissant s’enfermer dans leur mutisme. En même temps, ces hommes se sont toujours fabriqué une thérapie par le travail, pour surmonter cette condition de sourds-muets. Ils sont toujours pris par une occupation quelconque. » Franz-Xaver Kroetz, Travail à domicile, op. cit., p. 9.
566.
Pour une étude approfondie de ces dramaturgies, nous renvoyons ici aux travaux d’Armelle Talbot, Théâtres du pouvoir, théâtres du quotidien, Nouvelles économies politiques du visible dans les dramaturgies des années 1970, thèse de doctorat en cours sous la direction de Christine Hamon-Siréjols.
567.
Otto Mühl, cité in La performance du futurisme à nos jours, Roselee Goldberg, Thames et Hudson, Paris, 1998.
568.
Consulter à ce sujet Cathy O'Dell, Contact with the Skin : Masochism, Performance Art and the 1970's, University of Minnesota Press, 1998.
569.
Sur toutes ces questions, voir Tracey Warr et Amelia Jones, Le corps de l'artiste, Éditions Phaidon, Paris, 2005.
570.
Roselee Goldberg évoque ainsi une performance de Marina Abramovic, Rythme O, créée à Belgrade en 1974. La « performeuse » autorisa les visiteurs à disposer d'elle à leur guise durant six heures «Ceux-ci pouvaient utiliser les instruments mis à leur disposition sur une table, susceptibles de lui causer de la souffrance ou du plaisir. Au bout de trois heures, ses vêtements avaient été découpés à la lame de rasoir, sa peau entaillée; un pistolet chargé, braqué sur sa tête, fut à l'origine d'une rixe entre ses bourreaux qui mit un terme à cette séance éprouvante. » in La performance du futurisme à nos jours, op. cit., p. 165.
571.
Ce phénomène ne concerne pas véritablement la France mais est très manifeste aux Etats-Unis notamment mais aussi en Chine. A ce sujet, l’on pourra consulter entre autre les travaux de Virginia Anderson (Tufts University.)
572.
Bernard Dort, « Une propédeutique de la réalité », op. cit., pp. 288-289.
Partie I. Chapitre 4. 3. b. ii.
Sur la scène contemporaine.
Théâtre de texte vs théâtre corporel
ou performance vs représentation ?
Deux lignées paraissent de prime abord à distinguer sur la scène française contemporaine : le théâtre de texte dans lequel la dramaturgie prédomine encore, et ce que l’on pourrait appeler, faute de mieux, la danse-théâtre – même si les amateurs de danse déplorent que l’on n’y danse plus guère – centrée sur l’écriture scénique et l’art corporel. D’un côté les metteurs en scène Olivier Py, Jean-François Sivadier, mais aussi des auteurs comme Sarah Kane ou Edward Bond, de l’autre Jan Fabre, Rodrigo Garcia ou Wim Vandekeybus. Ce clivage schématique ne signifie pas bien sûr que les premiers n’intègrent pas à leur travail la prise en compte de l’art corporel de l’acteur ou les événements scéniques ni que les seconds se passent de la parole et du texte, loin s’en faut. Il s’agit de distinguer deux approches de la représentation, l’une que l’on pourrait nommer esthétique de la performance, centrée de manière autonome sur l’hic et nunc de la représentation, et l’autre qui considère cette dernière comme un aller-retour entre cet espace-temps et celui du texte, que nous pourrions qualifier d’esthétique de la représentation. Entre les deux extrêmes de ce tableau rapide se situerait Wim Vandekeybus 573 ou, d'une autre manière, Rodrigo Garcia.
Notes
573.
Un spectacle comme Sonic Boom mêle à plaisir ou plutôt à dégoût les deux esthétiques, alternant mutilation réelle (mais mesurée) des acteurs et représentation très allusive d’un viol.
Partie I. Chapitre 4. 3. b. iii.
Étude de cas : l’effet politique de la déstabilisation du spectateur chez Rodrigo Garcia
Plusieurs spectacles de Rodrigo Garcia utilisent ce principe de mélange des deux esthétiques, qui travaille l’interprète comme le spectateur et déstabilise les rapports entre le texte et l’écriture scénique. Dans Jardinage Humain 574 ,
deux acteurs interprétant une scène d’amour comique tentent de s’étreindre, mais se trouvent empêchés par d’innombrables sacs de course accrochés à leurs poignets et auxquels ils s’accrochent, qui s’emmêlent mais qu’ils refusent de lâcher. Après l’échec de la copulation et le départ de l’amoureux, la même actrice, restée seule, se fait performeuse, et engloutit sans un mot le contenu de tous les sacs, tandis que le spectateur assiste impuissant et fasciné à ce gavage en temps réel. Le cas diffère dans J’ai acheté une pelle en solde pour creuser ma tombe, où le dérangement ne provient plus de l’alternance entre performance et représentation, mais de l’incertitude quant au statut de ce qui est vu, ce n’est plus l’ambivalence qui dérange, mais l’ambiguïté. Dans le spectacle, le personnage de l’enfant est joué par un enfant. Choix de réalisme ? En l’occurrence, l’enfant, âgé d’une dizaine d’années, tient des propos choquants, homophobes et racistes, et ressent un plaisir évident qui met mal à l’aise le spectateur, incertain quant au fait que l’enfant joue et n’exprime pas sa propre opinion. C’est précisément cette incertitude qui intéresse Rodrigo Garcia, ce dérangement du spectateur. Le sens des spectacles réside dans le frottement entre une esthétique de la représentation et une esthétique de la performance, l’efficacité résultant du va-et-vient demandé au spectateur entre réception herméneutique et réception du choc physique, entre des séquences où l’acteur est un récitant et d’autres où il devient performeur. Cette alternance provoque une distance des interprètes face aux situations les plus violentes qu’ils peuvent incarner. Ce travail d’alternance dans les modes d’adresse passe par une forte remise en cause de la notion de personnage, conférant un nouveau statut à l’acteur. C’est la raison pour laquelle l’œuvre de Rodrigo Garcia nous semble difficilement analysable à partir du texte seul – et il n’est d’ailleurs pas anodin que cet auteur prenne en charge la mise en scène de ses spectacles :
‘« Décrire un espace, créer des personnages, remplir le texte d’indications scéniques : à ne jamais faire. Ici, les noms qui précèdent chaque phrase sont ceux des comédiens pour lesquels je suis en train de travailler, auxquels je pense lorsque que j’écris le texte. Il ne s’agit donc pas de personnages mais de personnes. » 575 ’
Dans ses spectacles alternent des séquences de performance déjà mentionnées et des procédés beaucoup plus traditionnels, centrés sur le texte sinon sur le personnage. Garcia use notamment de la litanie par le biais de listes, énumérant les personnes ayant commis des actes de répression et de torture entre 1976 et 1983 en Argentine et graciées par Carlos Menem en 1990 » 576
ou encore ce dont tel ou tel doit avoir pitié 577 ,
liste des marques les plus connues et rebaptisées « ordures » et liste des auteurs que l’on peut encore trouver « en fouillant dans les ordures » de notre culture contemporaine 578 ,
liste des verbes correspondant aux actions vécues par le narrateur, « petite liste in progress des principaux enfoirés de l’histoire de l’humanité », volontairement provocatrice car regroupant des figures peu emblématiques du mal, voire positives, quoi que dans des registres fort divers ( L’apôtre Saint Jacques, Le Mahatma Gandhi, Médecins du Monde, Che Guevara, Nelson Mandela aux côtés de Marilyn Monroe, Janis Joplin ou Elvis Presley) et d’autres, plus complexes (Diego Maradonna, Jorge Luis Borges, etc. ) 579
Réelles ou fantaisistes, les listes sont toujours dénonciatrices, de petits problèmes, parfois mesquins, et de grands problèmes géopolitiques. De même s’entrechoquent dans les consciences occidentales les mieux averties des préoccupations contradictoires, qui vont des injustices et inégalités mondiales à l’envie de s’acheter une nouvelle paire de baskets Nike ou de regarder un film pornographique. Ces deux dernières envies procédent de fait chez Garcia de la même pulsion de consommation, comme l’exprime de manière très visuelle la séquence du film pornographique dans Jardinage humain, au cours de laquelle les baskets de marque remplacent les attributs sexuels et suscitent convoitise et lascivité des acteurs, avec la virgule de Nike, en toile de fond géante et gênante. Toutes les pièces de Garcia sont contradictoires, travaillent la contradiction, et la structure de Vous êtes tous des fils de pute nous paraît symboliser au niveau métadiscursif le fonctionnement de l’ensemble des pièces :
‘« La pièce est divisée en deux parties bien différenciées.
La première est un récit fragmenté d’événements personnels ; elle est incomplète, biographique, comme les pages libres d’un journal intime.
La seconde, au contraire, est totalisante, universaliste. […]
Première partie :
Un personnage, toujours le même, dira tout le texte, composé de X fragments de différentes durées.
A la fin de chaque fragment, un comédien / une comédienne l’embrasse sur la joue. Puis l’autre (il ou elle) lui flanque une gifle.
Il est inutile de préciser que la seule façon pour que tout cela fonctionne est […] que le baiser soit vrai, authentique, et que la gifle soit authentique, vraie. […]
Chaque action que nous avons réalisée, consciemment ou inconsciemment, tout au long d’une vie […] a récolté l’approbation des uns et les coups des autres, c’est-à-dire toujours le jugement d’un tiers. Et personne n’avait raison. » 580 ’
Les spectacles de R. Garcia mêlent ainsi la gifle et la caresse, le particulier et le général, la représentation et l’action réellement vécue, ainsi qu’un troisième élément fondamental, le rire, qui prend alors sa véritable fonction freudienne de décharge émotionnelle, d’évacuation de la tension. L’on voit donc l’impossibilité qu’il y a à analyser l’œuvre de Garcia à partir du texte seul, et l’artiste met en scène dans son texte même cette impossibilité comme en témoigne la note liminaire du recueil contenant L’histoire de Ronald, le Clown de Mac Donald et J’ai acheté une pelle chez Ikea pour creuser ma tombe :
‘« Ces textes sont nés parallèlement aux créations théâtrales qui portent le même nom. Ce ne sont pas des pièces de théâtre à mettre en scène plus tard mais des matériaux qui, dans un livre, peuvent n’avoir aucun rapport entre eux et qui ne prennent vraiment sens que dans la structure de la représentation théâtrale. Voilà pourquoi je vous présente mes excuses si la lecture en est pénible, chaotique et ennuyeuse. » 581 ’
Nous incluons pour partie R. Garcia dans la cité du théâtre postpolitique, dans la mesure où ses spectacles travaillent l'incertitude du sens et manifestent une contradiction de la pensée, et où son discours manifeste à la fois un rejet de la politique réduite à une classe d'hommes politiques menteurs et manipulateurs, et un rejet de la prétention de l'art et des artistes à donner une vision critique du monde et à le changer :
‘« Voici le premier lien entre ces deux figures, l'artiste et le politique, qui m'est venu à l'esprit : tous les deux mentent. Et ils se mentent à eux-mêmes. Le mensonge des hommes politiques : améliorer la vie d'autrui, alors qu'en fait, ils s'échinent à améliorer la situation de quelques privilégiés. […] De son côté, un petit groupe d'artistes s'égosille face au mensonge de la classe politique et ils mettent au point la tromperie suivante : quelqu'un doit mettre de l'ordre dans le grand désordre que les hommes politiques font régner sur le monde, et cette mission leur incombe en partie. Certains artistes pensent qu'ils sont sur scène pour déterrer le mensonge semé par les fonctionnaires de l'Etat. […] Finalement, je me sens comme une partie de l'engrenage, une pièce de cette énorme machine à laver les consciences. Je lave ma conscience dans mon discours non conformiste et le public en fait de même. Et ensemble, public et créateur, nous nous employons à graisser le rouage qui est en train de nous écraser. » 582 ’
Deux éléments viennent toutefois nuancer fortement cette interprétation des spectacles comme du discours de R. Garcia. En effet, il décrit la société et non l'individu, et sa réflexion moins métaphysique que socio-historique, débouche donc « une référence, et même un hommage, à chaque petit noyau de résistance », de lutte politique. C’est à ces noyaux qu’appartiennent des gens aussi divers qu’« une personne travaillant gratuitement dans une soupe populaire de Tucum?n, en Argentine » 583 ,
« certains artistes issus des arts plastiques, du cinéma ou du théâtre » 584 ,
ou encore « des gens qui mettent des bombes et qui ôtent la vie à d'autres gens. […] Ces combattants d'une vraie lutte armée constituent aussi des groupes historiquement cohérents de résistance. » 585
Le pessimisme anthropologique n’empêche donc pas chez R. Garcia la valorisation de l'action politique, en l'occurrence la plus radicale, justifiée par les inégalités économiques Nord-Sud. Cet artiste procède donc par imbrication du particulier au général et donne à entendre un discours critique qui décrit le monde contemporain non pas comme un monde composite incompréhensible mais également à partir de clivages sociaux et politiques, comme dans ce passage devenu célèbre de L’Histoire de Ronald, le clown de Mac Donald :
‘« Si tu as neuf ans et que tu vis à Florence, tu vas au MacDonald's le dimanche.
Si tu vis en Afrique, tu couds des ballons pour Nike.
Si tu as neuf ans et que tu vis à New York, tu vas au MacDonald's le dimanche.
Si tu as neuf ans et que tu vis en Thaïlande, tu dois te laisser enculer par un Australien.
Après, deux avions se paient deux gratte-ciel et les gens s'étonnent. » 586 ’
Ce double processus de montée en généralité et de conflictualisation des situations caractérise nous le verrons la définition du politique à l’œuvre dans la quatrième cité. 587
De même, l’on trouve chez lui une critique de la démocratie, « devenue un lieu froid, obscur et sinistre » 588 ,
parce que « si l'on veut des gouvernements justes, il faut un peuple informé, qui sache ce qu'il élit. Et si l'on veut un peuple informé, il faut des gouvernements justes. » 589
Le théâtre de Rodrigo Garcia s'avère en définitive composite, et si à certains égards l’on peut le considérer comme partie intégrante de la cité présentement décrite du théâtre postpolitique, il participe par d’autres aspects au renouveau contemporain du théâtre de lutte politique. R. Garcia, cet « artisan de la contestation, [qui s']évertue à engendrer du malaise et, en même temps, des étincelles de beauté [et qui se] sen[t] dans l'obligation de semer la confusion » 590 ,
participe donc également, par son discours comme par ses spectacles, à notre quatrième cité. 591
ce qui prouve, si besoin en était encore, que les cités ne sont pas à comprendre comme des grilles dans lesquelles caser tel ou tel artiste, tel ou tel spectacle, mais comme des registres de légitimation qui coexistent et parfois entrent en porosité.
Cette tension n'est cependant pas à l'œuvre chez tous les artistes que nous venons d'évoquer, alors que celle entre performance et représentation semble opératoire plus largement, puisqu'un certain nombre de dramaturgies contemporaines paraissent désormais difficilement analysables à partir des catégories dramaturgiques minimales que sont le personnage ou l’histoire, dans la mesure où elles tentent de « créer des dramaturgies […] hors de la fable, des personnages, des dialogues. » 592
L’évolution de l’œuvre de Jan Fabre manifeste la porosité entre ces frontières, puisqu’il est passé des happenings dans des lieux alternatifs dans les années 1980 – qui lui valurent quelques arrestations par la police – à la mise en scène de ballets 593
ou de spectacles pour la Cour d’Honneur du Palais des Papes. Cela nous montre au passage que le clivage des modes de représentation rejoint peu ou prou un clivage dans les rapports aux lieux culturels institutionnels 594 ,
et indique également l’importance fondamentale d’une autre ligne de partage parmi les artistes précédemment évoqués, au moins aussi déterminante que celle concernant le mode de (re-) présentation choisi, et liée précisément à ce qui est (re-) présenté sur la scène. Si Jan Fabre se faisait arrêter en effet, et bien d’autres avec lui, ce n’est pas parce qu’ils bousculaient les codes de la représentation, mais pour atteinte aux mœurs et à l’ordre public. Aujourd’hui encore, l’essentiel du travail de J. Fabre consiste en une interrogation du corps physique 595 ,
du corps spirituel 596 et du corps érotique 597 , du « corps en révolte. » 598
Le point commun à nombre de dramaturgies et écritures scéniques contemporaines réside donc sur le plan thématique comme dramaturgique dans la violence physique, la présentation du corps humain comme champ de bataille. Et en terme d’esthétique de la réception, cette violence est à appréhender dans sa dimension de provocation. 599
Notes
574.
Rodrigo Garcia, Jardinage Humain, Besançon, Solitaires intempestifs, 2003.
575.
Rodrigo Garcia, cité par Julie Sermon et Jean-Pierre Ryngaert in Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition, Paris, Éditions Théâtrales, 2006, p. 6.
576.
Rodrigo Garcia, Jardinage humain, op. cit., pp. 41-45.
577.
Citons quelques occurrences de cette liste, emblématiques de l’entremêlement dans la conscience des préoccupations politiques et du quotidien dans son aspect le plus banal : « Aux terroristes : ayez pitié de la poudre – Aux gens du FMI : ayez pitié de l’Argentine – Aux merdes de chien dans la rue : ayez pitié des promeneurs », ibid, p. 38.
578.
Rodrigo Garcia, L’histoire de Ronald, le clown de Mac Donald’s, suivi de J’ai acheté une pelle chez Ikea pour creuser ma tombe, traduction Christilla Vasserot Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2002, pp. 34-38.
579.
Ibid, p. 57.
580.
Rodrigo Garcia, Vous êtes tous des fils de pute, traduction Christilla Vasserot, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2002, pp. 5-6.
581.
Rodrigo Garcia, L’histoire de Ronald, le Clown de Mac Donald’s, op. cit., pp. 5-6.
582.
Rodrigo Garcia, in Mises en scène du monde, Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2005, pp. 377-378.
583.
Ibid, p. 382.
584.
Idem.
585.
Idem.
586.
Rodrigo Garcia, L'histoire de Ronald, le clown de MacDonald's, in L'histoire de Ronald, le clown de MacDonald's suivi de J'ai acheté une pelle en solde chez Ikea pour creuser ma tombe, traduit de l'espagnol par Christilla Vasserot, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2003, p. 27.
587.
Voir infra, Partie IV, chapitre 1, 1, c.
588.
Rodrigo Garcia, in Mises en scène du monde, op. cit., p. 381.
589.
Idem.
590.
Ibid, p. 384.
591.
Voir infra, Partie IV, chapitre 2, 1, b.
592.
Joris Lacoste, cité par Julie Sermon et Jean-Pierre Ryngaert, op. cit, pp. 7-8.
593.
Le Lac des Cygnes avec le Koninklijk Ballet van Vlaanderen.
594.
Une partie du potentiel de trouble à l’ordre public de ces performances est annihilé à partir du moment où la même chose se passe sur la scène, le lieu théâtral transformant non seulement le sens mais la nature même de ce qui est représenté. La nudité, passible d’arrestation dans la rue, ne l’est évidemment pas sur la scène.
595.
Trilogie Sweet temptations, 1991.
596.
Universal copywrights, 1&9, 1995.
597.
Glowing Icons, 1997.
598.
As long as the world needs a warrior’s soul, 2000.
599.
La provocation est ressentie comme telle par le public et aussi souvent recherchée par l’artiste comme effet sur le spectateur.
Partie I. Chapitre 4. 3. c.
Le « cas Avignon 2005 » :
emblème et catalyseur d’un différend esthétique
A la fois emblème et catalyseur, l’édition 2005 du Festival d’Avignon 2005 a réactivé la polémique autour du statut du texte sur la scène de théâtre (Olivier Py opposant ainsi théâtre du texte et théâtre d’image dans un article devenu célèbre 600 ).
Mais la décision la plus controversée fut le choix fait par l’artiste invité Jan Fabre de centrer la programmation autour d’une esthétique de la violence. Les spectacles représentaient la violence, la mettaient en scène, mais plus souvent encore la montraient directement sur la scène. Il s’agissait dès lors davantage d’exprimer la violence du monde que de la mettre à distance pour la donner à comprendre au spectateur, ce dernier se trouvant souvent en position de voyeur face à des acteurs souffrants réduits par moment au statut de « corps projectile » 601 :
‘« La polémique née l’été dernier au Festival d’Avignon a été suscitée par la représentation d’objets, de situations, d’événements (meurtres, viols, massacres, cannibalisme, violence, sang, excréments et autres sécrétions corporelles, etc.) qui, hors du contexte de la représentation, provoquent des réactions affectives pénibles : crainte, aversion, peur, pitié, horreur, tristesse, répugnance, répulsion. Ainsi, dans Histoire des Larmes, Jan Fabre exhibe les sécrétions du corps humain (larmes, sueur, urine) ; dans Je suis sang, des hommes maladroitement circoncis au hachoir gémissent et glissent dans des flaques de sang ; la violence sexuelle hante Une belle enfant blonde de Gisèle Vienne ; Thomas Ostermeier met en scène Anéantis de Sarah Kane, pièce dans laquelle il est question de viol, d’yeux arrachés et mangés, d’enfant mort dévoré ; Anathème de Jacques Delcuvellerie exhibe tout ce qui, dans la bible, est appel au meurtre. Les spectacles incriminés ont un très fort air de famille. Ils présentent des traits communs suffisamment saillants pour constituer une lignée artistique singulière. […] » 602 ’
Violence verbale, violence psychique mais aussi et surtout physique, violence sexuelle, violence sadique, violence sur la scène et violence de la réaction dans la salle, silencieusement subie ou renvoyée en boomerang par les spectateurs, la violence paraît dans ce théâtre érigée en concept esthétique. Nous allons tenter, à partir d’une analyse de la polémique suscitée par l’édition 2005 du Festival d’Avignon, de discerner les lignes de force et de fracture saillantes du théâtre contemporain avant de tenter de les relier à l’état des lieux du théâtre politique sur la scène française contemporaine.
Notes
600.
Olivier Py, « Avignon se débat entre les images et les mots », Le Monde, 30 juillet 2005.
601.
Formule employée par Marie-José Mondzain lors de la rencontre organisée par France Culture au Théâtre de la Bastille le 15 octobre 2005, et intitulée « Après Avignon, le théâtre à vif. » La présentation de cette rencontre expose clairement les enjeux de la polémique :
« Avignon, 2005 : le public est massivement présent dans les salles et dans la cour d'honneur. Mais une partie de la critique se fait l'écho d'un malaise : les choix des responsables sont contestés. D'autres au contraire y voient le signe d'un renouveau. Avignon, une fois de plus, est au cœur d'une polémique. France Culture a choisi de revenir moins sur cette polémique elle-même que sur les questions qu'Avignon a révélées : y a-t-il une crise du théâtre contemporain ? Entre théâtre, danse, arts plastiques, vidéo et performances, les frontières sont-elles en train de bouger ? L'exigence posée par Vilar d'un théâtre populaire a-t-elle vécu ? Quelle place pour les artistes, pour les programmateurs ? Tous ces sujets seront abordés au cours de ce « Radio libre » diffusé en direct depuis le théâtre de la Bastille où se succèderont tables rondes et débats. France Culture se devait d'être le lieu où s'expriment ces interrogations et où s'esquisseront peut être quelques voies de réponse. »
602.
Carole Talon-Hugon, Avignon 2005, le conflit des héritages, Du Théâtre, Hors-série n°5, juin 2006, p. 3.
Partie I. Chapitre 4. 3. c. i.
L’affrontement de deux conceptions de l’art
Pour Carole Talon-Hugon, la polémique ne doit pas s’appréhender comme la manifestation d’une énième querelle entre les Anciens - les Modernes - et les nouveaux Modernes que seraient les Postmodernes. Pour la philosophe il s’agit plutôt d’un conflit entre deux héritages, source d’un différend 603 entre deux conceptions de l’art qui, « issues toutes deux du XVIIIe siècle européen » 604 et presque consubstantielles lors de leur genèse, ont ensuite évolué jusqu’à s’opposer comme deux voies / voix inconciliables, l’esthétique de la réception et la métaphysique d’artiste. La philosophe voit dans la première « une esthétique dont les maîtres mots sont ceux d’attitude désintéressée, de plaisir esthétique et de jugement de goût » 605 tandis que pour qualifier la seconde « les termes clés sont ceux de génie, de création, d’originalité, d’intention et de risque. » 606 Pour les premiers, la leçon racinienne reste valable selon laquelle « la principale règle est de plaire et de toucher. » 607 De la tragédie antique à la tragédie classique, la monstruosité humaine est certes thématisée et verbalisée à l’envi, mais elle n’est jamais représentée sur la scène, pour des raisons très diverses 608 mais avant tout parce que cette violence ferait à l’instant disparaître d’un même mouvement le spectateur et le spectacle :
‘« Lorsque l’affect est trop fort, il empêche l’accommodation sur le caractère artistique de la représentation. L’intransitivité est rendue impossible. Dans le cas où c’est une action trop sanglante et trop atroce qui est figurée sur la scène tragique, écrit à son tour Hume, « les mouvements d’horreur [ excités ] ne s’adouciront pas en plaisir. La plus grande force d’expression, consacrée à des descriptions de cette nature, parvient seulement à augmenter notre malaise. » 609 Là s’arrêtent les pouvoirs de transmutation de l’art. » 610 ’
Pour les autres au contraire, le théâtre 611 vise non plus tant à représenter qu’à exprimer la violence du monde, et ne se situe pas exclusivement dans le champ esthétique : Ce sont à la fois les sujets de la violence et ses modes de présence sur la scène qui oeuvrent à détruire toute distance entre le spectateur et ce à quoi il assiste et qui excèdent l’esthétique moderne :
‘« Alors que, de l’Antiquité à l’âge classique, on répugne à la mise en scène de la violence et a fortiori, de l’actualité violente, à Avignon, au contraire, cette proximité avec une violence réelle et actuelle est constamment revendiquée. Autour de cette question des émotions extra-esthétiques antithétiques d’une contemplation conçue en termes d’attitude désintéressée, se rassemblent un grand nombre des critiques de Jan Fabre. Ainsi Brigitte Salino déplore-t-elle les « décharges électriques » provoquées par Anéantis et, plus largement, condamne ces œuvres qui laissent « sous le choc mais passifs face à un spectacle asséné, sans respiration » et Jean-Claude Raspiengeas se demande si le public vient « pour subir des électrochocs à jet continu. » » 612 ’
Notes
603.
Au sens donné à ce terme par Jean-François Lyotard. Jean-François Lyotard, Le Différend, Paris, Minuit, 1983.
604.
Carole Talon-Hugon, Avignon 2005, le conflit des héritages, op. cit., p. 8.
605.
Ibid, p. 61.
606.
Idem.
607.
Préface de Bérénice, 1660, citée par Carole Talon-Hugon, op. cit., p. 10.
608.
Qu’il s’agisse de la volonté d’Aristote de se démarquer des jeux du cirque ou de l’interdit judéo-chrétien à l’origine de la règle des bienséances du XVIIe siècle français.
609.
David Hume, De la tragédie, 1755.
610.
Carole Talon-Hugon, op. cit., p. 21.
611.
Nous employons ici ce terme de façon générique pour désigner en fait ce que l’on nomme parfois aujourd’hui spectacle vivant, en gardant à l’esprit qu’il s’agit de formes qui mêlent étroitement théâtre, danse, performance et arts plastiques.
612.
Ibid, p. 23.
Partie I. Chapitre 4. 3. c. ii.
D’une esthétique de la beauté et du plaisir
à une esthétique de la violence et de la souffrance ?
L’esthétique dont témoignent ces spectacles nous paraît à analyser comme basculement non seulement de la distance et de la réflexion à la perception physique, mais également basculement du plaisir à la souffrance. Et les partisans de la programmation du Festival s’accordent sur la nécessité de dépasser, de retravailler cette esthétique du Beau et du plaisir, où à tout le moins de les redéfinir puisque Jan Fabre se définit comme un guerrier de la beauté alors que ses détracteurs lui reprochent précisément de la détruire. Tous ces artistes et critiques valorisent l’expérience esthétique de la souffrance, supérieure au plaisir jugé facile et emblématique de la société de consommation :
‘« Tout se passe à Avignon comme si cette question du plaisir esthétique était devenue déplacée, voire inconvenante. Assimilé au divertissement (« nous ne proposons pas un théâtre de divertissement » précise le directeur du festival 613 ), le plaisir, considéré comme une « catégorie molle, générale et réconfortante » 614 , est stigmatisé : certains disent même craindre « ces enthousiasmes fusionnels [qui] rappellent trop les stades ou les phénomènes religieux intégristes. » 615 On oppose à la recherche du plaisir, la noble difficulté d’un art austère : « l’ascèse constitue l’élément central du pacte de réception à Avignon » 616 affirme-t-on volontiers. Présentant les choses sous la forme tranchée d’une alternative, certains déclarent leur refus du divertissement bourgeois et de la somnolence postprandiale au profit du rapport civique à la création » 617 et George Banu lance aux spectateurs cette injonction qui résume parfaitement le différend : « Oubliez le plaisir au profit du défi. » 618 ’
Plutôt que d’opposer au plaisir la souffrance et la violence, comme le font partisans et détracteurs du Festival, il nous paraît plus juste de suivre Carole Talon-Hugon quand elle les pose comme deux types de plaisirs distincts, rappelant l’observation de Saint-Augustin selon laquelle le spectateur prend plaisir à ressentir au théâtre des passions dont il veut faire l’économie dans la vie.« Le spectateur veut de ce spectacle ressentir l’affliction, et en cette affliction consiste son plaisir. » 619 L’on peut en définitive considérer que les spectacles incriminés procurent bien un plaisir, mais un plaisir non esthétique :
‘« Si l’horreur, l’indignation, la pitié et le dégoût sont des émotions non pas négatives mais ambivalentes, la difficulté à les admettre dans le champ de l’expérience de l’art semble s’amoindrir : si l’abject n’est pas seulement repoussant, mais à la fois repoussant et fascinant, dans l’art comme dans la réalité, le spectacle de l’abject provoque, entre autres choses, un plaisir. Mais il faut alors remarquer que si on considère que l’abject provoque une fascination, alors la représentation faiblit l’attrait de l’abject. C’est le sens de la remarque de Burke […] selon laquelle un théâtre où se trouve représentée l’histoire la plus touchante et la plus parfaite se viderait en un clin d’œil à l’annonce qu’une exécution publique va avoir lieu sur la place voisine. C’est que la représentation artistique n’a pas la puissance attractive du spectacle réel. […] Donc, […] si on affirme que le dégoût n’est pas un sentiment entièrement négatif mais ambivalent, la représentation artistique de l’abject affaiblit trop celui-ci : le dégoûtant ne l’est pas assez. Ainsi donc, ce plaisir – si plaisir il y a – est foncièrement inesthétique. Il fait accourir plus vite vers un accident de la route que vers le théâtre. Il faut donc bien effectivement conclure à l’absence de plaisir esthétique dans les spectacles incriminés. Sur ce point aussi le différend éclate : les uns déplorent cette absence, les autres l’acceptent. » 620 ’
Reste à s’entendre sur la définition à donner au terme « plaisir esthétique », car il est question dans les citations qui précèdent d’une conception de l’esthétique héritée des Lumières. Or l’on peut considérer que les artistes de théâtre dont les œuvres ont fait l’objet de la polémique, s’inscrivent dans une autre tradition esthétique, dont Baudelaire pourrait être considéré comme l’un des représentants, et qui se fonde précisément non pas sur l’optimisme moral des Lumières mais sur un pessimisme anthropologique qui nous paraît être l’ancêtre de celui décrit chez E. Bond et consorts. L’analyse que propose Luc Boltanski de la « souffrance à distance » nous paraît à ce titre éclairante. 621 Posant pour point de départ une relation archétypale dans laquelle un malheureux souffre, et un spectateur le regarde, Boltanski distingue différentes topiques. Les deux premières sont liées à des postures morales. La « topique de la dénonciation » est centrée sur l’émotion d’indignation éprouvée par le spectateur devant le spectacle, et sur la figure du persécuteur, tandis que la « topique du sentiment » est centrée sur l’émotion d’attendrissement et sur la figure du bienfaiteur. A l’inverse, la troisième alternative, la « topique esthétique », se fonde sur une autre posture du spectateur face au spectacle de la souffrance. Il ne s’agit pas d’une posture immorale liée à la recherche d’un plaisir pervers, qu’il soit sadique – lié à la jouissance de voir souffrir autrui – ou masochiste – lié à la jouissance de souffrir par procuration. Il s’agit donc d’une posture a-morale :
‘« Ce peintre regarde la souffrance du malheureux et la peint. […] en peignant les souffrances du malheureux ; en en dévoilant l’horreur et, par là, en en révélant la vérité, il leur confère la seule forme de dignité à laquelle elles puissent prétendre et qui leur est procurée par leur attachement au monde du déjà peint, du déjà révélé dans un registre esthétique. […] On aura reconnu ici le portrait du dandy, tel qu’il se trouve exposé dans les écrits théoriques et critiques de Baudelaire et, particulièrement, dans l’essai qu’il consacre à Guy, Le Peintre de la vie moderne. » 622 ’
Cette posture esthétique du spectateur se fonde sur un pessimisme anthropologique comme en témoigne le rejet chez Baudelaire de l’association héritée des Lumières entre la nature, le beau et le bien : « " La plupart des erreurs relatives au beau naissent de la fausse conception du XVIIIe siècle relative à la morale. La nature fut prise dans ce temps-là comme vase, source et type de tout bien et de tout beau possible. " A cette fausse conception est substitué un portrait de la nature directement emprunté à Sade : " C’est elle qui pousse l’homme à tuer son semblable, à le manger, à le torturer. "» 623 Et c’est ce pessimisme anthropologique qui fonde à la fois le rejet de la morale héritée des Lumières et qui fonde cette conception de l’esthétique qui nous paraît toujours à l’œuvre chez les artistes dont il est question dans la polémique évoquée ici. Si nous avons choisi de développer l’exemple que constitue la programmation du Festival d’Avignon 2005, c’est comme emblème d’un phénomène qui affecte de manière beaucoup plus vaste la dramaturgie et la scène non seulement française mais européenne :
‘« Où que l’on regarde, en particulier du côté des jeunes écrivains anglais, allemands, autrichiens, ou des anciens pays de l’Est, une très grande violence, dans ce qu’elle peut avoir de plus direct, de plus physique, le franchissement de tous les interdits, jusqu’à la sauvagerie, jusqu’à la barbarie, semblent traverser et caractériser les nouveaux produits de la littérature dramatique. Que ce soit Kane ou von Mayenburg, Goetz ou Srbljanovic, leurs textes renvoient les drames antérieurs, sinon du côté de la comédie ou du théâtre pour enfants, du moins à une littérature qui ne se fondait pas encore sur la brutalité offerte ni sur la « production de véritables électrochocs esthétiques », pour employer l’expression de Jean-Pierre Sarrazac. » 624 ’
Notes
613.
Vincent Baudriller, La Provence, Le Contadin, 29 juillet 2005.
614.
Georges Banu, Le cas Avignon 2005, Regards critiques, sous la direction de G. Banu et B. Tackels, Paris, L’Entretemps, 2005, pp. 226-227.
615.
M-M. Corbel, ibid, p. 151.
616.
J.-L. Fabiani, D. Malinas, E. Ethis, ibid, p 50.
617.
Idem.
618.
Carole Talon-Hugon, op. cit.,p. 26.
619.
Saint-Augustin, Les Confessions, Livre 3, chapitre 2. Cité par Carole Talon-Hugon, op. cit., p. 27.
620.
Ibid, p. 31.
621.
Nous reviendrons de manière beaucoup plus détaillée sur ce concept pour analyser les autres cités.
622.
Luc Boltanski, La Souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique, Paris, Métailié, 1993, p. 170.
623.
Ibid., p. 172.
624.
Catherine Naugrette, Paysages dévastés, op. cit., p. 156.
Partie I. Chapitre 4. 3. d.
La violence et la transgression des codes de la représentation,
outils politiques du théâtre contemporain ?
‘« Qu’il soit dramatique ou « postdramatique », qu’il se compose de mots, de cris ou de gestes, s’incarne dans le drame ou la performance, le théâtre est devenu, depuis les années 1990, "un théâtre des corps-souffrances", qui vise "à la démonstration publique du corps, de son destin, en un acte qui ne permet pas de séparer de manière sûre l’art de la réalité. Il ne dissimule point que le corps est voué à la mort, il le souligne au contraire. 625 "’
‘Dans l’immédiateté du théâtre qui s’écrit, qui se joue et s’expérimente aujourd’hui, il n’est plus question, à la limite, d’une image catastrophique du monde, mais d’une vision panique. […] Il ne s’agit plus d’écrire sur la violence, mais bel et bien d’écrire dans la violence. Dans ces dramaturgies de l’au-delà du pire, le mécontentement du monde s’exprime par un style panique. » 626 ’
On assiste dans le théâtre contemporain à un déplacement du mode de présentation des conflits sur la scène de théâtre, à un passage d’une esthétique du conflit et du drame représenté à la mise en présence, autrement dit à ce que nous appellerons une « esthétique de la violence » qui recouvre un spectre plus large que la performance stricto sensu :
‘« Le théâtre se mue en performance ou flirte avec elle. La performance supprime le re- de la représentation : la chose ou l’événement n’est pas représenté mais présenté. Le caractère fictif des objets disparaît alors. Les spectacles de Jan Fabre, sans être à proprement parler des performances, leur empruntent beaucoup […] il ne fait pas de doute que Jan Fabre inonde de véritable sang le plateau de la scène de Je suis sang, et que les acteurs urinent vraiment dans Histoire des larmes. Ces spectacles développent donc des stratégies d’intéressement qui contreviennent à l’impératif kantien de désintéressement.
La formule de Jerome Stolnitz définissant l’attitude esthétique comme une « contemplation portant sur n’importe quel objet de conscience quel qu’il soit pour lui seul » 627 est ici inapplicable. » 628 ’
Ce qui change est l’objet représenté, la violence brute, et partant son mode de représentation, plus explicite, moins métaphorique et en apparence intransitive.
Notes
625.
Hans-Thies Lehmann, Le théâtre post-dramatique, traduit de l’allemand par Philippe-Henri Ledru, L’Arche, 2002, pp. 170-171.
626.
Paysages dévastés, op. cit., p. 156.
627.
D. Lories (dir.), Aestheticcs and the philosophy of Art criticism, Houghton Mifflin co., Boston, 1960 ; trad. Franç. in Philosophie analytique et esthétique, Klincksieck, Paris, 1988, p. 105.
628.
Carole Talon-Hugon, op. cit., p. 19.
Partie I. Chapitre 4. 3. d. i.
Une violence réellement subie par l’artiste et par le spectateur
Cette esthétique marquée par la violence induit en termes de réception un basculement du « faire comprendre » au « faire éprouver ».
En conséquence il devient impropre de parler uniquement de conflits pour analyser ces nouvelles formes dramaturgiques et scéniques, en ce que les antagonismes ne sont plus représentés, il n’y a plus d’articulation entre le particulier et le général par le biais de personnages. Les acteurs ne représentent plus ni même n’incarnent plus de personnages qui figureraient ces positions antagonistes, ils expriment parce qu’ils l’éprouvent une souffrance censément éprouvée par tous, ils sont, au sens étymologique, les témoins des conflits de leur société, ses martyrs.
Ce basculement s’origine dans une conception différente de l’art, centrée non plus sur l’objet artistique mais sur l’activité et donc sur la figure de l’artiste. C’est ce qui explique de la part de cette lignée le recours aux termes de « démarche » et de « proposition » préférés à celui de spectacle, ainsi que le rejet du jugement sur la qualité de ces spectacles, une question jugée dépassée et déplacée. 629
Le génie de l’artiste réside dans la fidélité à sa nécessité intérieure et donc dans l’indifférence aux traditions. Mieux, le critère du génie devient l’originalité, et l’artiste est celui qui « expose des « univers singuliers » 630 ,
des mondes personnels et uniques. » 631 Cette valorisation de la nouveauté et de l’originalité explique en grande partie l’omniprésence obsédante de la transgression et de la provocation dans l’œuvre de ces artistes, censée réveiller le spectateur-consommateur assoupi car repu par un art confortable, et censée choquer les « bourgeois » (vocabulaire explicite dans la citation de G. Banu mentionnée plus haut.)
Notes
629.
« « Dans cette 59 ème édition du Festival d’Avignon, certains spectacles sont marquants, d’autres ne resteront pas gravés dans le marbre, mais là n’est pas l’essentiel » déclare B. Tackels [ Le cas Avignon, op. cit., p. 202 ] et à propos de After/Before Philippe Vial affirme « l’entreprise de Rambert est forte et ambitieuse et si le résultat est mitigé, quelle importance ». [Charlie Hebdo, 27 juillet 2005. ] On ne peut dire plus clairement que l’essentiel n’est pas la valeur. La formule de G. Banu proclamant avoir choisi « l’étonnement contre la perfection » [ Le cas Avignon, op. cit., p. 232 ] est à cet égard éloquente. » Carole Talon-Hugon, op. cit., p. 35.
630.
Bruno Tackels, Le cas Avignon, op. cit., p. 232.
631.
Carole Talon-Hugon, op. cit., p. 43.
Partie I. Chapitre 4. 3. d. ii.
Subversion et subvention :
la question de la radicalité politique de la violence
C’est donc précisément le potentiel politique et l’efficacité d’une telle provocation, que contestent les détracteurs de la programmation du festival et de cette justification :
‘« Du libéral Figaro au vaguement gauchisant Nouvel Obs, on avait stigmatisé le choix du Flamand Jan Fabre comme artiste associé au Festival (puisque c’est ainsi que fonctionne la nouvelle formule). Pas de quoi fouetter un chat : on connaissait l’homme que je peine à qualifier d’artiste, ses spectacles « à l’estomac », ses provocations copiées-collées de celles des années soixante, soixante-dix, mais bon, noyé dans la masse des autres invités, on n’y aurait vu que du feu. Las, cette fois-ci c’est lui qui a fait masse (quatre propositions plus une exposition à lui consacrée à la Maison Jean Vilar), et il semble que ce soient les « autres » qui aient adopté sa logique (bien) pensante. Car Jan Fabre, et ceci n’est pas un paradoxe, est un bien-pensant oeuvrant, avec habileté certes, dans l’espace, celui d’une soi-disant contestation, que notre société a bien voulu lui accorder. Il n’est pas le seul, et l’on remarquera que, de ce point de vue, cette dernière édition du Festival était d’une extrême cohérence. Une cohérence même par trop compacte et ostentatoire cette fois-ci. C’est le trop-plein de propositions spectaculaires allant dans le même sens, enfonçant les mêmes portes ouvertes, en faisant un usage abusif des mêmes signes (ceux de la nudité systématique, des simulations véristes des actes sexuels, de la fellation à la sodomie) qui a fini par lasser et créer l’esquisse d’un mouvement sinon de protestation, du moins de rejet. […] » 632 ’
Le recours à la transgression n’est pas propre au théâtre – de même que la postmodernité a été théorisée prioritairement dans le champ des arts plastiques – aussi l’invalidation du prétendu potentiel critique et politique de cette attitude artistique est logiquement venue prioritairement d’esthéticiens spécialistes de l’art contemporain. L’on pense à la stigmatisation par Rainer Rochlitz de l’art subversif subventionné – et souvent subventionné au titre même de sa subversion – ou aux analyses de Nathalie Heinich sur l’Elite artiste 633
ou Le triple jeu de l’art contemporain 634 , qui ont bien mis en lumière le processus de réaction-récupération consécutif à toute nouvelle forme de transgression, source d’une surenchère perpétuelle, le critère de transgression devenant la condition sine qua non de son succès. De la même façon l’on a beaucoup parlé des spectacles incriminés lors de l’édition 2005 du festival d’Avignon, contribuant à faire exister des spectacles qui sans la polémique n’auraient sans doute pas laissé un souvenir mémorable. Plus fondamentalement, c’est la question de la possibilité de transformer la critique en critique politique, et plus précisément en critique de gauche, pour des spectacles se fondant sur un pessimisme anthropologique radical et s’inscrivant dans ce que nous avons appelé avec Luc Boltanski la « topique esthétique » :
‘« La topique esthétique est-elle de gauche, est-elle de droite ? Penchée vers la droite par sa composante élitiste, par sa préférence pour l’affirmation (en opposition à la justification et au débat) et par son goût pour les forts (opprimés par les faibles) et pour les héros solitaires et tragiques, elle penche vers la gauche quand, mettant l’accent sur la défense d’un accusé (rejeté par la société), elle se lie à la dénonciation, et se donne pour adversaire principal la vision sentimentale du malheur (" les bons sentiments ") […]. Mais ce compromis conserve toujours (à la façon, par exemple, dont l’esthétique surréaliste fait alliance avec la "révolution") un caractère tactique. La topique esthétique est à gauche, mais de façon critique, pour la subvertir et la dépasser. Elle s’accorde la lucidité d’une avant-garde. » 635 ’
La question du positionnement concret sur l’échiquier politique des artistes se revendiquant de cette lignée, peut être considérée dans son lien avec la question de la figure que ces artistes promeuvent à travers leurs spectacles et leurs discours : la figure du héros maudit, du génie solitaire « exilé sur le sol haut milieu des huées », qu’il s’agisse de l’individu-artiste ou, au plus, d’une avant-garde minoritaire, que ses « ailes de géant empêchent de marcher » mais aussi de s’engager absolument et définitivement dans l’action collective aux côtés du peuple en lutte. Il importe donc de lire ces discours de dénonciation radicale dans leur lien avec la volonté de décrire une situation réelle déplorable, et avec la volonté consécutive de changer la situation dénoncée.
Notes
632.
Jean-Pierre Han, « La fausse querelle d'Avignon », Les Lettres Françaises, publié dans Le Cas Avignon 2005, op. cit. pp. 153-161.
633.
Nathalie Heinich, L’élite artiste, excellence et singularité en régime démocratique, nrf, Gallimard, 2005.
634.
Nathalie Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain, Paris, Minuit, 2002.
635.
Luc Boltanski, La Souffrance à distance, op. cit., p. 228.
Partie I. Chapitre 4. 3. d. iii.
Un choc qui « parle à tous » ou une esthétique élitiste ?
Il serait erroné de réduire l’esthétique de la réception inscrite dans ces écritures au seul choc physique dans la mesure où ces propositions artistiques mobilisent un important intertexte.
Elles apparaissent en définitive extrêmement élitistes à leurs détracteurs, dans la mesure où pour dépasser la répulsion ou la lassitude, le spectateur doit inscrire l’œuvre dans la démarche non pas tant esthétique que philosophique de l’artiste et, alors qu’elles clament leur originalité voire leur volonté de rupture, ces œuvres semblent ne pouvoir s’appréhender qu’en référence à l’histoire de l’art occidental.
Il s’agit au sens propre d’une métaphysique de l’art, au-delà de l’immanence de l’œuvre représentée sur la scène. Les artistes commentent parfois eux-mêmes leur œuvre, qui selon eux ne se réduit pas à leurs productions scéniques, ce qui contribue à l’exaspération de ceux pour qui le théâtre ne devrait être jugé qu’à l’aune de l’espace-temps de la représentation et se suffire à soi-même :
‘« […] L’on nous donne à croire qu’on pense ailleurs que dans les spectacles. D’où cette accumulation de documents, de gloses écrites et parlées accompagnant les propositions scéniques :
Jan Fabre avec sa revue Janus, Castellucci avec ses diverses publications. Tout cela étant relayé par le Festival lui-même (débats, « théâtre des idées », etc.). » 636 ’
On retrouve alors la même situation que pour une partie de l’art contemporain, l’œuvre devant pour être comprise s’accompagner d’un mode d’emploi, dont la profondeur réside surtout dans la multiplicité de références que le spectateur peut choisir de convoquer – faute de quoi une certaine impression de vacuité l’envahit. Se pose donc la question de la compétence du public, et la critique se trouve facilement invalidée au titre de « philistinisme » ou de paresse intellectuelle voire de ressentiment, en tous les cas d’une forme de stupidité, comme en témoigne cette citation de Jan Fabre, l’artiste associé à la programmation de l’édition 2005 du Festival 637 :
« Les gens qui ne comprennent pas croient qu’on les provoque. Rien n’a changé depuis 25 ans que je travaille. C’est triste ; la stupidité est toujours prête à surgir. » 638
C’est donc bien en tant que démarche intellectuelle autant qu’existentielle et non en tant qu’œuvre artistique que les artistes demandent que leur travail soit jugé. Mais le jugement qu’ils portent sur leurs détracteurs vise à invalider leur jugement esthétique du fait non seulement d’une incompétence esthétique mais aussi d’une stupidité plus générale, voire d’une méchanceté. L’ignorant devient ainsi un adversaire politique, jugé réactionnaire dans sa conception de l’art mais aussi dans son être même. Autre paradoxe, ce théâtre postmoderne réactive d’un même mouvement deux idées modernes s’il en est, l’idée d’avant-garde éclairée combattant l’obscurantisme et la figure romantique du poète prophète, en avance sur son temps. Jan Fabre déclare d’ailleurs avoir « parlé au public du futur. » 639
Notes
636.
Jean-Pierre Han, op. cit.
637.
Nous ne mentionnons ici Jan Fabre qu’à ce titre et il ne s’agit pas pour nous d’étudier directement ses spectacles, lesquels ne nous semblent pas tous réductibles à l’une des options cristallisée lors de la polémique.
638.
Jan Fabre, cité par Dominique Frétard, « Il faut réapprendre à pleurer », Le Monde, 5 juillet 2005.
639.
Jan Fabre, bilan public du Festival, le 26 juillet 2005. Cité par Carole Talon-Hugon, op. cit., p. 53.
Partie I. Chapitre 4. 3. d. iv.
Ne plus juger mais comprendre, ne plus débattre mais expliquer
Le différend paraît donc à la fois irréconciliable et impensable pour les artistes, ce qui nous pousse à réexaminer sous un angle un peu différent la question précédemment abordée du traitement du conflit. Les artistes en question font des spectateurs récalcitrants un adversaire, pour mieux leur refuser ensuite ce statut au prétexte qu’ils ne sont pas des égaux. Ce ne sont pas des adversaires et il n’est pas question d’un différend, ce sont des ignorants ou des incompétents, à éduquer et tel est le rôle dévolu au critique, qui ne doit juger ni évaluer mais expliquer 640 ,
servir d’interprète, d’intermédiaire entre la bonne parole de l’artiste-prophète et le public profane. Et ce besoin d’une herméneutique de la violence emblématise bien l’aporie qui guette ce type de théâtre. Centré sur la violence, il agit en tant qu’il choque, mais ceux qui le comprennent ne sont plus choqués et inversement ceux qui sont choqués ne le comprennent pas. Au-delà ou en-deçà, le spectateur paraît n’être jamais à l’endroit de l’œuvre. Et ce paradoxe semble exemplifié par le rapport que ce théâtre entretient à la violence télévisuelle. Le risque majeur de ces « propositions artistiques » tient en effet à leur démarche ambivalente qui refuse la mimesis comme principe esthétique mais entretient un rapport mimétique au réel ou à tout le moins au réel représenté par la télévision, montrant la violence de la même façon, sans mise à distance, et déniant de la sorte au théâtre sa qualité d’hétérotopie, de lieu autre, dissonant, et sa qualité d’utopie, de lieu idéal, porteur d’espoir. Au terme de la contemplation critique des Paysages Dévastés, Catherine Naugrette renvoie d’ailleurs, à la suite de Jean-Pierre Sarrazac, à cette idée du théâtre comme « lieu déterritorialisé, un peu utopique » et c’est à ce titre qu’elle et lui optent pour un théâtre qui « se construirait, non plus dans la vitesse et dans la violence de la kinesthétique moderne » 641 mais dans « le ralentissement du cours de la vie en tout cas. Comme si on avait accès, par le théâtre, à une autre perception des choses. » 642
Notes
640.
Le parallèle entre la stratégie de ces hommes de théâtre et celle des tenants du néo-libéralisme est d’ailleurs saisissant. Les uns et les autres partagent cette idée que leur voie est la seule possible, car la seule découlant d’une description fidèle du monde. Il s’agit dès lors de la faire comprendre à ceux qui ne sont pas encore éduqués (rôle généralement dévolu aux médias dominants), au lieu de considérer qu’il s’agit d’une idéologie, une vision du monde s’affrontant à ce titre à une autre.
641.
Paysages dévastés, op. cit., p. 160.
642.
Jean-Pierre Sarrazac, in Théâtres du moi, théâtres du monde, Villégiatures/Essais, éditions Médiane, 1995, p. 332-333.
Partie I. Chapitre 4. 3. d. v.
Herméneutique de la violence ou choc intransitif ?
Entre la violence scénique et la violence télévisuelle,
l’intangible frontière du sens
Le reproche essentiel adressé aux écritures (scéniques) en question porte précisément sur le fait qu’alors qu’elles visent à subvertir les codes antérieurs de la représentation théâtrale, elles flirtent dangereusement avec la représentation quotidienne de la violence telle qu’on peut la trouver à longueur de journée sur les écrans télévisuels :
‘« Brigitte Salino résume en ces termes l’exaspération partagée : "on n’en peut simplement plus de voir reproduit au théâtre, comme un décalque, ce que la télévision et les journaux écrivent et montrent dans les pires moments de la guerre" 643
et Régis Debray dénonce dans les justifications produites par les auteurs de ces œuvres, le recours à une fausse alternative : "Maints auteurs donnent l’étrange sentiment d’avoir un choix douloureux à opérer. Soit écrire sur ce qui arrive, soit choisir l’éloignement. Comme si Vitez ne nous avait pas prévenus : "Le théâtre est un art qui parle d’ailleurs et d’autrefois." Comme si Lorenzaccio ne nous avait pas parlé de Staline, ou l’Alcade de Zalamea des putschistes d’Alger, ou le Meurtre dans la cathédrale d’Eliot des pouvoirs totalitaires… Pour l’ici et maintenant, n’y a-t-il pas la télé ? " 644 » 645 ’
Au contraire, selon les partisans de cette lignée artistique, la violence sur la scène et la violence télévisuelle diffèrent non dans leur manifestation mais dans leur intention. Filmée, la violence gratuite est insupportable, alors que portée sur la scène, elle devient nécessairement riche de sens. Cette idée est d’ailleurs accréditée par certains spectateurs. 646
Cette idée d’une transitivité de la violence, moyen d’accès au sens, nous paraît doublement discutable. Tout d’abord, si les artistes recourent à cette violence, c’est bien aussi avec la finalité de choquer les spectateurs dont ils titillent à la fois l’instinct voyeur et le remords de cette jouissance, jouissance au second degré en quelque sorte pour reprendre une formule de Jean-Loup Rivière 647 ,
et il paraît donc faux d’établir une distinction radicale entre leurs intentions et celles des grands médias. On va voir Jan Fabre entre autres pour être choqué ou à tout le moins pour voir comment il cherche à choquer, la transgression constituant l’une des marques de fabrique de l’artiste. En second lieu, un certain nombre de spectateurs est choqué précisément parce que le sens de cette (dé-)monstration de violence lui échappe. Se trouve à nouveau convoqué par les partisans de ce théâtre l’argument de l’intertexte, mais le spectateur qui ne possède pas les clés pour mettre à distance la violence et se situer dans le registre d’interprétation et non du choc et de la réaction spontanée n’a pas accès à la signification de ces objets artistiques. Qui plus est, ces derniers n’incitent pas le spectateur même le plus cultivé et pétri de références philosophiques et esthétiques à une réception analytique, attentive à la démarche ayant abouti à un tel résultat. Le choc est intransitif, difficilement dépassable, et voulu par les artistes précisément comme tel. L’un des paradoxes de cette esthétique réside dans le fait qu’elle récuse tout en la convoquant la notion de transcendance, puisque la réception immanente de l’œuvre ne permet pas d’accéder à son sens alors même que « l’essentiel est que le spectateur comprenne le sens de la démarche du créateur. » 648
La violence signe-t-elle la fin, le terme de la représentation théâtrale, et le signe intransitif de ce nouveau théâtre, à la fois signifiant et signifié, ou fonctionne-t-elle comme voie d’accès, comme signe, à interpréter dans un registre encore et toujours sémiotique, renvoyant à un sens au-delà du choc reçu – et peut-être rendu possible par lui ?
Notes
643.
Brigitte Salino, « Anéantis. Guerre et fait divers tissés jusqu’à l’insoutenable », Le Monde, 12 juillet 2005.
644.
Régis Debray, Sur le pont d’Avignon, Flammarion, Paris, 2005, pp. 30-31.
645.
Carole Talon-Hugon, op .cit., p. 23.
646.
« La violence qui est insupportable est celle qui est gratuite, au ras des pâquerettes. Dans le spectacle ici […] elle avait un sens. Dans une œuvre d’art la violence est toujours ouverture à un autre niveau. » Une spectatrice, Le cas Avignon, op. cit., p. 37.
647.
Jean-Loup Rivière, invité de l’émission Tout arrive dirigée par Arnaud Laporte sur France Culture le lundi 28 août 2006, a employé la formule à propos du spectacle Naître de Edward Bond, mis en scène par Alain Françon dans le cadre du Festival d’Avignon.
648.
Vincent Baudriller, La Croix, 9-10 juillet 2005.
Partie I. Chapitre 4. 3. d. vi.
Violence gratuite ou signification politique de ce théâtre ?
Quel est le sens, caché ou revendiqué, de la violence qui caractérise ce théâtre ?
Peut-on qualifier le travail de ces artistes de théâtre politique, et si oui en quoi ?
Retournant en boomerang le reproche qui leur était adressé, certains détracteurs attaquent précisément l’idéologie manifeste dans les spectacles pour son caractère rétrograde, stigmatisant notamment une conception très judéo-chrétienne d’un corps marqué par la Chute originelle :
‘« Vide, médiocrité, mais certainement pas comme l’ont souligné certains commentateurs, absence de sens. J’irai même jusqu’à dire que le sens et l’idéologie traversant tous les spectacles est plus que présent. Simplement ce sens, cette idéologie ne sont guère ragoûtants.
Qu’est-ce que nous raconte le fameux « Chevalier du désespoir », la figure centrale de l’Histoire des larmes, de Jan Fabre ?
Qu’est-ce que cette curieuse exaltation du corps, de son unité renvoyant à une théorie du sujet lorgnant vers le spiritualisme, avec retour au Moyen Âge, balayant les théories d’un Nietzsche ou d’un Michel Foucault ?
Dans cette nouvelle configuration le sado-masochisme exalté et chez Jan Fabre et chez quelques autres prend une place centrale.
Que l’on ne nous dise pas qu’il y a absence de sens. » 649 ’
Notes
649.
Jean-Pierre Han, « La fausse querelle d’Avignon », op. cit.
Partie I. Chapitre 4. 3. d. vii.
Un rejet des formes traditionnelles de théâtre politique
Il apparaît en tout cas évident que si ces artistes prétendent à une dimension politique, c’est dans le rejet ou la mise à distance des anciens modèles. En premier lieu, ce théâtre s’inscrit sans surprise dans le rejet catégorique du modèle théâtral et politique du théâtre à thèse, et revendique d’être un théâtre non de la réponse, mais de la question, ou plus exactement de la démultiplication de questions dont le but consiste à « donner à penser le monde » 650 , « interroger l’humain dans ses contradictions » 651 , et « nous amener à nous poser des questions. » 652 » 653
Mais ce théâtre rejette également la forme traditionnellement privilégiée du théâtre politique dans l’institution théâtrale française, le théâtre populaire – que nous analyserons en détails en tant que seconde cité du théâtre politique. C'est ainsi en se référant à la traditionnelle fonction civique du théâtre, seule légitimation d'un théâtre public subventionné, via une interrogation de la façon dont doit se réinventer aujourd'hui la catégorie du théâtre populaire (catégorie esthétique mais aussi catégorie définie par une certaine attention au public), que Robert Abirached analyse la polémique. 654
Et alors que les détracteurs du Festival d’Avignon, agitant notamment le spectre de Vilar 655 , convoquaient à l’envi la notion de théâtre populaire 656 ,
les partisans de la programmation paraissent tous d’accord pour rejeter cette référence, le populaire, souvent assimilé dans leurs propos au populisme, prenant une connotation nettement péjorative. 657
L’argument se veut donc pour partie politique, mais il renvoie également comme nous l’avons vu à une conception différente de l’art(iste) et de sa fonction.
Un tel théâtre manifeste plus globalement une rupture radicale avec le public et pas uniquement avec le public bourgeois – bien que le public de théâtre à même de comprendre ce théâtre soit d’ailleurs sociologiquement composé des classes moyennes doté d’un bon capital économique et culturel.. Un public bourgeois donc.
Enfin, nous l’avons vu, ce théâtre met à distance le théâtre brechtien.
S’il rejette donc les principales formes historiques du théâtre politique, qu’en est-il de son ancrage politique direct ?
Notes
650.
G. Banu et B. Tackels, Le cas Avignon, op. cit., p. 21.
651.
V. Baudriller, ibid,, p. 21.
652.
Une spectatrice, op. cit., p. 36.
653.
Carole Talon-Hugon, op. cit., p. 58.
654.
« L'histoire du Festival d'Avignon, qu'on le veuille ou non, à la fois dans la configuration des lieux, dans le style d'accueil du public, dans la demande de ce public, demeure marquée par cette idée d'un rendez-vous avec le théâtre français et avec le théâtre populaire.
Théâtre populaire au sens d'un théâtre d'art ouvert à tous, défini par Vilar - tout en étant ouvert à la modernité. Or, depuis six ans, les objectifs d'origine se sont inversés :
le Festival est devenu un grand événement international.
Avignon a connu une transformation totale de l'esprit du lieu.
On l'a bien vu cette année. Le théâtre populaire était à la marge du Festival.
Je pense au travail de Jean-François Sivadier, à Olivier Py, à l'absence de Philippe Caubère dans le « in »... […] tous les projecteurs étaient braqués sur des formes, pas inintéressantes d'ailleurs, mais dont l'accumulation était lassante.
L'obsession de certains thèmes, autour de la sexualité, de la déréliction et de la violence, a aussi posé problème. […] » Robert Abirached, « Le théâtre de texte confronté à celui des images », Le Monde, 06.09.2005.
655.
« On n’a rien contre la danse, mais plus on diminue l’espace du théâtre, plus on diminue l’espace de l’ensemble.
On a le droit de le déplorer. C’est là, pour le coup, que le message de Vilar serait trahi :
pas pour une question d’esthétique, mais pour la perte de la réflexion collective qu’apporte le théâtre ».
Jean-Pierre Léonardini. Cité par M.-J. Sirach, « Avignon, à quand une révolution au palais ? », L'Humanité, 19. 12. 2005.
656.
Olivier Py organisa le 22 mai 2006 une rencontre au Théâtre du Rond-Point intitulée « Peut-on encore parler de théâtre populaire ? » avec la participation de Christian Esnay, Denis Guénoun et Jean-François Sivadier.
657.
Nous pensons notamment au titre évocateur de l’article de Jean-Pierre Tolochard, « Le ver du populisme », in Le cas Avignon 2005, op. cit., p. 97.
Partie I. Chapitre 4. 3. d. viii.
Un théâtre de gauche ?
Les partisans de la programmation du Festival ont abondamment stigmatisé le caractère réactionnaire des détracteurs, le qualificatif portant non seulement sur le jugement esthétique mais sur le bord politique des critiques 658 ,
omettant le fait que certains commentateurs d’extrême gauche (Jean-Pierre Léonardini 659 )
se trouvaient en l’occurrence d’accord avec des journalistes écrivant dans la presse de droite (Armelle Héliot.) Dans la mesure où les artistes eux-mêmes incitent comme nous l’avons vu à ne pas appréhender leurs spectacles en les découplant d’une démarche existentielle, notre analyse de la dimension politique de leur théâtre ne saurait donc faire l’économie de leurs faits et gestes publics extra-scéniques. A ce titre la perception de Jan Fabre, qui voit dans l’édition 2005 « un festival contre le populisme et contre la droite, par les questions qu'il a soulevées » 660 et estime avoir lui-même combattu « sur les barricades » 661 ,
se doit selon nous, de tenir compte de son attitude à l’égard d’un combat politique qui, bien que très peu médiatisé et marginalisé, étouffé par la rumeur de la polémique artistique, fut cependant âprement mené durant cette même édition, le combat des artistes et techniciens du spectacle contre le nouveau protocole des intermittents. Quand il revient sur le Festival, Jan Fabre rappelle incidemment que le spectacle Histoire des Larmes fut « créé à Avignon dans des circonstances difficiles (la première fut bloquée pendant quarante minutes par les intermittents.) » 662
La cible politique de Jan Fabre est l’extrême droite flamande (le siège de sa compagnie Troubleyn se situe d’ailleurs sur les terres nationalistes du Vlaams Belang) mais pour le reste, ses prises de positions politiques paraissent peu abondantes et non systématiquement ancrées à gauche, ce dont témoigne également son discours sur l’art, peu conforme aux positions traditionnelles de la gauche en matière culturelle. En dernière analyse, si la violence de ce théâtre peut être considérée comme politique, c’est en tant qu’elle constitue une crise de la représentation théâtrale qui serait le reflet d’une crise de la (représentation de la) politique.
Notes
658.
Nous pensons notamment aux propos de Bruno Tackels stigmatisant la « France moisie » et mettant explicitement en relation la polémique du Festival, le Non au référendum et l’accession au Second tour de l’élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen le 21 avril 2002, lors de la rencontre organisée le 15 décembre 2005 par Chantal Meyer-Plantureux à la Maison de la Photographie, en présence de Bruno Tackels, Georges Banu, Jean-Pierre Léonardini et Régis Debray.
659.
L’idée d’être jugé réactionnaire stimula s’il en était besoin la verve du critique communiste : « Dans le fond, c’est la démarche du critique qui vous dérange. Avant, j’étais stalinien ; aujourd’hui, je serais un vieux réactionnaire. On ne peut défendre un Festival médiocre en soutenant qu’il témoigne d’une rupture épistémologique. Surtout que Jan Fabre n’est pas un perdreau de la dernière nichée :
s’il représentait l’avant-garde, ça se saurait ! » Jean-Pierre Léonardini. Cité dans « Avignon, à quand une révolution au palais ? », op. cit.
660.
Article intitulé « Avignon : Jan Fabre réplique » mis en ligne sur le site de La Libre Belgique le 18/11/2005.
661.
Idem.
662.
Idem.
Conclusion sur l’esthétique de la violence et sur la polémique d’Avignon
Cette esthétique de la violence se veut du même mouvement une violence faite à la notion de représentation et une violence faite aux esthétiques passées, de la dramaturgie aristotélicienne (les tragédies contemporaines, loin de constituer l'assise mentale du politique, fondent son impossibilité en oblitérant toute émergence d'une communauté humaine), de la dramaturgie hégélienne (refus de « l'apaisement éthique » 663 et du « contentement » 664
du spectateur par l'émergence d'une vérité qui vient clore la fable) mais aussi et surtout épique (la décomposition et l'inachèvement de la fable épique venaient dire la nécessité de l'action directement politique et faisaient directement déboucher le théâtre sur la possibilité de changer le monde. Il importe donc de corréler étroitement crise de la représentation esthétique et crise de la représentation politique : cette esthétique émane de l’ère mentale et civilisationnelle qui s’ouvre dans les années 1970, marquée par une crise de la représentation politique et réciproquement de la représentation théâtrale :
‘« Comme le souligne Michel Deutsch : "Aujourd’hui, la représentation (dans le triple sens de déléguer, de placer devant, de rendre présent à nouveau…) est en crise. Donc, que je le veuille ou non, je suis condamné à travailler cette crise de la représentation." 665
Si l’on considère que la problématique esthétique de la représentation consiste à penser "la représentation comme régime de pensée de l’art, de ce qu’il peut montrer, de la façon dont il peut le montrer et du pouvoir d’intelligibilité qu’il peut donner à cette monstration." 666 […]
Ce qui est en jeu, c’est l’effondrement de l’image du monde. Tant dans ses pouvoirs d’imitation et dans sa dimension réflexive, que dans ses pouvoirs d’exposition. » 667 ’
Le théâtre postpolitique vise en définitive à fonctionner comme un garde-fou de la conscience contemporaine, et c’est pour cette raison qu’il se devrait d’être violent :
‘« Un conte africain dit qu’un arbre produisait deux types de fruits. Les uns étaient savoureux et comestibles, les autres sur une autre branche, infects et mortels. Longtemps les hommes s’accommodèrent de cela en apprenant à tous sur quelle partie de l’arbre il fallait cueillir les fruits. Un jour, il fut décidé de se séparer de la branche inutile. On la coupa. L’arbre mourut aussitôt. Ce mal lui donnait la sève. Venons-en au théâtre public, auquel il est souvent reproché par les temps qui courent de faire de la déréliction un culte, de la souffrance mise en scène une obsession et de la noirceur sa couleur préférée. […] Coupons la branche de la visibilité du mal et vivons dans la béatitude des corps à consommer. Le risque d’équarrissage annonce une pauvreté plus large. Faire croire qu’on en avait fini avec les figures du mal reviendrait à éliminer la figure humaine sous toutes ses formes. Le XXe l’a prouvé, corps et biens. » 668 ’
La parabole utilisée par R. Cantarella est significative de la justification moins politique que morale de cette esthétique de la violence, fruit d’un monde chaotique et incompréhensible, et qui ne réfléchit pas sur ce monde mais le réfléchit, l'exprime. Dans ce théâtre-réalité, mimétique de la relation directe entre l'individu dépolitisé et la violence du monde, le corps – de l’acteur et du spectateur – devient le réceptacle d’un choc qui n'est plus médiatisé par la réflexion critique et la mise à distance, les convulsions d’un corps nu incarnant en quelque sorte le chaos herméneutique comme le martyr du sens et de l’humanité. Cette définition du théâtre repose sur un pessimisme anthropologique et politique, mais aussi sur une conception religieuse du « corps-souffrance » pour reprendre la formule de C. Naugrette. Il y est moins question des fautes politiques que de la faute de l’Homme, dans un théâtre plus philosophique et métaphysique que politique et esthétique, du fait du déplacement précédemment évoqué de l’œuvre vers l’artiste, qui « met brutalement en crise nos consciences et nous oblige à prendre un questionnement critique face au monde. » 669
Ainsi E. Bond met bien la notion de conflit au fondement du théâtre, mais le pose en termes non plus politiques mais axiologiques :
‘« Le site du théâtre est l’agôn […]. L’agôn se produit toujours dans la situation extrême. Toujours à cette extrémité deux opposés se font face : l’humain et l’inhumain. Dans l’agôn, ils se mènent l’un l’autre à leur extrémité. Ils ne peuvent partager le monde. La mise en jeu de cela a toujours été l’objet du théâtre. Les acteurs portent le fardeau de l’humanité. Dans l’agôn, le public choisit l’humanité ou la vengeance sur l’humain. » 670 ’
La violence, la provocation dont font montre ces artistes peuvent s’expliquer peut-être par le sentiment de rage éprouvé face à la découverte de l’incapacité du théâtre à changer le monde. Et ce doute du théâtre quant à sa propre efficace en tant qu’action politique s’accompagne d’un autre, plus omniprésent encore, celui concernant la possibilité et le bien-fondé de porter un regard global, une critique systémique, sur ce monde.
Notes
663.
Georg Wilhem Friedrich Hegel, Cours d'esthétique, (Vorlesung über die Ästhetik (1832-édition posthume), in Werke, tome XV, édité par Eva Moldenhauer et Karl Markus Michel, Frakfurt am Main, Suhrkamp, 1970, trois volumes), trad. Jean-Pierre Lefebre et Veronika von Schenk, Aubier (Bibilothèque philosophique), trois volumes, 1997. vol. III, p. 518.
664.
Ibid, p. 516.
665.
Michel Deutsch, Le théâtre et l’air du temps, Inventaire II, L’Arche, Paris, 1999, p. 106.
666.
Jacques Rancière, « S’il y a de l’irreprésentable », L’art et la mémoire des camps. Représenter, exterminer, Rencontres à la maison d’Izieu, « Le genre humain », Seuil, Paris, décembre 2001, p. 81.
667.
Catherine Naugrette, Paysages dévastés, op. cit., p. 67.
668.
Robert Cantarella, « Le mal public », Frictions, Ecritures - théâtres, n°3, automne-hiver 2000, p. 11.
669.
A. Berfolini, Le cas Avignon, op. cit., p. 174, cité par C. Talon-Hugon, op. cit., p. 58.
670.
Edward Bond, « Des gens saturés par l’univers », LEXI/textes 4, Inédits et commentaires, Théâtre National de la Colline, L’Arche éditeurs, Paris, 2000, pp. 117-118.
Enjeux esthétiques et politiques de la « crise de la représentation »
à l'œuvre dans la cité du théâtre postpolitique
La crise de la représentation esthétique à l’œuvre dans la cité du théâtre postpolitique peut s’entendre comme la conséquence d’une crise de la représentation politique, à la fois au sens où la classe politique censée représenter le peuple dans notre démocratie est remise en cause par la société civile, artistes compris, et au sens où l’idée même d’une représentation du monde est également remise en cause. Le fondement de la représentation théâtrale s’est donc affaissé à mesure que s’est effondrée l’idéologie moderne née des Lumières : la foi dans la raison et dans l’humanité, dans l’histoire et dans le progrès, fondait la possibilité d’une action politique de type révolutionnaire, visant à changer le monde. Et le théâtre pouvait alors puiser dans cet espoir pour fonder une représentation conçue comme propédeutique de la réalité, voire de l’action politique. A l’inverse, la cité du théâtre postpolitique, dont le principe supérieur commun est un pessimisme anthropologique et polique radical, s’inscrit dans le mouvement philosophique post-moderne et réinvestit fortement la référence à la Shoah désormais déshistoricisée, considérée comme la preuve non plus de la nécessité de l’action politique mais de l’impossibilité de l’humanisme, de l’histoire et de la politique. Ce pessimisme anthropologique laisse ouvertes deux postures. La première consiste en un repli sur la sphère esthétique : il ne saurait y avoir de révolution qu’esthétique désormais et le référent du réel est tout simplement évacué. Cette posture nous intéresse en tant que discours de légitimation car l’argumentation s’articule au politique pour justifier l’évacuation de la politique. L’autre posture nous intéresse d’autant plus qu’elle est non seulement largement présente en tant que discours de légitimation mais aussi en termes de spectacles. Elle consiste à regarder le monde non plus en face mais de l’intérieur, dans un abandon de la position surplombante. Plusieurs options se dessinent alors : se focaliser sur le changement de paradigme du théâtre et dire l’impossibilité de dire le monde, ou exprimer le caractère incohérent et contradictoire du monde. Cette volonté se reflète alors dans l’abandon de la fable ou du personnage transformés en kaléidoscope. La décomposition revêt une forte portée intertextuelle et l’on peut à ce titre qualifier le théâtre postpolitique d’esthétique des ruines.
Ce théâtre qui théorise la rupture radicale n’en est pas moins pétri de références à l’histoire théâtrale, singulièrement au drame, qu’il soit aristotélicien ou épique, et il fait jouer l’un contre l’autre ces deux modèles, comme des citations dont le recyclage ne sert qu’à creuser davantage le fossé anthropologique infranchissable qui les en sépare. Cette dé-construction généralisée est aussi source de violence. La décomposition de la fable et du personnage, ajoutés à l’abandon du principe du point de vue globalisant et distancié, engendrent des écritures scéniques qui fragmentent le sens et les êtres, qui ne représentent plus mais présentent la violence, éprouvée par l’acteur et par le spectateur. Le théâtre postpolitique déconstruit donc également le pacte scène / salle, et cette nouvelle réception programmée par les spectacles, qui mise sur l’inconfort voire le choc, génère parfois des malentendus mais aussi des rejets. Car l’idée que la présentation du pire l’empêchera d’advenir, l’ambition du théâtre postpolitique de fonctionner comme instrument de veille en quelque sorte, n’est pas comprise par tous, d’autant moins que les spectacles ne travaillent pas toujours la question de la jouissance qu’il y a à présenter « le Mal. »
Le théâtre postpolitique contemporain peut en définitive se définir par l'ambivalence de sa relation au politique, référence maintenue pour être sans cesse minée de l'intérieur, centre en creux d'esthétiques et de discours de légitimation qui, soit opèrent sur le mode du repli, soit sur le mode méta-discursif, soit sur le mode de l'atomisation du politique et de l'humain, décrivant un monde fragmenté comme l'est l'humanité. Davantage qu'un théâtre qui interroge le sens de l'humain, il nous semble que c'est un théâtre de l'inhumanité qui veut témoigner de l'absence de sens, de l'impossibilité d'un sens, et donc d'une histoire, comme de l'Histoire – un théâtre politique paradoxal, donc. Toute une série d'événements politiques internationaux depuis la Seconde Guerre Mondiale :
les totalitarismes et l'effondrement de l'idéologie marxiste – mais également des phénomènes politiques plus diffus, à l'échelle nationale – la crise démocratique de la Vème République, l'effondrement du militantisme et des corps intermédiaires, l’aplanissement du clivage gauche / droite, la professionnalisation et la dépolitisation des acteurs culturels et des artistes – expliquent l'ampleur du phénomène que recouvre aujourd'hui sur les scènes comme dans les débats le théâtre « d'après la catastrophe » et plus largement l'ensemble des dramaturgies, écritures scéniques et discours d'artistes que nous avons regroupé sous le terme « théâtre postpolitique. »
Mais c'est moins en tant que conséquence inéluctable qu'en tant qu'interprétation idéologique de ces données socio-historiques que le théâtre postpolitique doit être pensé.
En effet, le théâtre – artistes et membres de l’institution théâtrale – ont activement participé à la redéfinition de l’art et de la culture.
Et, à partir d’une interprétation différente des mêmes événements, et d’une réflexion parallèle sur la notion d'humanité, tout un autre pan du théâtre contemporain français va poser la nécessité ravivée d'un théâtre politique oecuménique, au travers notamment de la référence à la notion de service public.
|
|
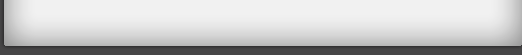 |
|