Partie II. Chapitre 3.
Chapitre 3.
Le théâtre populaire contemporain
comme théâtre d’art
Introduction.
Le renouveau du « théâtre d’art »
depuis les années 1980
ou la redéfinition de l’utopie de l’art kantienne
‘« Si l'on devait aujourd'hui, et aujourd'hui plus encore qu'il y a dix ans, faire vœu pour un théâtre d'art, il faudrait qu'il puisse redonner sens à l'étrange alliance de mots de cette formule rebattue, théâtre populaire. Le théâtre est autant archaïque que novateur, il est un miroir du monde et le contraire du journalisme, il est de la pensée pure sans être discursif. Comment peut-il […] rester populaire en étant minoritaire ? Ou comment passer d'un théâtre élitaire pour tous à un théâtre salutaire pour chacun ? » 1269 ’
Ces propos, prononcés par Olivier Py en mai 2006, prolongent le débat suscité par l’édition 2005 du festival d’Avignon entre partisans et détracteurs du « théâtre populaire », et attestent de l’évolution argumentative suggérée par notre chapitre précédent. La légitimation du « théâtre populaire » ne passe plus tant par la référence à sa « mission de service public » conçue en termes de démocratisation du public, que par la spécificité de l’art en général et du théâtre en particulier en tant que discours sur le monde. Le « théâtre d’art » vient ainsi compléter, voire préciser le sens à donner à l’expression « théâtre citoyen. »Pour O. Py, le théâtre est doté d’une fonction civilisatrice en ce qu’il tend un miroir critique au monde et à la société sans être pour autant « discursif », et l’artiste voit sa spécificité renforcée au sein de la plus large communauté des intellectuels, au point de s’en démarquer. En ce sens, la conception de l’art implicitement contenue dans le propos de O. Py renoue avec l’esthétique kantienne totalement évacuée dans la cité du théâtre postpolitique.
Dans La Critique de la faculté de juger 1270 , Kant se consacre à un type spécifique de prétention à l’universalité. Le jugement de goût diffère du jugement de connaissance, en ce qu’il rapporte la représentation non pas à la désignation de l’objet mais au sentiment qu’éprouve le sujet face à l’objet 1271 , ce qui le démarque radicalement de l’universalité cognitive et logique, et pourrait de ce fait rendre problématique la communication de ce sentiment. Pourtant, le jugement esthétique prétend lui aussi au statut de communicabilité universelle a priori, mais avec la précision qu’il s’agit d’une « communicabilité universelle […] subjective. » 1272 Est beau ce qui plaît « sans concept » 1273 et fait l’objet d’une « satisfaction universelle » 1274 et « désintéressée. » 1275 La communication se fait chez Kant « communion des expériences esthétiques » 1276 , puisqu’elle ne passe pas par la médiation de concepts, mais elle diffère de la communion en ce que le beau suscite un partage verbal. La Critique de la Faculté de juger tente ainsi de « résoudre le problème capital de la philosophie moderne : l’intersubjectivité. […] Dans l’acte esthétique, l’homme affirmant l’universalité de son sentiment dépasse son moi et rejoint autrui. » 1277
Cette intersubjectivité peut être entendue de deux façons, et suscite ainsi deux interprétations du projet kantien qui, sans être exclusives l’une de l’autre, constituent la matrice de deux définitions modernes de l’art. Soit l’on insiste sur la construction de l’ouvrage, et sur le fait que le jugement esthétique s’articule pour Kant au jugement téléologique. Pour fonder l’universalité d’une communication purement subjective, d’un « sens commun esthétique » 1278 , Kant convoque d’ailleurs la notion d’« état d’esprit. » 1279 En ce sens, Kant annonce la conception religieuse de l’art théorisée par Schiller 1280 puis par les Romantiques 1281 , articulée à la figure de l’artiste comme mage et comme prophète. Et O. Py, fervent catholique, s’inscrit dans cette conception de l’art et plus spécifiquement encore du théâtre comme royaume de la « pensée pure », non discursive et « salutaire », autrement dit destinée à œuvrer au salut de l’individu. Mais le fait que la Critique de la Faculté de juger ait été publiée en 1790, soit juste après le déclenchement de l’événement, capital pour Kant, que constitue la Révolution Française, peut conduire à interpréter ce texte « dans la perspective du projet égalitaire des Lumières, avec sa portée politique. » 1282 De fait, l’universalité en droit du goût est interrogée par Kant à la fin de la « Dialectique du jugement esthétique » en relation avec l’inégalité de fait de la communauté humaine, y compris dans son versant culturel :
‘« Une telle époque et un tel peuple devaient donc d’abord découvrir l’art de la communication réciproque des Idées des classes les plus cultivées avec les plus incultes, l’adaptation du développement et du raffinement des premières à la simplicité naturelle des secondes, et, de cette manière, devaient trouver entre la culture supérieure et la modeste nature l’intermédiaire qui constitue aussi pour le goût, en tant que sens commun humain, la juste mesure qui ne peut pas être donnée par des règles universelles. » 1283 ’
La question kantienne devient alors, pour reprendre la formule de J. Rancière, de savoir « par quelles voies peut passer une égalité de sentiment qui donne à l’égalité proclamée des droits les conditions de son exercice réel. » 1284 Kant pose l’universalité du jugement esthétique et récuse politiquement « l’absolutisation de l’écart entre la " nature " populaire et la "culture" de l’élite. » 1285 L’on peut alors considérer, comme le fait Y. Michaud, que Kant inaugure une utopie de l’art corrélative de l’utopie de la citoyenneté, en ce que « l’universalité formelle du jugement de goût et la sociabilité communicationnelle qui la garantit et qu’elle garantit, non seulement anticipent l’égalité à venir, le devenir réel de l’utopie citoyenne, mais contribuent à sa réalisation. » 1286 Le monde n’est plus pensé comme étant dans son principe, et donc « irrémédiablement » 1287 , « partagé entre les plus cultivés et les plus incultes, puisqu’il y a précisément cette universalité formelle du jugement de goût » 1288 , et l’art ainsi défini, parce qu’il rappelle l’universalité présente en tout homme et l’égalité a priori entre les hommes, « vient étayer et redoubler l’égalité citoyenne par ailleurs posée » 1289 , et constitue un principe de transformation et de civilisation en acte de l’humanité. 1290
De ce point de vue, l’on mesure que la conception de O. Py rompt avec l’utopie démocratique associée à l’utopie de l’art kantienne. Jugeant indépassable le décalage entre l’égalité et l’universalité de droit du jugement esthétique et la minorité de fait du théâtre, il conserve de l’utopie kantienne la forme spécifique de la communicabilité esthétique, de l’ordre de la communion intersubjective, mais la découple de toute ambition – et plus encore de toute réalisation – d’un projet émancipateur et égalitaire, autrement dit la découple de l’utopie démocratique. O. Py estime d’ailleurs que le théâtre est moins en crise en ce début de XXIe siècle que dans les années 1980 précisément parce qu’il a su « fai[re] le deuil du théâtre comme grand média, porteur de changements pour la société. » 1291 L’inscription dans la lignée du théâtre populaire se fait donc au prix d’une mise à distance d’un des deux aspects non seulement de l’idéal vilarien, mais même du mot d’ordre de Vitez, qui prônait un « théâtre élitaire pour tous ». Vilar et Vitez tenaient pour consubstantiellement liées la conception a priori de l’œuvre d’art comme objet d’une admiration universelle avec la volonté d’un élargissement réel de la composition du public, tandis que O. Py découple ces deux ambitions, estimant que l’on peut faire un théâtre populaire et pourtant minoritaire. Salutaire pour chacun, le théâtre populaire selon O. Py abandonne à la fois sa mission pédagogique et sa mission collective, autrement dit rompt avec l’idéal républicain contenu jusqu’alors dans la lignée œcuménique du théâtre populaire. Ce faisant, il radicalise également la rupture esthétique de cette lignée avec la lignée d’un théâtre populaire de classe. Les propos de Py érige le journalisme, mais aussi, implicitement, le théâtre documentaire en repoussoir, lui opposant ce que l’on pourrait nommer une esthétique de la transfiguration. Rappelons que O. Py refuse l’appellation « théâtre politique » 1292 parce qu’il refuse de ravaler son œuvre artistique au rang d’instrument au service d’un propos politique préalable et prééminent. Il récuse même l’expression « théâtre citoyen » qui porte en germe les mêmes dérives selon lui :
‘« Cette idée d'utilité civique du théâtre me gêne. On ne peut pas demander au théâtre de résoudre la fracture sociale ou de réparer la couche d'ozone. En revanche, on peut faire ce que j'appellerais un théâtre de l'inquiétude, ou de l'impatience. Un théâtre qui se soucie du monde avec ses propres armes : l'actualité, c'est le vent dans les yeux d'Homère. […] On ne s'adresse pas qu'au citoyen, on s'adresse au mortel. C'est très fondamental : si on perd cette idée, on va perdre le théâtre lui-même, on va perdre l'art. Ce mortel qui peut réfléchir sur les institutions démocratiques ou la place de l'étranger dans la société doit aussi méditer sur sa propre caducité, sur la vanité du pouvoir, sur des choses qui dépassent les faits de société. C'est ce que je veux dire quand je parle de théâtre populaire plus que de théâtre citoyen. » 1293 ’
Le théâtre et l’action politique sont deux choses bien distinctes, qui peuvent se juxtaposer mais non se mêler, et sont très clairement hiérarchisées. La conception que se fait O. Py de l’artiste et du théâtre populaire mérite de ce fait pleinement sa transsubstantiation en théâtre d’art. Pour mieux cerner les enjeux portés par cette formule, nous avons fait le choix de nous centrer sur un fait qui nous paraît emblématique, la relecture, la réécriture presque, de l’œuvre de Brecht en général, et de La vie de Galilée en particulier.
Notes
1269.
Présentation de la Rencontre du 22 mai 2006 animée par Olivier Py au Théâtre du Rond Point dans le cadre de La grande Parade de Olivier Py, présentation disponible sur le site du Théâtre du Rond-Point.
1270.
E. Kant, Critique de la faculté de juger (1790), trad. Alexis Philonenko, Paris, Vrin, 1968.
1271.
Ibid., p. 49.
1272.
Ibid., p. 60.
1273.
Ibid., p. 55.
1274.
Idem.
1275.
Idem.
1276.
Yves Michaud, op. cit., p. 234.
1277.
Alexis Philonenko, Introduction à la Critique de la Faculté de Juger, Paris, Vrin, 1980, p. 10.
1278.
Kant, op. cit., p. 128.
1279.
Ibid., p. 78.
1280.
Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme (1795), trad. Fr. Paris, Aubier, 1992.
1281.
Pierre Bénichou, Le temps des prophètes. Doctrines de l’art romantique, Paris, Gallimard, Bibliothèque des Idées, 1977, et Les mages romantiques, Paris, Gallimard, Bibliothèque des Idées, 1988.
1282.
Yves Michaud, op. cit., p. 235.
1283.
Kant, op. cit., paragraphe 60, p. 1147
1284.
Jacques Rancière, Le philosophe et ses pauvres, Paris, Fayard, 1982, p. 283.
1285.
Ibid., p. 283.
1286.
Yves Michaud, op. cit., p. 237.
1287.
Idem.
1288.
Idem.
1289.
Ibid., p. 240.
1290.
Ibid., pp. 240-241.
1291.
Olivier Py, « On ne peut pas demander au théâtre de résoudre la fracture sociale », propos recueillis par Fabienne Darge et Nathaniel Herzberg, Le Monde, 04. 05. 2007.
1292.
O. Py, Libération, 22 janvier 1999, article cité.
1293.
Olivier Py, « On ne peut pas demander au théâtre de résoudre la fracture sociale », article cité.
1. Les réceptions successives de Brecht en France,
manifestations d’une évolution idéologique. 1960-1980
Suivant sur ce point comme sur nombre d’autres l’analyse effectuée par Bernard Dort, il nous paraît que l’évolution de la réception de l’œuvre de Brecht en France, et plus exactement, l’évolution de l’articulation entre son œuvre et son propos idéologique, de même que l’évolution de l’interprétation de ce propos idéologique, sont emblématiques de l’évolution historique de l’idéologie dominante au sein de la communauté théâtrale en France.
a. Les années 1960,
la réception du poète marxiste.
Une génération d’épigones
La première réception de Brecht dans les années 1960, s’est inscrite « dans l’idéologie du théâtre populaire » au sens le plus militant de ce terme, dans une époque où le clivage gauche / droite s’exprime dans toute sa force en France :
‘« Brecht apparaissait alors comme la pierre de touche de ce théâtre populaire et politique dont rêvait la décentralisation. Il faisait aussi figure d’épouvantail : aux yeux du théâtre commercial établi comme à ceux des notables locaux de droite ou du centre, il était synonyme d’endoctrinement ou de subversion. Ce Brecht-là était le fruit d’un compromis entre la stylisation française, héritée de Copeau et du Cartel, et l’imitation du Berliner Ensemble. » 1294 ’
Il y avait des désaccords éventuels au sein même de ses partisans, reflets des différences croissantes entre la position du TNP et celle de la revue Théâtre Populaire – laquelle taxait certaines mises en scène de « sommaires et teintées de populisme » 1295 , mais ces désaccords n’étaient rien au regard du clivage entre ces partisans et les détracteurs du dramaturge allemand, opposés en deux camps idéologiques et politiques. 1296
Notes
1294.
Bernard Dort, « La traversée du désert. Brecht en France dans les années 80 », Théâtre / Public n°79, janvier-février 1988, p. 7.
1295.
Idem.
1296.
Dort rappelle ainsi qu’il n’était pas envisageable à cette époque que Brecht soit joué par la Comédie Française.
b. Les années 1970
ou l’affranchissement à l’égard de la doxa brechtienne
L’hégémonie de Brecht, mais aussi – surtout ? – celle de ses épigones, va être violemment remise en cause après Mai 68, notamment via une pétition de Guy Scarpetta. Une autre lecture de Brecht apparaît alors, et B. Dort se souvient que, « plus que celui des "grandes pièces ", c’était, déjà, celui des " pièces didactiques ", des œuvres de jeunesse et des " fragments " » 1297 que la nouvelle génération entendait mettre en exergue. Le spectacle de Jean-Pierre Vincent et Jean Jourdheuil en 1968 (La Noce chez les petits-bourgeois), celui de Mathias Langhoff et Manfred Karge (Le Commerce du pain, en 1972), « marquent un affranchissement des modèles du Berliner Ensemble des années cinquante – à la fois par l’humour du spectacle, par un jeu allègre jusqu’à la férocité et par ce que l’on pourrait appeler une nouvelle matérialité scénique (empruntant à la peinture, à la " nouvelle figuration.") » 1298 Mais surtout, ces spectacles regardent l’œuvre de Brecht « comme un objet extérieur » 1299 et mettent à distance « toute la vulgate brechtienne. » 1300 Les travaux de Martin Esslin ont sans nul doute contribué à l’infléchissement de la réception. Rédigé en 1961 et publié en France en 1971, l’ouvrage Bertolt Brecht ou les pièges de l’engagement 1301 entend – déjà – « faire une critique de Brecht en tant qu’écrivain engagé » 1302 et analyser « l’attitude politique de Brecht et ses relations avec les autorités est-allemandes. » 1303 Et le but était déjà de « servir la renommée d’un écrivain et d’un homme trop grand pour être ravalé au niveau d’une simple image de propagande. » 1304 Deux lectures de Brecht coexistent en réalité dans les années 1970, dont l’une « penche du côté du théâtre d’intervention et d’agit-prop » 1305 qui se nourriront ensuite de « Dario Fo puis du théâtre de l’Opprimé d’Augusto Boal. » 1306 En ce cas « la dramaturgie brechtienne sert à court-circuiter la fiction scénique » 1307 tandis que dans l’autre lecture, qui consiste à rabattre Brecht « sur la question du théâtre, de la représentation en soi », 1308 induit à penser que la dramaturgie brechtienne « n’institue qu’une interrogation du théâtre sur lui-même. » 1309 Cette division des lectures méconnaît ainsi l’enjeu central de l’œuvre brechtienne, qui tenait précisément à la coexistence de ces deux enjeux tenus ensemble au cœur même du dispositif dramaturgique.
Notes
1297.
Idem.
1298.
Idem.
1299.
Ibid., p. 8.
1300.
Idem.
1301.
Martin Esslin, « Introduction à l’édition française », Bertolt Brecht ou les pièges de l’engagement, Paris, coll. 10/18, Union générale des éditions, 1971.
1302.
Ibid., pp. 14-15.
1303.
Idem.
1304.
Idem.
1305.
Bernard Dort, « La traversée du désert. Brecht en France dans les années 80 », op. cit., p. 8.
1306.
Idem.
1307.
Idem.
1308.
Idem.
1309.
Idem.
c. Les années 1980 :
La « traversée du désert. » (Dort.)
Au cours les années 1980 Brecht connaît en France une « traversée du désert », 1310 pour reprendre la formule de B. Dort. Il est peu joué, et l’on représente essentiellement les œuvres de jeunesse, teintées d’anarchisme et de poésie rimbaldienne. « On le tient pour ennuyeux, à moins qu’on ne le décrète dépassé. » 1311 Même « la vieille garde de la décentralisation » 1312 paraît l’avoir quelque peu oublié, pour ne rien dire de la critique. Dort cite notamment un article de Libération, paru à l’occasion du trentième anniversaire de la mort de Brecht, et dont le contenu paraît bien illustrer le climat idéologique de réception de l’œuvre de Brecht dans les années 1980 :
‘« Que Bertolt aille se faire dorer. Sale con ! Car s’il y a quelque chose à sauver chez Brecht et Weill, c’est […] d’abord ce réalisme poétique, ce " fantastique social " cher à Mac Orlan. On se tamponne du message bolchevik et de la " distanciation " brechtienne (la distance en question, on en connaît désormais la mesure exacte : 24 cm, la longueur d’un revolver Nagant, 7, 62 mm, l’arme de poing standard du NKVD. » 1313 ’
C’est donc le contexte idéologique qui explique essentiellement l’évolution de la réception de Brecht, de même que les retombées de ce contexte dans la définition de la fonction du théâtre :
‘« On peut parler ici d’un retour du refoulé. De ce qui s’était trouvé refoulé lorsque ce théâtre mettait au premier plan sa mission civique, politique, sinon révolutionnaire. En témoignent les choix de répertoire (constatons en gros, que Tchékhov a pris la place de Brecht pour ce qui est des " classiques modernes") et, plus encore, la conception que les acteurs se font de leur métier et le rôle que ce théâtre assigne à son public. […] Le narcissisme a, de nouveau, droit de cité. Une nouvelle vague de stanislavskisme, fortement teintée de reflets d’Actors’ Studio, déferle sur nos plateaux […], la scène, loin d’être considérée comme une estrade ou un podium, est revendiquée en tant qu’espace intime, privé […] un désir d’identification hante à nouveau le théâtre. » 1314 ’
L’on peut parler d’évolution du « climat intellectuel », dans la mesure où les conceptions esthétiques des artistes de théâtre et leurs évolutions découlent de celles de leurs conceptions idéologiques :
‘« Sans doute [ce climat intellectuel ] se caractérise-t-il, momentanément, par un renoncement à l’idée que la pensée est susceptible de changer le monde. Nous sommes passés du temps de la critique (voire celui de la pensée négative) à l’ère du constat. Certains intellectuels ont fait du marxisme leur bête noire. Souvent, ceux-là même qui, autour des années 68, l’avaient célébré comme la science et la philosophie mêmes. Ils avaient exalté Brecht – un Brecht annonciateur de ce qu’ils appelaient la pensée Mao-Tsé-Tung […]. Aujourd’hui, ils le rejettent au nom, précisément, de la caricature qu’ils en avaient faite alors […]" Brecht apparaît comme l’ultime exemple de cette monstruosité incontestée : l’art militant. " 1315 » 1316 ’
Dans les années 1980, du fait de l’évolution du contexte politique international, le processus de démythification entamé au cours des années 1970 s’accélère, et deux options se démarquent dans le rapport à Brecht, le rejet global du dramaturge communiste dans un premier temps, puis la dissociation du poète et du militant. La raison du rejet de Brecht est profonde, souligne alors Bernard Dort, et tient ni plus ni moins à sa conception de l’homme et du monde, au fait que, comme le disait le dramaturge dans une intervention, presque testamentaire, « pour pouvoir être " restitué par le théâtre ", il fallait que le " monde d’aujourd’hui " soit " conçu (et, ajoutait-il, "décrit") comme transformable. " […] Or, l’idéologie dominante actuelle, à la différence de celle des précédentes, doute de cette transformabilité, quand elle ne la récuse pas. Dès lors, à quoi bon Brecht ? » 1317 Et, dans la mesure où personne ne peut nier que Brecht est l’un des plus grands hommes de théâtre du XXe siècle, il va s’agir de dépoussiérer Brecht en le « désidéologisant », en l’inscrivant donc dans l’illustre autant qu’équivoque lignée du théâtre d’art.
Notes
1310.
Ibid., p. 6.
1311.
Idem.
1312.
Idem.
1313.
Phil Casoar, « New Weill, new wave », Libération .31 décembre 1985. Article cité par B. Dort, ibid., p. 7.
1314.
Ibid., pp. 8-9.
1315.
Guy Scarpetta, Brecht ou le soldat mort, Paris, Grasset, 1979.
1316.
Bernard Dort, « La traversée du désert. Brecht en France dans les années 80 », p. 9.
1317.
Idem.
2. La transfiguration de Brecht en héraut du théâtre d’art
Si le titre de notre thèse renvoie essentiellement à l’emprunt que nous faisons au concept sociologique de « cité » tel qu’établi par Luc Boltanski et Laurent Thévenot, il s’explique subsidiairement par la référence à un ouvrage intitulé Les Cités du Théâtre d'Art, de Stanislavski à Strehler 1318 , qui assoit la légitimité universitaire d'un concept né au tournant du XXe siècle dans la bouche des artistes, et qui se veut une somme chrono-logique, à la fois descriptive et prescriptive, assumant, revendiquant même les la « géographie variable » 1319 et les « contours incertains » 1320 d’une notion définie par deux constantes qui fondent et unissent sa nature protéiforme, d’une part précisément la « volonté de travailler de l'intérieur les données héritées du théâtre européen » 1321 , d’autre part le fait d’être « étrangère aux programmes autoritaires et aux horizons utopiques » 1322 . Si cette notion puise ses références et son ancrage dans l'Histoire, c’est dans une Histoire délibérément et « purement » théâtrale, et c’est donc contre le modèle du combat politique que se définit le « combat [du théâtre d’art], qui lui interdit de se reconnaître une identité autre que sa propre mobilité. » 1323 Nous souhaitons analyser de manière assez précise cet ouvrage qui nous paraît illustrer de manière synthétique une tendance à l’invalidation du « théâtre politique » au titre que cette conception serait historiquement datée et doublement entachée, sur le plan idéologique par sa promiscuité avec l’idéal communiste dont la réalisation s’est révélée effroyable, et sur le plan esthétique par l’idée de plus en plus répandue que tout théâtre à visée directement politique, instrumentalisant l’art, serait condamné à la médiocrité artistique.
Notes
1318.
Georges Banu (sous la direction de), Les Cités du théâtre d’art, de Stanislavski à Strehler, Éditions Théâtrales, 2000.
1319.
Georges Banu, « Les cent ans du théâtre d'art », ibid., p. 17.
1320.
Idem.
1321.
Ibid., p. 18.
1322.
Ibid., p. 17.
1323.
Ibid., p. 18.
a. Le « Théâtre d'art »,
un « théâtre populaire » et non un « théâtre politique »
L’idée d'une marche irrépressible et irréversible de l'Histoire sur laquelle les hommes n'auraient aucune prise semble par exemple animer Patrice Chéreau, ancien pourfendeur du théâtre bourgeois devenu oublieux de la devise de Théâtre Populaire selon laquelle « l'art peut et doit intervenir dans l'Histoire », et converti en héraut d'un théâtre qui se défend d'une quelconque préoccupation révolutionnaire, que ce soit en termes de contenu ou même d'esthétique. L’un des auteurs des Cités du Théâtre d'Art, Anne-Françoise Benhamou, retrace ainsi le parcours de l’ancien directeur démissionnaire du Théâtre de Sartrouville devenu en 1979 le fossoyeur du théâtre révolutionnaire, qui célèbre sa « mort exemplaire » et conspue sous la forme d'une autocritique les ambitions de la Déclaration de Villeurbanne 1324 :
‘« "Quand j'ai commencé à faire du théâtre, je suis entré à fond dans ces idées : le théâtre est un vrai combat, etc... Et on oublie que la personnalité du théâtre, c'est sa légèreté." Non sans provocation, c'est dans une revue marquée par ses choix politiques que Patrice Chéreau tient ces propos, à une époque où certains de ses détracteurs l'accusent avec violence de pratiquer un théâtre d'esthète, un théâtre aux raffinements décadents, désengagé, peu soucieux du contenu, réactionnaire sur le fond, un théâtre qui aurait renoncé à la recherche d'un nouveau public. Ce dont, à sa gauche, on fait alors grief à Chéreau, c'est d'avoir trahi son camp. En effet, son activité théâtrale s'était d'abord placée de la façon la plus nette sous le signe de Brecht - directement et indirectement via l'influence de Planchon et de Strehler. […] Par [son] premier spectacle [ L'intervention ] où s'entrelaçaient le thème de la lutte des classes et les jeux de la séduction, ainsi qu'avec les mises en scène qui suivirent, encore fondées sur les analyses marxistes, Chéreau rejoignait sans ambiguïté les rangs d'un théâtre intervenant justement, nourri de l'espoir d'un progrès social et historique, un théâtre confiant dans sa capacité à participer à la transformation du monde. En 1973 au contraire, comme le montre cette interview, le souci premier de Chéreau n'est plus "la fonction du théâtre dans notre société" […] mais bien l'artisanat du théâtre lui-même ; il semble s'intéresser plus au rapport du théâtre à sa propre mémoire […] qu'à son engagement dans l'Histoire. » 1325 ’
L’ancien ami de P. Chéreau, le critique Gilles Sandier, aura des mots très durs pour qualifier une évolution qui s’apparente à ses yeux à une trahison. 1326 Il semble donc que, si une grande partie de la génération de metteurs en scène propulsée sur le devant de la scène en Mai 1968 au nom d’ambitions et de pratiques révolutionnaires s’est depuis convertie au « théâtre d'art », entendu comme repoussoir d’un théâtre politique doublement coupable de compromission idéologique et de médiocrité artistique, d’autres contestent cette évolution. Ainsi, la notion de « théâtre d'art » condense les oppositions entre les différentes définitions du théâtre, qui constituent selon nous des frontières infranchissables entre la cité du théâtre postpolitique et la cité du théâtre politique œcuménique d’une part, et la cité du théâtre de lutte politique d’autre part. P. Ivernel a d’ailleurs qualifié cette définition « pure » du théâtre d’« idéologie esthétique » 1327 , qui n'est sepas compréhensible hors du contexte politique international et national contemporain. La notion de théâtre d’art se trouve également convoquée comme repoussoir par les détracteurs d’un théâtre hermétique et surtout dispendieux, dont les fastes sont jugés détachés de tout sentiment de responsabilité à l’égard des notions de service public ou de mission politique, retranché, replié sur l’art. Tel est l’avis rétrospectif de Robert Abirached, Professeur d'Université et ancien Directeur du Théâtre et des Spectacles de Jack Lang :
‘« Dans le domaine des arts, les années 1980 auront été marquées par un retour assez général à la frivolité, conforté par une défiance affichée à l'égard des prétentions de l'intelligence critique. De plus en plus communément, le grand public s'est accoutumé à considérer les œuvres de l'esprit et de l'imagination comme des produits que l'on lance, qu'on consomme et qu'on jette […] A mesure que le débat politique et social s'anémiait autour de lui et que les principales utopies inscrites jusqu'ici à l'horizon de l'histoire se délitaient l'une après l'autre, le théâtre subventionné a achevé de rompre avec la tradition qui l'avait fondé et qui parlait de public populaire, d'égalité culturelle, de pédagogie, d'engagement, de civisme et d'éthique. […] Au cours de la décennie [1980], la plupart des metteurs en scène ont défendu et illustré un théâtre d'art 1328 , qui a été pendant un long moment sensible à la fascination du jeu avec les images, avec ce qu'elle entraîne de décors dispendieux et de prouesses techniques onéreuses : ils se sont, par force et sans se l'être toujours avoué, accommodés du règne grandissant de l'argent, naguère honni par leurs prédécesseurs, pour mieux affirmer leur autonomie créatrice et le droit de chacun à son expression personnelle. 1329 Les troupes des centres dramatiques nationaux ont achevé de se dissoudre les unes après les autres, pour laisser la place au recrutement d'acteurs à la valeur marchande étroitement hiérarchisée […] » 1330 ’
La notion de « théâtre d’art » est donc moins à comprendre comme un concept historique que comme le lieu d’un affrontement entre différentes conceptions et légitimations du théâtre, et les auteurs du livre reconnaissent d’ailleurs que si le concept de « théâtre d'art » est né à la fin du XIXe siècle avant tout en rupture avec le « théâtre de loisir » ou théâtre de divertissement, il a ensuite davantage servi comme « repoussoir » voire comme « repli » d'un théâtre aux ambitions politiques :
‘« Lorsque les utopies déclinent et les idéologies refoulent, lorsque la marée basse du prométhéisme social arrive, l'on trouve refuge dans le théâtre d'art. Cela explique son retour dans les années trente après la vague d'espoir historique des années vingt, de même que son rappel dans les années quatre-vingt lorsque les espérances de 68 s'effondrent. On revient au théâtre d'art comme le fils prodigue à la maison du père. » 1331 ’
L’ouvrage relit donc l’histoire théâtrale à l’aune d’une définition du théâtre affranchie de toute inféodation politique, et c’est avec ce prisme qu’est notamment revisitée l’œuvre de Brecht.
Notes
1324.
Anne-Françoise Benhamou résume les ambitions de la Déclaration en ces termes : « Les signataires appelaient le théâtre public à réexaminer sa collusion avec la culture bourgeoise et à devenir enfin véritablement populaire par une politisation toujours accrue et par la recherche du "non-public. " » Anne-Françoise Benhamou, « Patrice Chéreau, utilité et futilité », in Les Cités du théâtre d'art, op. cit., p. 301.
1325.
Ibid, pp. 299-301.
1326.
« Quand je vois Chéreau ovationné par les douairières bavaroises, les dandys et les snobs de la nouvelle Europe, les amateurs d'Opéra et esthètes de tout poil, et même par les amoureux de musique capables cependant d'investir des francs lourds par milliers pour une semaine chez Wagner, quand je le vois, le soir de Lulu à l'Opéra, saluer Raymond Barre, Helmut Schmidt et Edouard Heath, je ne puis me défendre d'une vraie amertume. Oui, Patrice, je t'interpelle publiquement. Tu ne répondras pas ; les « Superstars » (!), ces minables idoles, usent toujours du mépris. Et pourtant, comment peux-tu sans honte, sans te renier, accepter de voir A. Mnouchkine occuper seule l'espace où tu avais naguère fait semblant de t'établir ? Comment peux-tu accepter, ayant été ce que tu fus, de te voir aujourd'hui le fournisseur domestique, patenté, glorieux et misérable, des maîtres de l'Europe ? Comment peux-tu accepter d'être absent depuis des années de tout travail théâtral en France, quand tu es encore en principe le principal co-directeur du TNP (Théâtre National Populaire, si je me souviens bien ?). Faut-il qu'une gloire imbécile t'ait fait perdre une tête qu'on croyait solide et digne d'être estimée ? Faut-il que tu te sois fait de cette gloire une idée habituelle et petite pour te couper ainsi de tout ce qui est, ici et maintenant, le tissu de notre histoire ? Cela, il fallait que je te le dise. C'est fait. Bonne chance à la Cour des maîtres. Pauvre Patrice. » in Théâtre en crise. Des années 1970 à 1982, Gilles Sandier, Paris, La Pensée sauvage, 1982, pp. 101-102.
1327.
P. Ivernel, « Postface », in Le théâtre d'intervention aujourd'hui, Etudes Théâtrales n°17, 2000, p. 138.
1328.
Nous soulignons.
1329.
Nous soulignons également. Cette idée a été largement reprise par Olivier Py lors de la rencontre précédemment évoquée sur le théâtre populaire (Théâtre du Rond-Point, 22 mai 2006.)
1330.
Robert Abirached, Le théâtre et le Prince, I. L'Embellie, 1981-1992, Arles, Actes Sud, 2005, pp. 202-203.
1331.
Ibid, p. 18-19.
b. Brecht,
emblème des enjeux idéologiques des Cités du théâtre d’art
La vraisemblance du portrait de Brecht en homme du théâtre d’art, qui n’est d’ailleurs pas nouvelle 1332 , semble accréditée dans l’ouvrage par le fait que c'est l'un des maîtres du théâtre d'art, Giorgio Strehler, qui le peint sous ces traits :
‘« Pour revenir au théâtre d'art au XXe siècle, je voudrais commenter un article que je trouve magnifique de François Regnault, paru dans la revue Théâtre en Europe n° 9 de 1986. Il s'intitule Le conte des trois cités. "Le premier attendait tout du théâtre, pour le second le théâtre n'était rien que le théâtre, le théâtre pour le troisième c'était le théâtre et aussi autre chose. " Le premier, Jacques Copeau, le second Louis Jouvet, ne forment sans doute pas avec Bertolt Brecht, le troisième, un trio, ni un groupe et nul ne les vit tous les trois ensemble. Le second fut l'élève du premier et le troisième, pour la France, venait d'ailleurs. Cependant, on feindra qu'ils incarnent […] trois pôles différents, opposés, d'une conception de la place du théâtre […] dans la cité, dans la société. » 1333 ’
Si ces pôles sont opposés, pourquoi vouloir les unifier ? Décrire cette lignée revient bel et bien à écrire le « conte » du théâtre d'art et non son histoire, et le titre de l'article de François Regnault dont s’inspire Strehler est d'ailleurs dépourvu d'ambiguïté. Strehler ne retient de Brecht qu'une vision partielle et partiale, construisant une figure de repenti potentiel de l'idéologie marxiste, éminemment conscientisé politiquement et conscient de l'impossibilité pour le théâtre de changer le monde et donc d'agir politiquement :
‘« Brecht m'a appris aussi qu'on peut comprendre les choses dans un certain sens, et ensuite on peut faire son autocritique, réaliser que l'on a fait une erreur. A ce moment là, j'ai découvert que je peux répéter avec l'acharnement de Jouvet et en même temps aller voter. Brecht m'a fait découvrir l'usage de la dialectique non seulement au théâtre mais dans la vie aussi. […] "Le théâtre peut-il changer le monde ? Chaque jour on me demande ça !" disait Brecht. Il peut changer, comme la musique ou les autres arts, d'un millimètre. Qui sait, peut-être qu'il ne change rien sauf lui-même. » 1334 ’
Sans doute Brecht était-il modeste quant à la réussite d’un théâtre conçu comme une entreprise politique destinée à changer le monde, particulièrement à la fin de sa vie et donc au moment de sa rencontre avec Strehler. Sa position ne saurait pour autant être réduite à l’aveu d’une impuissance politique sereinement assumée, essentiellement parce que la pensée de l’art de Brecht a profondément évolué à mesure des événements historiques, comme en témoignent entre mille exemples des pièces comme La Mère et plus encore le Lehrstück La Décision, ou encore des poèmes comme L’Eloge du Révolutionnaire 1335 , l’Eloge du Parti 1336 ou l’Eloge du travail clandestin 1337 , textes qui tous s’inscrivent explicitement dans le combat révolutionnaire, « la parole » 1338 étant prise pour « appeler les masses, d’une voix claire, à la lutte » 1339 contre « les oppresseurs » 1340 , les « capitalistes. » 1341 Certes cette prééminence du politique sur l’artistique n’est pas vécue par Brecht avec un enthousiasme unilatéral, mais elle n’en est pas moins posée comme une exigence absolue, comme l’indiquent explicitement ces vers destinés A ceux qui naîtront après nous :
‘« Vraiment je vis en des temps de ténèbres !
Un discours sans malice est folie. Un front lisse
Est signe d’insensibilité. Celui qui rit,
C’est simplement que l’horrible nouvelle
Ne lui est pas encore parvenue.
Quels temps, que ceux
Où parler des arbres est presque un crime,
Parce que c’est rester muet sur tant de forfaits ! » 1342 ’
Jean-Pierre Sarrazac voit dans la lecture dépolitisée de Brecht une tendance typique des metteurs en scène français depuis les années 1980 :
‘« Pour la plupart des collègues metteurs en scène de Vitez, de Vincent à Braunschweig et Schiaretti, en passant par Engel, le Brecht qui reste encore le plus proche, c’est celui qui est le plus éloigné dans le temps : l’auteur comique de La noce chez les petits-bourgeois et, surtout, presque jusqu’à saturation, l’écrivain anarchiste, crypto-expressionniste, rimbaldien – claudélien, même, par certains aspects – de Baal et de La jungle des villes. » 1343 ’
Le choix de sélectionner une partie de l’œuvre pour mieux passer l’autre sous silence se double du même mouvement de la réfutation implicite des lectures antérieures de Brecht et du découplage de la théorie à l’écriture :
‘« Encore une fois, à travers le choix d’un Brecht d’avant la dialectique marxiste, c’est la liaison de l’écriture à la théorie qui est récusée. Et singulièrement, cette mise en avant de la fable, du commentaire de gestus, du point de vue de classe et de la notion de théâtre critique. Notion sur laquelle avait focalisé le premier brechtisme français, illustré par Barthes, par Dort, par la revue Théâtre populaire. Et même le second, qui s’est signalé, avec Philippe Ivernel, par un retour sur les pièces didactiques ou bien, sin l’on pense à l’itinéraire de Jourdheuil, sur un autre « jeune Brecht » que l’«anarchiste », celui du fragment. » 1344 ’
Très attentif au théâtre politique de combat, Philippe Ivernel a d’ailleurs eu des propos ironiques sur cette récupération de Brecht visant à le dépolitiser, tentant au contraire dans son travail de critique d’articuler l’intention politique du militant à l’esthétique de l’homme de théâtre :
‘« D’aucuns ne manquent pas d’être tentés […] de sauver Brecht de l’obscur désastre contemporain – que signale l’effondrement de l’idée communiste – en coupant son théâtre de toute finalité pédagogique, pour mieux le préserver de toute fixation politique. La dissociation entre le poète d’une part, pris dans son épaisseur non transparente, et le théoricien, considéré simultanément avec terreur et pitié, ne date pas de maintenant : c’est même une constante avérée dans la réception de Brecht ou – justement – dans le refus de le recevoir. Le point de vue adopté ici sera inverse […] il consiste à retenir essentiellement de l’auteur sa force de questionnement, alimentée, en tout état de cause, par l’intention pédagogique, inséparable de l’intention politique. » 1345 ’
Sous couvert notamment d'inscrire Brecht et le brechtisme dans la prestigieuse lignée du théâtre d'art, Les Cités du Théâtre d'Art, retirant par là même au théâtre politique entendu comme théâtre de combat révolutionnaire l’un de ses plus géniaux et féconds artistes, nous paraissent participer de ce fait d'une dévalorisation de ce théâtre politique, relégué à l'autre extrême du théâtre de divertissement, le théâtre d'art constituant en quelque sorte la voie du milieu, choisie par les artistes « pris entre la pulsion destructrice et le consentement à l'état des choses » 1346 l’unique voie estimable et digne d'intérêt pour la critique artistique, la seule qui « veille à ce que l'art se sente bien au théâtre. » 1347 Et l’analyse des mises en scènes successives de La Vie de Galilée depuis 1989, comparée aux enjeux de l’œuvre de Brecht, vient pour partie accréditer cette impression.
Notes
1332.
On se souvient que G. Lukacs déjà, à l’enterrement même de Brecht, avait dans son discours établi une filiation entre son œuvre et celle d’Aristote et de Lessing. (Voir Nicolas Tertulian, op. cit., p. 70.)
1333.
« Les quatre cités du Théâtre d'Art », Giorgio Strehler, ibid, p. 10.
1334.
Giorgio Strehler, op.cit., p.14.
1335.
Bertolt Brecht, « Eloge du Révolutionnaire », traduction Maurice Regnaut, in Poèmes. 3. 1930-1933, Paris, L’Arche, 1966, p. 66.
1336.
« Eloge du parti », traduction Edouard Pfrimmer, ibid., p. 62.
1337.
« Eloge du travail clandestin », traduction Edouard Pfrimmer, ibid., p. 64.
1338.
Idem.
1339.
Idem.
1340.
Idem.
1341.
Idem.
1342.
Bertolt Brecht, « A ceux qui naîtront après nous », traductions nouvelles de Maurice Regnaut, Bertolt Brecht Europe n°856-857, août-sept 2000, p. 11.
1343.
Jean-Pierre Sarrazac, Critique du théâtre, op. cit., pp. 91-92.
1344.
Idem.
1345.
Philippe Ivernel, « Grande pédagogie : En relisant Brecht », in Les pouvoirs du théâtre, Essais pour Bernard Dort, op. cit., p. 216.
1346.
Georges Banu, op. cit., p. 18.
1347.
Ibid, quatrième de couverture.
3. Étude de cas.
La vie de Galilée de sa création à aujourd’hui
Écrite sur plus de vingt ans, La Vie de Galilée constitue en elle-même un palimpseste de la polysémie de l’œuvre brechtienne, du fait même de son étroite articulation à la situation politique et aux enjeux idéologiques qu’elle soulève.
a. La Vie de Galilée de B. Brecht :
Du théâtre épique comme palimpseste.
i. La Terre tourne et
l’interrogation sur le totalitarisme
La Vie de Galilée est « la pièce qui a le plus occupé Brecht » 1348 , estimait Bernard Dort, qui en a retracé la très longue genèse. On peut en effet en voir les prémisses dès Homme pour Homme (1924-1926). Galy Gay sonne comme la paronomase de Galilée, et la tirade du soldat Jesse renforce le parallèle poétique d’un lien sémantique fort :
‘« Et Copernic qu’est-ce qu’il dit ? Qu’est-ce qui tourne ? C’est la Terre qui tourne. La Terre, donc l’homme. D’après Copernic. Donc l’homme ne se trouve pas au centre. Maintenant, regardez-moi un peu ça. Vous voudriez que ça ne se trouve pas au centre, ça ? Historique, je vous dis. L’homme n’est rien du tout ! La science moderne a prouvé que tout est relatif. Qu’est-ce que ça veut dire ? La table, le banc, l’eau, le chausse-pied, tout, relatif. Vous, la veuve Begbick, moi… relatifs. Regardez-moi dans les yeux, veuve Begbick, l’instant est historique. L’homme se trouve au centre, mais relativement. » 1349 ’
De même, en 1932, quand Brecht a le projet de faire construire à Berlin un théâtre-panoptique où l’on mettrait en scène les procès les plus intéressants de l’histoire de l’humanité 1350 , il mentionne Galilée dans de nombreuses esquisses 1351 , et en 1937 il envisage d’en faire une pièce didactique destinée à la troupe prolétarienne danoise qui avait joué Les Fusils de la mère Carrar (1937.) 1352 Il est enfin possible que Brecht ait écrit une version préliminaire de Galilée avant La Terre tourne, en 1937, à Svedenborg, au Danemark, de fin 1933 à avril 1939, à l’intention du Théâtre Royal de Copenhague. Quant à la pièce proprement dite, il en existe trois versions, étalées sur vingt ans, et dont la première a été plus ou moins reniée par Brecht :
‘« La structure des épisodes et la liste des personnages n’y sont guère différentes. Brecht les a établies, pour l’essentiel, dès 1938. Et la fable de Galilée reste, en gros, immuable : elle s’articule autour de trois « décisions » du savant : son départ de Padoue pour Florence, la reprise des expériences sur les taches du soleil – malgré l’interdiction de l’Eglise – et sa rétractation finale. Mais ce qui change de l’un de ces Galilée à l’autre, ce sont les rapports internes entre les éléments de la fable et l’enjeu central de chacune de ces versions. » 1353 ’
La Terre tourne date de 1938, et correspond à la période de « l’exil européen » et de « l’imminence de la guerre. » 1354 Dans cette première version, le dramaturge allemand « décrit [essentiellement ] "le combat héroïque de Galilée pour la conviction scientifique moderne – à savoir que la terre tourne." 1355 » 1356 A la fin de la pièce, « Andrea fera franchir la frontière aux Discorsi, après avoir été dûment averti par Galilée – c’est le dernier mot de celui-ci : " Fais attention à toi quand tu traverseras l’Allemagne, avec la vérité dans ton vêtement. " […] Le Galilée de La Terre tourne […] ne dit oui que pour être en mesure de dire non. » 1357 Cette figure héroïque se teinte ainsi d’allusions aux savants résistant contre le nazisme :
‘« Galilée apparaissait sinon comme un héros, du moins comme le symbole d’une certaine résistance (passive) des intellectuels contre le pouvoir. En composant le personnage, Brecht avait sans doute pensé aux savants et aux écrivains restés en Allemagne nazie […], bien plus qu’à Niels Bohr et à ses assistants qui étudiaient alors la désintégration de l’atome. » 1358 ’
A cette époque, B. Brecht « s’inquiète aussi de ce qui se passe en Union Soviétique, aux procès staliniens. En août 1938, il confie à Walter Benjamin : "En Russie règne une dictature sur le prolétariat. " 1359 » 1360 Cette première version dresse donc le portrait du savant en héros clandestin contre les pouvoirs politiques totalitaires. Mais ce combat s’inscrit également dans la lutte des classes, comme le rappelle Bernard Dort :
‘« Cette première version avait été précédée de nombreuses esquisses où Brecht ne faisait de Galilée rien de moins qu’un savant s’appuyant sur le peuple pour lutter contre le pouvoir : la pièce aurait été dans ce cas un Lehrstück destiné aux travailleurs. » 1361 ’
Alors qu’il achève la pièce, parvient à Brecht « la nouvelle que des physiciens allemands avaient réalisé la fission de l’uranium. » 1362 Dès lors, la victoire de Galilée lui devient suspecte. Il est « d’avis qu’en abjurant en 1633 sa doctrine de la rotation de la terre, Galilée avait subi une défaite qui devait entraîner, dans les temps à venir, une rupture grave entre la science et la société. » 1363 Critiquant son sens, Brecht critique la construction dramaturgique de l’œuvre en 1939 :
‘« La Vie de Galilée est techniquement une grave régression […] Il faudrait réécrire entièrement la pièce, si l’on veut obtenir ce souffle du vent, qui vient des rives nouvelles, cette rose aurore de la science, le tout plus direct, sans les intérieurs ni l’atmosphère ni l’identification. » 1364 ’
Notes
1348.
Bernard Dort, « De La terre tourne à la Vie de Galilée : une longue histoire », in La vie de Galilée. Bertolt Brecht, Revue La Comédie Française, n°184, 1990, p. 14.
1349.
Bertolt Brecht, Homme pour Homme, cité par Bernard Dort, « De La terre tourne à la Vie de Galilée : une longue histoire », op. cit., p. 14.
1350.
Serge M. Tretiakov, « Bertolt Brecht », in Hurle, Chine ! et autres pièces, coll. « Théâtre années vingt », Lausanne, L’Age d’Homme, 1982, pp. 273-274.
1351.
Bertolt Brecht, Homme pour Homme, cité par Bernard Dort, « De La terre tourne à la Vie de Galilée : une longue histoire », op. cit., p. 14.
1352.
Idem.
1353.
Idem.
1354.
Bernard Dort, « De La terre tourne à la Vie de Galilée : une longue histoire », in La vie de Galilée. Bertolt Brecht, Revue La Comédie Française, n°184, p. 14.
1355.
Bertolt Brecht, interview dans un quotidien danois, citée par Bernard Dort in « Lecture de Galilée : étude comparée de trois états d’un texte dramatique de Bertolt Brecht », Les Voies de la création théâtrale, T. 3., Paris, CNRS, 1972.
1356.
Bernard Dort, « De La terre tourne à la Vie de Galilée : une longue histoire », op. cit., pp. 14-15.
1357.
Idem.
1358.
Bernard Dort, « Galilée et le cocher de fiacre », Théâtre public. Essais de critique, Paris, Seuil, 1967, p. 189.
1359.
Walter Benjamin, Essais sur Bertolt Brecht, traduction Paul Laveau, « petite collection Maspero », n° 39, Paris, François Maspero, 1969, p. 148.
1360.
Bernard Dort, « De La terre tourne à la Vie de Galilée : une longue histoire », op. cit., pp. 14-15.
1361.
Bernard Dort, « Galilée et le cocher de fiacre », op. cit., p. 189.
1362.
Cf. l’avertissement en tête de la 1ère édition de La Vie de Galilée (1955.)
1363.
Cf. l’entretien d’Ernst Schumacher avec le physicien danois C. Moller, cité par Bernard Dort, in « Lecture de Galilée. Etude comparée de trois états du texte dramatique de Bertolt Brecht », in Denis Bablet et Jean Jacquot, (études réunies et présentées par), Les Voies de la création théâtrales, 3, Paris, 1972, pp.121-122.
1364.
Bertolt Brecht, Journal de Travail, 1938-1955, texte français Philippe Ivernel, Paris, L’Arche, 1976, p. 32.
ii. Galileo Galilei : le savant et le politique
La deuxième version de la pièce, Galileo Galilei, rédigée en 1944, correspond à « l’exil américain et la fin de la guerre mais aussi à l’explosion des premières bombes atomiques ». 1365 Il s’agissait au départ de traduire La Terre tourne en anglais, mais rapidement l’enjeu devient tout autre. Ecrite à quatre mains avec l’acteur Charles Laughton qui interprétera Galilée lors de la création au Coret Theatre de Beverly Hills à partir de juillet 1947. Dans cette version le tableau du Carnaval gagne en importance et plus globalement, le peuple est davantage présent : « Ainsi, au nœud même de l’action, peuple et bourgeoisie accèdent à une existence dramaturgique : ils ont leur mot à dire. » 1366 Davantage que la structure d’ensemble, c’est le sens de la pièce qui est profondément modifié, au travers de la refonte de l’avant-dernier tableau et l’intégration des Discorsi. Déplacée après la remise de ces Discorsi à Andrea, l’auto-critique de Galilée est accentuée, « comme si ce don n’était plus qu’une ultime faiblesse de Galilée, non le produit de la ruse d’un combattant » 1367 :
‘« Le centre de gravité de l’œuvre s’en est trouvé déplacé ; ce qui compte, ce n’est plus le résultat que, bon gré mal gré, obtient Galilée, à savoir le fait d’écrire les Discorsi et de leur assurer une diffusion clandestine, mais les conséquences de l’attitude de Galilée, son acceptation du divorce entre la science et les hommes, et le « statut filial » qui en découlera pour la science. L’abjuration de Galilée n’est pas remise en cause en tant que telle, mais toute sa vie, son comportement de savant placé face au pouvoir, ou plus exactement entre le pouvoir et le peuple. Ce qui est critiqué, ce n’est pas la ruse de Galilée, c’est l’aveuglement historique et politique du savant qui déclare, dans son entretien avec le fondeur Vanni, avoir " écrit un livre sur la mécanique de l’univers, un point c’est tout. Le parti qu’on en tire ou qu’on n’en tire pas, cela n’est pas mon affaire." » 1368 ’
Cette version critique la lâche naïveté du savant face au pouvoir, au travers notamment de la radicalisation de la condamnation de Galilée par Andrea. 1369 En ce sens on mesure combien l’âge atomique constitue déjà pour Brecht une barrière, comme ultérieurement pour Bond et ceux qui s’inscrivent dans la cité du théâtre postpolitique :
‘« Du jour au lendemain la biographie du fondateur de la physique moderne prit un autre sens. L’effet infernal de la bombe fut tel que le conflit entre Galilée et les pouvoirs de son temps se trouva placé dans une lumière neuve et plus crue. » 1370 ’
La différence radicale entre les uns et les autres tient au fait que chez Brecht l’événement n’est pas pensé comme une rupture mais comme l’avènement d’un âge nouveau, interprété et historicisé. Il n’est nullement question d’un destin désormais inéluctable, et Brecht insiste d’ailleurs sur le fait que la pièce « n’est pas une tragédie. » 1371 La messe n’est pas dite, l’histoire n’est pas finie, au contraire, des temps nouveaux s’annoncent, l’homme porte toute la responsabilité de leur avènement possible. L’on ne peut que souscrire à l’interprétation de Dort, pour qui cette seconde version constitue aussi une « parabole sur la splendeur et les risques des temps nouveaux, sur les bouleversements radicaux qu’ils apportent et sur les déceptions qui résultent de ce que « les hommes reconnaissent ou croient reconnaître qu’ils ont été victimes d’une illusion […], que leurs temps, les temps nouveaux, ne sont pas encore venus. » 1372 C’est entre les mains du savant que gît l’avenir de l’humanité, car s’il n’est pas responsable du fait que « notre temps ressemble à une putain maculée de sang » 1373 , il l’est en revanche du fait qu’« il se peut que les temps nouveaux ressemblent à une putain maculée de sang. » 1374 C’est pour cette raison que la pièce critique désormais également le manque d’implication du savant dans la bataille aux côtés du peuple contre le pouvoir en place. Pour Brecht, la pièce n’est pas anti-cléricale parce qu’elle est politique et s’inscrit dans le cadre de la lutte révolutionnaire :
‘« Ici, même lorsqu’elle s’oppose à la libre recherche, l’Eglise ne fonctionne que comme un pouvoir. […] Considérer l’Eglise comme pouvoir, dans ce procès de la persécution de la libre recherche qu’est la pièce, n’est aucunement l’acquitter. Il serait simplement très dangereux de faire, aujourd’hui, du combat de Galilée pour la liberté de recherche une affaire religieuse. Belle occasion pour le pouvoir réactionnaire aujourd’hui d’opérer une malencontreuse diversion à des fins qui n’auraient absolument rien de catholique ! » 1375 ’
Maurice Regnault prolonge cette interprétation en termes de lutte des classes pour expliquer la mise à distance du personnage de Galilée proposée dans la mise en scène de Engel avec le Berliner Ensemble :
‘« Ce qui frappe […] d’irréalité et de réalité la double entreprise sur la science, c’est la structure de classe de la société italienne, c’est la détention du pouvoir. L’emprise des possédants est paradoxale : cette classe s’approprie la machine et rejette le fait scientifique ; elle commet un acte de positive infidélité à la science. Le degré d’infidélité, de tromperie, est proportionnel au pouvoir détenu. Les commerçants de Venise s’en tirent par le coup de chapeau cérémonial ; le Duc Côme de Médicis, dûment averti, ignore, l’Eglise condamne. […] La Vie de Galilée est une démystification de la morale. La « faute » morale est en réalité une erreur politique, voilà ce que nous enseigne Brecht. La structure sociale à ce moment, le statut filial de la science, les faiblesses de l’homme Galilée, rendirent cette erreur possible. Galilée la commit et la reconnut pour en tirer leçon. […] A nous de conclure : S’il veut rester fidèle à la science, le savant doit prendre une position résolument révolutionnaire. » 1376 ’
Galilée a commis l’erreur de préférer l’opportunisme individualiste à « la seule position réaliste, la position de classe » 1377 du fondeur Vanni, représentant de la « bourgeoisie manufacturière ascendante. » 1378
Notes
1365.
Bernard Dort, « De La terre tourne à la Vie de Galilée : une longue histoire », op. cit., p. 14.
1366.
Ibid., p. 15.
1367.
Idem.
1368.
Bernard Dort, « Galilée et le cocher de fiacre », Théâtre public. Essais de critique, op. cit., pp. 189-190.
1369.
Bernard Dort, « De La terre tourne à la Vie de Galilée : une longue histoire », in La vie de Galilée. Bertolt Brecht, Revue La Comédie Française, n°184, op. cit., p. 15.
1370.
Bertolt Brecht, « Remarques sur La Vie de Galilée », trad. Maurice Regnault, in Théâtre Populaire, n°24, mai 1957, p. 57.
1371.
Ibid., p. 60.
1372.
Bernard Dort, « Galilée et le cocher de fiacre », op. cit., p. 190.
1373.
Bertolt Brecht, Galileo Galilei, cité par Bernard Dort, in « De La terre tourne à la Vie de Galilée : une longue histoire », op. cit., p. 15.
1374.
Idem.
1375.
Bertolt Brecht, « Remarques sur La Vie de Galilée », op. cit., p. 60.
1376.
Maurice Regnault, « Chroniques. Les Spectacles. La Vie de Galilée de B. Brecht. », ibid., p. 63 et p. 70.
1377.
Ibid, p. 66.
1378.
Idem.
iii. La vie de Galilée,
métaphore de la trajectoire artistique et politique de Brecht
Ce n’est qu’en 1953, juste après l’explosion de la première bombe H américaine et juste avant celle de la bombe soviétique, juste avant la mort de Staline et le soulèvement ouvrier à Berlin-Est, réprimé par l’armée soviétique, que Brecht s’attelle de nouveau à Galilée. 1379 Achevée en 1955, cette troisième version correspond au « retour en Allemagne et [à] la vie en République Démocratique Allemande (ce qu’il nomme, après " les peines de la montagne, […] les peines de la plaine") » 1380 C’est cette version qui est traduite en français et qui va être jouée par E. Engel et le Berliner Ensemble au Théâtre des Nations en 1957, après la mort de Brecht – qui avait assisté au début des répétitions en 1955. Et c’est cet ultime travail de réécriture qui active tout le potentiel épique de la pièce :
‘« Cette troisième version de Galilée […] résulte d’un croisement entre La Terre tourne et Galileo Galilei. Elle en constitue la somme, mais cette somme est différente de l’addition de ses deux composantes. Unissant des éléments sinon contraires, du moins contradictoires (le Galilée « combattant » de l’une et le Galilée « criminel » de l’autre), elle relance l’œuvre et la détache des leçons trop contingentes que Brecht y avait inscrites. Peut-être même en fait-elle la pièce épique qu’il regrettait de ne pas avoir composée, avec La Terre tourne. » 1381 ’
Le sens de La Vie de Galilée n’est pas clos, et ce sont les strates d’écriture successives, mêlées dans la version définitive, qui constituent la dynamique dialectique de la pièce. L’auto-critique faite par Galilée à la fin de la fable est à lire également sur le plan méta-textuel au travers du montage de différents niveaux de sens depuis la première version. Si Brecht avait pour habitude de considérer ses textes non comme des pièces (Stücke) mais comme des essais (Versuche), des propositions pour la scène, La Vie de Galilée n’en constitue pas moins un cas unique dans l’ensemble de l’œuvre brechtienne, « par la durée et la continuité du travail de remaniement effectué mais aussi par la permanence de la structure de base. » 1382 Bernard Dort a bien insisté sur la nécessité de la dernière scène, dans laquelle Andrea, fidèle au dernier mot de Galilée, fait passer les Discorsi clandestinement à l’étranger. C’est par elle que La Vie de Galilée contient en germes La Vie d’Andrea Sarti, « et bien plus qu’elle encore : elle contient également en germe cette Vie d’Albert Einstein [ 1383 ] que Brecht avait pensé écrire. » 1384 C’est un palimpseste, aux sens multiples, une œuvre méta-textuelle et intertextuelle, inscrite dans l’histoire théâtrale (et précisément dans la génétique de l’œuvre brechtienne), mais également une œuvre inscrite dans l’Histoire et qui n’est « déchiffrable qu’en fonction d’une certaine situation politique. » 1385 Et, pour le dire avec Bernard Dort, « l’œuvre est […] le produit d’une sédimentation de la réflexion brechtienne autour d’un noyau central : la situation de l’intellectuel par rapport non seulement au pouvoir mais à l’ensemble de la société. Car Galilée n’est pas qu’un physicien, c’est aussi un artiste ». 1386 En ce sens, le « roman d’apprentissage » que constitue la pièce pour ce personnage décrit également le lent déniaisement de l’artiste face à sa responsabilité politique. La difficulté de cette pièce tient en définitive au fait qu’elle peut très aisément être montée à contre-sens, « comme une grande machine historique centrée sur un grand rôle » 1387 :
‘« En face de pièces comme celle-ci, la plupart des metteurs en scène se comportent comme un cocher de fiacre se serait comporté face à une automobile au temps où l’automobile fut inventée, si, prenant purement et simplement le véhicule mais négligeant les instructions pratiques, il avait attelé des chevaux à la nouvelle voiture, en plus grand nombre naturellement, la nouvelle voiture étant plus lourde. » 1388 ’
Palimpseste idéologique et esthétique, œuvre matricielle et testamentaire, La Vie de Galilée témoigne de l’évolution des préoccupations et des interrogations idéologiques de Brecht, étroitement corrélées à l’évolution du marxisme et du communisme. D’abord centrée sur la lutte des classes puis sur la lutte contre le totalitarisme, la pièce nourrit dans son ultime version la réflexion de Brecht sur la responsabilité du scientifique – et de l’artiste – à l’égard de son instrumentalisation par le pouvoir. Cette pluralité sémantique contenue dans l’œuvre va être considérablement resserrée dans les interprétations qu’en donnent les grandes mises en scène réalisées en France depuis 1989, de A. Vitez à J.-F. Sivadier.
Notes
1379.
Bernad Dort, « De La terre tourne à la Vie de Galilée : une longue histoire », op. cit., p. 15.
1380.
Ibid., p. 14.
1381.
Ibid., p. 15.
1382.
Ibid., p. 16.
1383.
Jan Kopf, « Brecht et Einstein », Alliage n°2, hiver 1989, cité in La vie de Galilée. Bertolt Brecht, Revue La Comédie Française, op. cit., p. 17.
1384.
Bernard Dort, « Galilée et le cocher de fiacre », op. cit., p. 191.
1385.
Ibid., p. 190.
1386.
Bernard Dort, « De La terre tourne à la Vie de Galilée : une longue histoire », op. cit. p. 16.
1387.
Bertolt Brecht, cité par Bernard Dort, in « La Vie de Galilée et le cocher de fiacre », op. cit., p. 196.
1388.
Idem.
b. La Vie de Galilée,
testament politique d’Antoine Vitez
L’orthodoxie brechtienne va se trouver fortement mise en question à la fin des années 1980, et Vitez s’inscrit dans cette « volonté iconoclaste à l’égard de Brecht, [dans ce] désir de polémique contre la scolastique pseudo-brechtienne. » 1389 Le théâtre français s’éloigne de Brecht, du fait du climat culturel national mais aussi du fait de Brecht lui-même, selon Vitez :
‘« Extrêmement préoccupé par le maintien rigoureux de l’esthétique attachée au Berliner Ensemble, il a écrit un livre-modèle auquel on doit se conformer, qui lui semblait exprimer exactement sa pensée. Il est responsable de ce qui est arrivé à sa mémoire, de la sclérose du Berliner Ensemble. Il a bloqué l’imagination. » 1390 ’
Contre ce qu’il considère être un dogmatisme de l’œuvre, Vitez prône une interprétation totalement décomplexée de tout souci de fidélité, voire une mise en scène qui ne recule pas devant l’interprétation psychanalytique, et entend faire jaillir l’inconscient idéologique de Brecht : « Brecht voulait qu’on ne puisse qu’exécuter son œuvre ; il pensait qu’elle était suffisamment explicite pour qu’on n’ait qu’à l’interpréter. Et pourtant, l’inconscient se glisse bien à quelques endroits, et Brecht dit bien d’autres choses que celles qu’il croyait dire. » 1391
Notes
1389.
Antoine Vitez, « L’Héritage brechtien », entretien, Théâtre / Public n°10, 1976, p. 19.
1390.
Antoine Vitez, in Colette Godard, « Ce communisme blessé. Entretien avec Antoine Vitez », Le Monde, 1er mars 1990.
1391.
Antoine Vitez, in Jacques Kraemer et A. Petitjean, « Lecture des classiques. Entretien avec Antoine Vitez », Pratiques, n°15/16, juillet 1977, p. 46.
i. Vitez, pour un théâtre national et populaire
La mise en scène de La Vie de Galilée est par ailleurs à resituer dans le parcours artistique et idéologique de Vitez lui-même, qui revendique pleinement à cette époque l’ancrage dans le théâtre populaire comme théâtre « national » :
‘« Je ne veux pas me poser la question de façon faussement responsable et faussement démocratique, en me demandant abstraitement ce qu’il faut faire pour diriger ce théâtre. Malgré cela, je suis un peu influencé par le mot national… et tant pis si je le suis. Je le confesse. Il me semble qu’il y a des valeurs philosophiques, morales, à faire apparaître à travers l’action théâtrale. […] C’est bien qu’un théâtre national témoigne de la honte nationale et non pas seulement des valeurs nationales. […] Les préoccupations d’ordre moral et politique reviennent au premier plan pour faire du théâtre aujourd’hui. Le théâtre permet au public d’établir une comparaison permanente avec la vie politique. Aujourd’hui, c’est la politique qui a toutes les caractéristiques du spectacle, c’est elle qui s’exprime, en tout cas, d’une manière insincère. La politique, celle-même que je soutiens comme citoyen, utilise des procédés publicitaires, une rhétorique ridicule. » 1392 ’
La revendication par Vitez de la formule « théâtre national » l’inscrit dans la tradition du théâtre politique œcuménique, qui s’inscrit dans le cadre de la Nation, en réaffirme les valeurs par le fait même qu’il la purge publiquement, se livrant à un travail du négatif pourrait-on dire. Pour Vitez, du fait de l’évolution de la vie politique démocratique, le théâtre se voit réactivé dans sa fonction de contre-modèle, plus philosophique et moral que politique, comme en témoigne sa définition du « théâtre des idées », dans lequel «chaque position bénéficie d’une égale légitimité. » 1393 Mise en scène testamentaire, la relecture de Brecht comme un classique se fait aussi le tombeau du communisme de Vitez.
Notes
1392.
Antoine Vitez, entretien avec Georges Banu, « Politique d’un théâtre, théâtre d’une politique », Art Press n° 53, novembre 1981.
1393.
G. Banu, in Le théatre des idées, op. cit., p. 102.
ii. La vie de Galilée,
testament artistique et politique de Vitez
Dans son spectacle La Vie de Galilée, monté en 1990 à la Comédie Française, Vitez met à distance Brecht, et entend le monter comme un classique :
‘« Les classiques ne deviennent pas forcément inoffensifs, mais relatifs, ils entrent dans l’histoire, on leur accorde les circonstances atténuantes du temps. Faust en a besoin aujourd’hui, car, après que trop de mains se sont mises dans les mains des bourreaux, en vain, sans qu’on puisse le cacher, ni le racheter d’aucun progrès qui eût tout sanctifié, nous nous sommes pris à douter que Méphistophélès ait vraiment perdu : il a gagné, c’est Goethe qui a perdu, ou tout au moins son hypothèse. Ils ont gagné, dit aussi Galilée, s’accusant d’une mauvaise ruse inutile. Mais Brecht, écrivant la contrition de Galilée, s’est-il sauvé lui-même ? » 1394 ’
Autrement dit, Vitez fait jouer le procédé brechtien de distanciation, d’ « étrangéification », pour – mais aussi, dans une large mesure, contre – l’œuvre de Brecht elle-même. Ainsi, il ne met pas en scène la pièce comme une fable épique, mais davantage comme un drame historique, supprimant les courtes épigrammes en tête de chaque scène (destinées à être lues, montrées ou chantées), et avec elles le principe d’une mise à distance dialectique de l’histoire de Galilée.L’éclairage épique, destiné à mettre en lumière tous les éléments pour que le spectateur puisse juger en toute connaissance de cause, cède la place ici à une lumière très contrastée, chaude au début du spectacle, mais de plus en plus teintée de clairs-obscurs tragiques. Pour suggérer la mise à distance de la pièce par la mise en scène, les costumes mêlent la munificence empesée de l’Eglise romaine et les vestes de cuir noir à ceinture qui évoquent à la fois les officiers de la Gestapo et ceux du GPU – mêlent autrement dit le temps de l’action aux différentes époques d’écriture de la pièce. Et les agents de l’Inquisition qui rôdent autour de Galilée aux scènes 11, 12 et 19, sont vêtus à la manière d’apparatchiks de l’Est. 1395 De même, le principe des coulisses à vue est utilisé à la fin de la scène 7 (entretien de Galilée avec les Cardinaux Bellarmin et Barberini 1396 ) pour rappeler les écoutes de la police de la RDA. Sur le même principe, la scénographie de Yannis Kokkos utilise la peinture pour donner à voir le palimpseste historique, avec les deux façades latérales en carton-pâte, dont l’une évoque l’architecture italienne du Quattrocento et l’autre des bâtiments administratifs des années 1950 qui n’auraient pas déparé Berlin-Est. Bernard Dort estimait que le décor du Berliner, aussi immuable qu’univoque, enfermait d’emblée Galilée dans une munificente cage dorée, ou plus exactement cuivrée :
‘« Avant même que la pièce ne soit jouée, Galilée est prisonnier – du décor. Impossible qu’il y échappe jamais. Avant d’agir, avant de choisir, il a perdu la partie. Nul autre recours ne s’offre à lui. […] Comment, dans un monde aussi fermé, aussi claquemuré, Galilée aurait[-t-il] pu ne pas trahir Vanni le fondeur et une position véritablement révolutionnaire de la science : Vanni n’a pour ainsi dire plus d’existence, et il n’y a pas de peuple. » 1397 ’
Dans la mise en scène de Vitez, le décor évolue, et la position des façades précédemment évoquées construit une fausse perspective, et rappelle l’ambition rationaliste et anthropocentrique de la Renaissance tout en mettant en relief ses limites voire son impasse, puisque l’horizon est le plus souvent bouché et la profondeur écrasée par un panneau en fond de scène. Et quand il s’ouvre, c’est pour évoquer un tableau de De Chirico, peintre de génie… et pourtant sensible au nazisme. En outre, ce procédé est utilisé lors de la scène dix, censée représenter comment « la théorie de Galilée se répand parmi le peuple » 1398 , et donc censée mettre en scène, « sur la place du marché » 1399 une « foule, en partie masquée, [qui ] attend le défilé de carnaval » 1400 et « un couple de forains, à moitié morts de faim, flanqués d’une fillette de cinq ans et d’un nourrisson. » 1401 Or, dans la mise en scène, il n’y a pas d’enfants, la femme du chanteur, interprétée par Claude Mathieu, est enceinte et rayonnante, et le couple n’évoque ni la misère ni la faim. Et par ailleurs, de peuple, il n’y a point, et cette absence concrète rejoint son absence symbolique. En effet, si dans la pièce, Vanni le fondeur incarne la « position de classe » 1402 , le personnage renvoie davantage pour Vitez « au fondeur de Peer Gynt d’Ibsen ; le fondeur qui, avec sa grande cuiller, attend Peer Gynt aux différentes étapes de son chemin. » 1403 Silhouette longiligne et statique, toute de noir vêtu et portant un haut de forme, entourée d’un halo de lumière blafarde, Vanni se donne à voir comme une figure allégorique qui pourrait incarner la mort, ou la justice, assez effrayante – Galilée ne se risque d’ailleurs pas à l’approcher. Sa voix aiguë est très vraisemblablement amplifiée par un micro, paraît de ce fait presque surnaturelle. Si elle « porte » 1404 , comme le lui dit Galilée, c’est donc de manière intransitive, et non comme celle d’un porte-parole de la bourgeoisie ascendante en demande de libéralisme politique face au pouvoir ecclésiastique, prêt à apporter son aide et l’aide des « villes de l’Italie du Nord » à Galilée dans « le combat. » 1405 Quand il met en garde Galilée (« Vous semblez ne pas distinguer vos ennemis de vos amis »), la phrase sonne comme une menace, et tend presque à suggérer que Vanni fait partie des ennemis. 1406 La traduction même du texte par Eloi Recoing est induite par les événements politiques et autorise la référence à la RDA, comme en témoignent certains changements de traduction. Ainsi, une comparaison de cette version de la scène entre le premier secrétaire, le second secrétaire et le Grand Inquisiteur, avec les deux précédentes – celle d’Armand Jacob et Edouard Pfrimmer (1959), et celle de Gilbert Badia (1975) – révèle que l’allusion aux écoutes y est davantage présente, à travers le terme de « transcription » :
‘« - Le Premier Secrétaire : As-tu pris la dernière phrase ?
- Le Second Secrétaire : J’y suis. » 1407
« - Le Premier Secrétaire : Tu as la dernière phrase ?
- Le Second Secrétaire : Je suis en train. » 1408
« - Le Premier Secrétaire : As-tu la dernière phrase ?
- Le Second Secrétaire : Je finis de la transcrire. » 1409 ’
Le traducteur estime d’ailleurs explicitement que les choix ont été induits par le contexte idéologique de la fin des années 1980 :
‘« La précédente [traduction] date des années 50. Je n’étais pas encore né. C’était l’époque en France où l’on découvrait les magnifiques mises en scène du Berliner Ensemble. La DDR avait encore un avenir. […] Ma traduction, elle, est contemporaine de la chute du mur de Berlin. Notre rapport à Brecht ne peut plus être le même. La Vie de Galilée est à mes yeux un édifice de mémoire, une pièce à conviction qui nous permet de comprendre cette fin de siècle où nous vivons en direct l’agonie d’une d’utopie.[…] Le temps est un grand distanciateur. La traduction de Brecht n’a plus à se faire militante d’une cause autre que celle du théâtre lui-même. » 1410 ’
Pourtant, s’il s’agit de militer pour la cause du théâtre, c’est pour celle d’un théâtre désépicisé et les choix esthétiques semblent s’expliquer en dernier ressort par la rupture idéologique. La mise à distance de Brecht et de son théâtre épique s’explique en effet par le fait que c’est avant tout la chute du Mur de Berlin qui rend Brecht inactuel aux yeux de Vitez et de son équipe. Le metteur en scène est d’accord avec Dort sur l’importance du contexte politique pour déterminer le sens de l’œuvre de Brecht, et singulièrement celui de La Vie de Galilée, cette pièce qui offre entre toutes « le moyen de penser et de représenter le lien qui unit histoire et utopie. » 1411 Dans la lecture que donne Vitez, la « science » dont la responsabilité est débattue dans la pièce devient avant tout la science marxiste mise au regard de son interprétation par le pouvoir communiste. Brecht est Galilée, victime et coupable de l’utilisation que les Etats communistes ont pu faire de l’idée communiste, blessée à jamais par ses incarnations :
‘« Avec ce travail, j'ai l'impression de revenir à la maison. […] Il s'agirait en somme d'une maison commune, la maison communiste. La pièce, Galilée, évoque les problèmes que pose la science dans son ensemble – la science sociale – y compris dans ce qu'on appelait, puisqu'il faut bien parler au passé, l'idée du communisme. " L'effondrement de cette idée n'est pas, comme certains voudraient le croire, un cliché. Les Etats qui se réclamaient d'elle s'effondrent. On ne peut pas dire alors qu'elle soit étrangère à cet effondrement, qu'elle puisse flotter, intacte, au-dessus du désastre. Les idées n'existent que par leur incarnation. Si l'incarnation disparaît, l'idée est blessée à mort. Brecht alors perd son actualité, il entre dans le passé, c'est émouvant. Il devient possible de prendre la distance nécessaire pour " traiter " son oeuvre. » 1412 ’
Vitez renvoie Brecht à son orientation politique, contre une lecture dépolitisée de son œuvre que certains metteurs en scène entreprenaient dans les années 1980. 1413 Vitez a quant à lui toujours tenu Brecht à distance, pour des raisons davantage idéologiques qu’esthétiques, parce qu’il juge son silence sur les crimes du stalinisme :
‘« Je sais très bien que Brecht, en République Démocratique Allemande, ne pouvait plus parler de Meyerhold et qu’avant, au Danemark ou en Amérique, il était un émigré anti-nazi et qu’il lui était extrêmement difficile de lutter contre le stalinisme dans la situation où il se trouvait ; mais enfin, quand même, je trouve qu’on donne bien facilement des raisons à Brecht de s’être tu, obstinément tu, ou de n’avoir réagi que par ruse aux crimes staliniens. » 1414 ’
C’est pour cette raison que l’on trouve au contraire chez Vitez la valorisation de la référence à Meyerhold. Ce fils d’anarchiste, et qui a adhéré au Parti Communiste en 1957, après le Rapport Khrouchtchev, à la manière d’« un homme qui se serait converti au christianisme après avoir soigneusement étudié tous les dossiers de l’Inquisition », 1415 estimait ainsi, par son choix esthétique faire œuvre politique d’anti-stalinisme, « en contrebande » 1416 , héritier en cela d’ailleurs du principe brechtien et galiléen de la ruse :
‘« J’étais communiste. Et je ne pouvais ignorer les crimes de Staline, même si je n’avais pas encore conscience de leur immensité. […] Alors, faire référence, dans l’ordre du simulacre (qui est le théâtre), à une forme d’art qui avait été persécutée par Staline était une façon de faire œuvre d’anti-stalinisme. […] Je suis allé vers elle [ l’œuvre de Meyerhold] pour des raisons impures. Des raisons qui ne sont pas de l’ordre du Désir mais de la Mauvaise conscience. Pour me laver de ma mauvaise conscience politique, je me suis fait une bonne conscience théâtrale. » 1417 ’
Mais dans La Vie de Galilée, spectacle qui sera de fait testamentaire puisque le metteur en scène meurt la même année, l’on peut entendre en écho de l’auto-critique de Galilée non seulement celle de Brecht, mais aussi celle de Vitez lui-même, qui a appartenu au parti communiste jusqu’en 1980. Il évoque d’ailleurs l’idée d’un « travail de deuil » à propos de ce spectacle, même s’il répugne à renoncer à tout l’espoir qu’a porté l’idée communiste :
‘« Je ne peux pas dire qu'elle me réjouisse totalement. Je me souviens de sa naissance en 1949. Je l'ai connue à son origine et ce n'était pas gai puisqu'on était en plein stalinisme. Mais je suis de ceux qui n'oublient pas ce qu'elle signifiait : une autre Allemagne, utopique, porteuse d'espoir, même si sans doute elle était condamnée d'emblée. » 1418 ’
Et c’est sans doute pour cette raison qu’il en vient à faire ce qu’il reproche à d’autres, à distinguer deux hommes en Brecht, le militant et le poète. Si le premier doit être jugé avec la même sévérité que l’ont été ses camarades – et Vitez pense bien sûr à Aragon 1419 – le second en revanche existe à part entière, et il est porteur d’espoir. Ce qui sauve Brecht, comme Galilée, c’est l’apologie du doute contre le dogme. Vitez refuse de réduire Brecht à son obédience marxiste et estime en lui le poète, car c’est en tant que tel qu’il se sauve, en ce qu’il est également témoin voire prophète, et Vitez renoue ici avec la figure hugolienne du poète, en même temps qu’il ancre Brecht dans le patrimoine national allemand et fait de Brecht-Galilée un descendant de Faust :
‘« A présent s'ajoute la nécessité de traiter la défaite [de l’idée communiste]. Certaines répliques [de La Vie de Galilée ] pourraient faire penser que Brecht l'a prévue. Je ne dis pas qu'il l'a vraiment pressentie, mais la vraie poésie porte toujours une prémonition. Brecht était très attentif à ce que penseraient de lui " ceux qui naîtront après nous " – c'est le titre d'un poème. Il implore leur pardon, il explique […] " Crier contre l'injustice rend la voix rauque. " Il veut dire que la lutte par elle-même durcit le militant. " […]" Son oeuvre n'est pas uniquement nourrie de Marx et de Lénine, elle l'est beaucoup de Luther, de la langue de Luther, de sa traduction de la Bible. Elle l'est aussi de Goethe, incontournable pour les Allemands. Dans Galilée, je trouve des scènes qui paraphrasent Faust. Dans Faust, Goethe pose la question : peut-on, selon l'expression de Brecht d'ailleurs, " mettre sa main dans celle du bourreau " ? Doit-on pactiser avec le diable pour arriver à le vaincre ? " La question posée par Goethe vient de trouver une réponse après une période qui n'est pas seulement celle du communisme léniniste ou stalinien, qui est notre histoire depuis deux cents ans […] Si nous avons eu tort, peut- être reste-t-il malgré tout l'espoir d'un peut-être. Voilà ce que je crois, ce que je vois en Brecht. " 1420 ’
La mise en scène de Vitez est truffée de références littéraires, à Goethe, mais également à Claudel, car le metteur en scène voit une forte parenté entre La Vie de Galilée et Le Soulier de Satin, deux pièces qui se donnent à lire comme « une tentative d’auto-justification des auteurs, mais aussi de justification aux yeux de la postérité. » 1421 C’est dans cette mesure que l’intertexte littéraire inclut Le texte par excellence, et que Vitez entend mettre en scène La Vie de Galilée « comme la vie d’un saint, ou plutôt d’un anti-saint » 1422 . L’on peut lire la scène entre Galilée et le petit moine comme une confession inversée mais aussi comme une référence à la tentation, à l’affrontement entre Faust et Méphistophélès 1423 . De même, la scène 9 multiplie les allusions à la Cène avec Galilée, debout derrière la table, qui distribue le vin à ses disciples assis autour de lui tandis que les femmes saintes, Virginie et Mme Sarti, sont agenouillées pour laver le plancher, juste avant que n’arrive Mucius, le disciple infidèle qui, tel un Judas, a décidé de se ranger au Décret de 1616 de la Sainte Congrégation et de renier Copernic… et Galilée. 1424 Le spectacle de Antoine Vitez oscille donc entre inscription dans l’histoire et dé-contextualisation, tout comme il oscille entre le procès du militant et la glorification du poète-prophète, et entre histoire théâtrale et histoire politique. Presque quinze ans plus tard, qu’en est-il de la réception de Brecht ? En 2002, la mise en scène de Jean-François Sivadier va rencontrer un grand succès et le spectacle, repris au festival d’Avignon en 2005, va s’inscrire alors dans la fameuse polémique précédemment évoquée, étant alors catalogué « théâtre populaire », la même expression valant louange pour les uns, et injure pour les autres. Plus tard, le spectacle Les Barbares de Eric Lacascade connaîtra peu ou prou le même sort, et les deux metteurs en scène ont l’un comme l’autre revendiqué leur appartenance à cette lignée, par leur participation aux débats récents questionnant le « théâtre populaire. » Mais dans quelle mesure ces spectacles s’inscrivent-il exactement dans la lignée incarnée par cette formule ?
Notes
1394.
Antoine Vitez, « Faust, Brecht, Goethe, Galilée », in La vie de Galilée. Bertolt Brecht, Revue La Comédie Française, op. cit., p. 33.
1395.
Effi Theodorou, La Vie de Galilée à la Comédie Française : Brecht revisité par Vitez, Mémoire de DEA, sous la direction de Michel Corvin, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, 1990, p. 52.
1396.
Bertolt Brecht, La Vie de Galilée, trad. Eloi Recoing, Paris, L’Arche, 1990, pp. 74-75.
1397.
Bernard Dort, « Chroniques. Les Spectacles. La Vie de Galilée de B. Brecht », op. cit., p. 73.
1398.
Ibid, p. 99.
1399.
Idem.
1400.
Idem.
1401.
Idem.
1402.
Ibid, p. 66.
1403.
Antoine Vitez, notes de répétitions, citées in Effi Theodorou, La Vie de Galilée à la Comédie Française : Brecht revisité par Vitez, op. cit., p. 64.
1404.
Bertolt Brecht, La Vie de Galilée, trad. Eloi Recoing, p. 105.
1405.
Ibid, p. 106.
1406.
Idem.
1407.
Bertolt Brecht, La Vie de Galilée, trad. Armand Jacob et Edouard Pfrimmer, in Théâtre Complet, Tome III, Paris, L’Arche, 1959, p. 65.
1408.
Bertolt Brecht, La Vie de Galilée, trad. Gilbert Badia, in Théâtre Complet, Tome IV, Paris, L’Arche, 1975, p. 94.
1409.
Bertolt Brecht, La Vie de Galilée, trad. Eloi Recoing, Paris, L’Arche, 1990, p. 74.
1410.
Eloi Recoing, « A propos de la traduction de La Vie de Galilée », entretien avec Terje Sinding, in Les Cahiers de la Comédie Française, op. cit., p. 35.
1411.
Bernard Dort, « Une traversée du désert », op. cit., p. 11.
1412.
Antoine Vitez, in Colette Godard, « Et, à Paris, Brecht revient… " Ce communisme blessé ", dit Vitez. » Le Monde, 01.03.1990.
1413.
« Il y a en lui […] un véritable militant du mouvement communiste issu de la IIIe Internationale, avec tout ce que cela pèse de morale bolchevique. Alors on l’admire ou on le condamne pour cela, mais il ne peut pas nous faire croire qu’en même temps il a une autre morale. » Antoine Vitez, « Je n’ai besoin ni de le sauver, ni de ne pas le sauver, je n’ai besoin, moi, que de le traiter », entretien avec Georges Banu, in Bernard Dort et Jean-François Peyret, (cahier dirigé par), Bertolt Brecht, tome 1, Cahiers de l’Herne, Paris, 2ème trimestre 1979, pp. 47-48.
1414.
Idem.
1415.
Formule de Claude Roy citée par Antoine Vitez, in Emile Copfermann, Conversations avec Antoine Vitez. De Chaillot à Chaillot, Paris, POL, réédition 1998, p. 73.
1416.
Benoît Lambert et Frédérique Matonti, « Un théâtre de contrebande, quelques notes sur Antoine Vitez et le communisme », in Sociétés et représentations n° 11, février 2001, p. 397.
1417.
Antoine Vitez, in Emile Copfermann, op. cit., pp. 67-68.
1418.
Idem.
1419.
« Les excuses qu’on donne à Brecht, on pourrait aussi les donner à d’autres. [Vitez évoque ici Aragon] Ou bien il ne faut rien oublier, et alors il faut dire que Brecht a participé vraiment, consciemment, de la mystification stalinienne et qu’il porte une partie de la responsabilité. » Antoine Vitez, « Je n’ai besoin ni de le sauver, ni de ne pas le sauver, je n’ai besoin, moi, que de le traiter », entretien avec Georges Banu, op. cit., pp. 47-48.
1420.
Idem.
1421.
Antoine Viter, notes des répétitions, cité in Effi Theodorou, op. cit., p. 67.
1422.
Idem.
1423.
Effi Theodorou, ibid, p. 69.
1424.
Idem.
c. La Vie de Galilée de J.-F Sivadier et Les Barbares d’E. Lacascade :
du « théâtre populaire » comme folklore esthétique
N’étaient ses connotations péjoratives, l’adjectif « folkorique » conviendrait parfaitement pour qualifier l’utilisation de la formule « théâtre populaire » faite par des hommes de théâtre contemporains comme Jean-François Sivadier et Eric Lacascade, qui y puisent comme dans une boîte à outils esthétiques et rhétoriques que l’on pourrait qualifier de pittoresque 1425 et peut-être, aussi, d’un peu superficielle 1426 au regard des enjeux historiquement associés à la formule.
Notes
1425.
Le Petit Larousse, adjectif « folklorique », p. 440.
1426.
Idem.
i. Le renversement galiléen de J.F. Sivadier, du monde au théâtre
Le spectacle de J.-F. Sivadier, créé en 2002 et joué jusqu’en 2005 radicalise le décrochage opéré par Vitez sur les enjeux idéologiques de la pièce. Dans la version de J.-F. Sivadier, l’engagement politique n’est même plus questionné, il est tout simplement évacué, au profit de l’inscription dans un théâtre populaire dont ne sont conservés que des codes esthétiques et une attention extrême au jeu de l’acteur. La mise en scène de J. F. Sivadier 1427 s’inscrit dans le prolongement de la lecture de la pièce faite par Théâtre Populaire et par Vitez en ce qui concerne le traitement du personnage de Galilée. Maurice Regnault avait en effet regretté que, dans la mise en scène de Engel avec le Berliner Ensemble, l’acteur n’incarne pas suffisamment l’« homme de chair » décrit par Brecht. Et Dort avait même été plus loin, estimant que l’interprétation du comédien Bush ne montrait pas suffisamment combien Galilée se fait « l’artisan de son propre malheur » et se trouve en définitive « à la fois perdu et sauvé » 1428 . Dort préférait de ce fait l’interprétation de Charles Laughton dans la seconde version de la pièce :
‘« [Il compose un personnage ] peut-être plus artificiel, sinon plus cabotin, à la fois bougon et roublard, puéril et vaniteux, à l’œil aigu et à la bouche gourmande ; d’abord « homme de chair », flatté de traiter d’égal à égal avec les puissants, fier d’avoir su les rouler, confiant en soi, et amoureux de la bonne chère et des riches étoffes. Pas un héros, pas même ce héros malheureux et défait que campe Bush, mais un homme qui ne parvient pas à se dépêtrer de lui-même, de ses vertus comme de ses vices. » 1429 ’
Vitez avait tenu compte de la remarque, qui donnait à voir le personnage de Galilée comme un être de chair dès la première scène, où le rubicond et terrien Roland Bertin faisait sa toilette, torse nu, sa corpulence disant d’emblée la gourmandise du personnage. Le choix de Nicolas Bouchaud permet dans la mise en scène de J.-F. Sivadier de suggérer, outre cette gourmandise, une sensualité tournée non seulement vers les plaisirs de la bonne chère, mais aussi ceux de la chair, et ceux d’un ludisme enfantin – celui du comédien rejoignant celui du metteur en scène. En effet, à la différence du spectacle de Vitez, et poussant encore le procédé d’éloignement de la pièce, le spectacle s’émancipe d’emblée du texte de Brecht, par une séquence augurale d’improvisation qui fonctionne à la fois comme une captatio benevolentiae du spectateur aussi surprenante qu’efficace, et comme entrée dans le texte de Brecht. L’exercice des Ambassadeurs, souvent utilisé dans les cours de théâtre, dans lequel un comédien tente de faire deviner un mot à son partenaire par le mime corporel, est transposé ici en jeu de devinette qui met le spectateur dans la position d’Andrea face à Galilée et permet une séquence très drôle. Le procédé est fidèle au souhait général de Brecht que son théâtre soit divertissant, et plus spécifiquement au sens de la pièce où le rire revêt en effet une importance et une fonction toute particulières, puisque c’est lui qui fait de l’exercice de la raison non pas une ascèse mais une jubilation, et qui fait de « l’art du doute » qu’est la science, une fête, comme le rappelait Maurice Regnault :
‘« Mme Sarti : Chaque fois qu’ils rient, ça me fait un peu peur. Je me demande de quoi ils rient.
Virginia : Papa dit : les théologiens ont leurs sonneries, les physiciens ont leur rire.
Le rire est la fête du doute. C’est le pavoisement après l’effritement du dogme, quand la foi est devenue dérision. Ce rire, répercuté, démultiplié, devient le rire énorme du Carnaval. Le béquillard se met à danser. L’Ordre est aboli, magiquement mais effectivement, le géant Galilée, " plus grand que nature ", triomphe. Moment unique où […]" l’astronomie atteignait la place du marché. " Alors le pouvoir frappa. L’Eglise absolument régnante rétablit l’Ordre. A la scène populaire et négative du carnaval en bas répond en haut la scène aristocratique et positive de la décision papale. » 1430 ’
Brecht critiquait d’ailleurs précisément sa pièce et voulait la réécrire parce qu’il estimait que « le travail, le travail joyeux, devrait être concrétisé par de véritables séances de travaux pratiques, sur la scène même. » 1431 En ce sens, la mise en scène de J.-F. Sivadier paraît dans la parfaite ligne de l’ambition de Brecht. De plus, à l’inverse du choix de Vitez qui avait pris un enfant pour incarner Andrea jeune, un même comédien, joue ici le personnage durant toute la pièce, ce qui tend à renforcer d’emblée son individualité face à celle de Galilée mais aussi à augmenter la complicité entre eux, le plaisir de la recherche… et du jeu. Et c’est précisément dans cette mesure que le spectacle se démarque radicalement de la lecture propre aux années 1960 et radicalise encore la mise à distance de Brecht. Le spectacle, très agréable en soi, est aux dires mêmes du metteur en scène une « farce sur le jeu de la raison et de l’imagination. » 1432 Le décor, composé de tréteaux, les coulisses à vue qui permettent à la troupe d’être toujours réunie, les séquences d’improvisation, le ludisme du jeu et de la relation directe au public, tout concourt à ancrer le spectacle dans tradition esthétique du théâtre populaire « à la Vilar », et à faire de la pièce le portrait de Brecht en artiste et non en militant. Sivadier voit dans la pièce un « autoportrait de l’auteur, se taillant dans Galilée un costume sur mesure, pour dire "sa vie dans l’art" et l’ambiguïté de son propre rapport avec l’autorité » l’enjeu de la mise en scène devient dès lors de « lire dans le regard obstiné de Galilée vers le ciel celui de Brecht scrutant les régions inexplorées du théâtre qu’il lui reste à inventer » 1433 :
‘« La Vie de Galilée raconte la destruction d’un certain ordre du monde et l’édification d’un autre. En Italie, au début du XVIIesiècle, Galilée braque un télescope vers les astres, déplace la terre, abolit le ciel, cherche et trouve des preuves, fait voler en éclats les sphères de cristal où Ptolémée a enfermé le monde et éteint la raison et l’imagination des hommes. Il fait vaciller le théâtre de l’Église et donne le vertige à ses acteurs. L’Inquisition lui fera baisser les bras, abjurer ses théories sans pouvoir l’empêcher de travailler secrètement à la “signature” de son oeuvre, ses Discorsi.
Brecht, dans une langue limpide, un immense poème construit comme une suite de variations, met en scène un choeur de femmes et d’hommes séduits et terrifiés par l’irrésistible visage de la raison qui les appelle à abandonner leurs repères: la Terre n’est pas le centre de l’univers, il n’y a pas de centre, il n’y a pas de sens. Et Galilée est un “jouisseur de la pensée”, à la fois Faust et Falstaff, “penseur par tous les sens”, résolument tourné vers le peuple pour lui offrir, avec l’art du doute, la liberté de regarder autrement la puissance de l’Eglise et les mouvements de l’univers. » 1434 ’
Cette note de mise en scène témoigne bien de la réduction des enjeux idéologiques de la pièce, au profit d’une inscription dans l’histoire du théâtre. Le contexte même dans lequel le spectacle est représenté induit d’ailleurs d’emblée cette interprétation, puisqu’il est joué en diptyque avec La Mort de Danton de Büchner :
‘« La Mort de Dantonressemble un peu au dernier acte d’une pièce de Shakespeare. Un acte qui s’appellerait quelque chose comme “après la bataille”. En travaillant sur la pièce, Véronique Timsit, Nicolas Bouchaud et moi, on s’est d’abord dit que ce serait beau de montrer cette bataille : un temps qui serait comme la construction d’une mémoire commune entre les acteurs et les spectateurs. Il fallait donc jouer autre chose avant. D’autre part, nous nous disions toujours : ça pourrait ressembler à Brecht mais c’est le contraire de Brecht. Et puis la figure de Galilée est revenue. Celui qui se bat pour donner la science, la liberté au peuple, et qui se rétracte parce qu’il a peur de la torture. En opposition à Danton qui lui ne veut plus se battre, qui lâche le peuple et qui n’a pas peur de la mort. Brecht le dramaturge accompli et Büchner le jeune homme de vingt-deux ans qui apprend à écrire du théâtre. L’omniprésence de Dieu dans Galilée et l’absence de toute transcendance dans Danton. Tous ces contraires réunissent magnifiquement les deux textes. Et puis ils sont tous les deux autobiographiques. Mis en scène avec presque la même distribution et dans le même espace, il me semble que chacun va éclairer très fortement l’autre. » 1435 ’
L’idée selon laquelle Galilée « se bat pour donner la science, la liberté au peuple », apparaît simpliste au regard de toutes les interprétations précédentes du texte, de Dort à Vitez. Signe des temps, la mise en scène de J.-F. Sivadier plaît précisément du fait de cette réduction sémantique. De la même façon, ce que la critique retiendra de La Mort de Danton, c’est avant tout « l’énergie directe, contagieuse, […] [d’un spectacle ] qui met en scène les pouvoirs déflagrateurs de la jeunesse. » 1436 Ce qui prime, pour J.-F. Sivadier, c’est à la fois la relation entre le public et la troupe, et l’éclairage réciproque de deux grands textes du patrimoine théâtral européen, et les textes l’intéressent en eux-mêmes pour la réflexion existentielle sur la condition humaine et plus spécifiquement sur l’individu, bien davantage que l’interrogation de la possibilité, des enjeux et des « dommages collatéraux » que comporte toute révolution. En ce sens, il nous paraît intéressant d’analyser la réception de ce spectacle. Nous l’avons dit, pris dans la tourmente de l’édition 2005 du festival, les spectacles de J. F. Sivadier sont devenus le paradigme du théâtre populaire contre le théâtre d’avant-garde aux yeux des partisans de la programmation, Jean Tolochard opposant ainsi « Sivadier et Lauwers, Ostermeier et Garcia » 1437 avant de mettre en garde contre « le ver inextirpable du populisme » 1438 qui infecte les « philistins de droite et de gauche » qui prétendent savoir « ce dont le peuple a besoin. » 1439 De même, Jean-Marc Adolphe stigmatise le caractère « people » de ce théâtre populaire qui fait la part belle aux acteurs, et semble critiquer de ce fait la figure historique de Gérard Philippe :
‘« Que dire de la starisation générale de Nicolas Bouchaud – un excellent acteur, assurément – interprète de La Mort de Danton et de La Vie de Galilée, mis en scène par Jean-François Sivadier, que la critique semble avoir rêvé en nouveau Gérard Philippe. Le sujet people a désormais plus d’attrait, dans la presse, que l’analyse des œuvres ! Là aussi, la critique théâtrale semble avoir démissionné – par paresse ou par résignation – et personne n’aura imaginé mettre en regard le jeu de Nicolas Bouchaud (au sein d’une troupe) ou d’autres interprètes du festival, avec les caractéristiques de jeu que pointe Odete Aslan dans le volumineux et conséquent essai qu’elle a consacré à L’Acteur au XXe siècle. » 1440 ’
A l’inverse, les partisans du théâtre populaire regrettent que ce qui aurait dû être au cœur du Festival se soit trouvé dans cette édition renvoyé dans les marges. Fort de sa longue expérience, R. Abirached regrette ainsi que le festival rompe avec sa vocation à être le lieu d’un théâtre populaire, tout en reconnaissant pleinement la nécessité d’inventer une nouvelle formule pour répondre à la crise de la mission civique du théâtre :
‘« L'histoire du Festival d'Avignon, qu'on le veuille ou non, à la fois dans la configuration des lieux, dans le style d'accueil du public, dans la demande de ce public, demeure marquée par cette idée d'un rendez-vous avec le théâtre français et avec le théâtre populaire. Théâtre populaire au sens d'un théâtre d'art ouvert à tous, défini par Vilar - tout en étant ouvert à la modernité. Or, depuis six ans, les objectifs d'origine se sont inversés : le Festival est devenu un grand événement international. Avignon a connu une transformation totale de l'esprit du lieu. On l'a bien vu cette année. Le théâtre populaire était à la marge du Festival. Je pense au travail de Jean-François Sivadier, à Olivier Py, à l'absence de Philippe Caubère dans le « in »... […] Les conditions du théâtre aujourd'hui ne sont plus celles des années 1950, où se créait le théâtre public : il faut en prendre acte. Et en faire son deuil : il ne sert à rien d'être passéiste. Mais de deux choses l'une : si on laisse tomber le rôle civique du théâtre, le théâtre public n'a plus de vraie justification ; ou alors, si on veut garder un lien avec la cité, avec l'Etat, avec la notion de service public, il est indispensable d'inventer des formules nouvelles. Il faut, dans ce cas, trouver ce qui, aujourd'hui, peut prendre le relais du rôle civique que le théâtre public a joué en France pendant quarante ans. » 1441 ’
Il est vrai que, de 1995 à 2005, le festival d’Avignon est emblématique de l’évolution du « théâtre populaire » et des conséquences de l’abandon de la notion de « service public » et du découplage des formules « théâtre citoyen » et « théâtre d’art ». Cette notion de « théâtre d’art » peut désormais signifier deux choses totalement contradictoires, d’un côté le théâtre d’avant-garde le plus radical et qui récuse toute vocation populaire ou civique, rangées au rang des antiquités populistes, et de l’autre le théâtre d’art populaire inscrit dans la tradition, mais désormais centré sur l’héritage esthétique plus que civique. Le théâtre populaire nouvelle formule, toiletté de manière à le brosser de toute poussière idéologique, et rebaptisé pour ce faire « théâtre d’art », désigne en définitive un théâtre divertissant au sens noble pourrait-on dire, à la fois de bonne qualité et grand public, mais cependant éloigné de toute préoccupation concrète de démocratisation du public qui passerait par d’autres moyens que les codes dramaturgiques et scéniques. De fait, chez Sivadier, le mythe du théâtre populaire s’incarne dans une scénographie de tréteaux, passe par le clin d’œil à la Commedia dell’Arte avec les séquences d’improvisation, la reconstitution du principe de troupe, et la volonté de faire rire le public. Sivadier n’est d’ailleurs pas le seul à user du « théâtre populaire » comme d’un répertoire esthétique codifié, et Les Barbares de Eric Lacascade 1442 nous paraissent présenter sur ce point de nombreuses similarités avec cette approche que l’on pourrait dire folklorique, si le terme n’était si péjoratif, de la tradition du théâtre populaire.
Notes
1427.
La Vie de Galilée, mise en scène de Jean-François Sivadier, avec la collaboration artistique de Nicolas Bouchaud, Véronique Timsit et Nadja Vonderheyden. Le spectacle a été créé en 2002 au Théâtre National de Bretagne et joué au Festival d’Avignon la même année, puis repris en 2005 dans le même cadre, puis au Théâtre des Amandiers à Nanterre.
1428.
Bernard Dort, ibid, p. 73.
1429.
Idem.
1430.
Maurice Regnault, « Chroniques. Les Spectacles. La Vie de Galilée de B. Brecht », op. cit., pp. 64-65.
1431.
Bertolt Brecht, Journal de Travail, 1938-1955, texte français Philippe Ivernel, Paris, L’Arche, 1976, p. 32
1432.
Jean-François Sivadier. Jean-François Perrier, « Entretien de Jean-François Sivadier », in Dossier de presse de La Vie de Galilée et La Mort de Danton, Festival d’Avignon, 2005.
1433.
Idem.
1434.
Idem.
1435.
Jean-François Sivadier. Jean-François Perrier, « Entretien de Jean-François Sivadier », in Dossier de presse de La Vie de Galilée, Festival d’Avignon, 2005.
1436.
Georges Banu, « La révolte d’Avignon », in Georges Banu et Bruno Tackels (sous la direction de), Le cas Avignon, Vic La Gardiole, L’Entretemps, 2005, p. 231.
1437.
Jean-Pierre Tolochard, « Le ver du populisme », in Le cas Avignon 2005, op. cit., p. 98.
1438.
Ibid., p. 101.
1439.
Idem.
1440.
Jean-Marc Adolphe, « Sur le fond d’Avignon », ibid., p. 126.
1441.
Robert Abirached, in « Le théâtre de texte confronté à celui des images », Le Monde, 06.09.2005.
1442.
Les Barbares, Maxime Gorki, adaptation de Eric Lacascade, mise en scène de Eric Lacascade, spectacle créé dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes pour le festival d’Avignon 2006. Spectacle vu lors de sa tournée au Théâtre de la Colline en février 2007.
ii. Les Barbares :
Théâtre populaire et culture populaire
‘« Lorsque Gorki commence à écrire Les Barbares, il est âgé d’une trentaine d’années, il sort de prison, il est contraint à l’exil. Il ne cherche pas pour autant à faire des Barbares une pièce politique. Il écrit sur la vie, la souffrance, les difficultés de l’existence, les aspirations, les notions de résistance et de groupes. Cette pièce dépasse le message politique. Les problématiques politiques de la Russie de cette époque : collectivisation, acquisition de la connaissance par les masses populaires, paysannerie, goulags, prolétarisation, sont présentes, mais n’en font pas l’action principale. L’action principale tient dans les échanges amoureux qui circulent. C’est autour de cette action principale que se perçoivent les échos de l’histoire de la Russie révolutionnaire, et c’est ce qui rend la pièce représentable, cent ans après son écriture. Il n’y a pas de lendemain chez Gorki, pas de nostalgie de l’avant. Tout se joue dans le présent, dans l’instant. La pièce a souvent été lue dans un sens unilatéral : Gorki, l’écrivain honoré malgré lui à son retour d’exil dans une Russie stalinienne, n’oublie pas qu’il crut au socialisme révolutionnaire même si, très tôt, il s’est défié du bolchevisme. Les ingénieurs des Barbares peuvent être interprétés comme les porteurs du socialisme. C’est dans ce sens que la pièce fut montée en URSS jusque dans les années 70. À Saint-Petersbourg, montée par Tostagonoff, le message en fut bouleversé : apparut alors la confrontation violente entre les porteurs du savoir, de la culture, du progrès, et une population coupée de tout, privée de culture, réduite à la misère sociale, intellectuelle et affective. » 1443 ’
Le choix de la pièce au sein de l’œuvre de Gorki est en soi significatif de l’ambivalence du propos d’Eric Lacascade. Dans ce texte pessimiste, qui confronte une élite sociale et politique à une population ignare, sans que l’on sache qui sont en définitive les vrais – ou plutôt les plus – barbares, l’auteur des Bas-fonds réduit souvent les classes laborieuses à des classes dangereuses et surtout immorales, représentées par le personnage du « mari de Dounka » - devenu chez E. Lacascade le « mendiant » – alcoolique, qui battait sa femme et terrorise sa fille, qu’il est d’ailleurs prêt à vendre pour quelques kopecks. Mais la mise en scène renforce cette mise à distance de l’espoir révolutionnaire. Certes, presque tous les personnages dénoncent la misère d’ « une partie de la population qui vit pire des animaux » 1444 , mais c’est pour mieux dénoncer ensuite la sauvagerie de ces « criminels en puissance ». 1445 Le seul personnage à porter un discours révolutionnaire qui articule la dénonciation d’une « vie pleine de crimes innommables » 1446 à l’accusation d’une société dans laquelle non seulement « les criminels ne sont pas punis » 1447 , mais où « ce sont même eux qui font les lois » 1448 , est celui de l’étudiant. Or, la première fois qu’il prend publiquement la parole pour exprimer avec force – et crédibilité – ses convictions, sa voix se trouve couverte par l’ivresse bruyante du personnage de Grisha, sur qui l’attention du spectateur est attirée. De même, lorsqu’il chante « Rien n’a changé mais tout commence, où finira cette violence ? Rien n’a changé mais tout commence, tout va finir dans la violence », sa ferveur est mise à distance par les rires moqueurs des autres personnages. Ce qui domine en définitive en termes de propos politique, c’est la mise en question de la condition féminine – en cela la pièce est assez proche de celles d’Ibsen – et cette question est de plus abordée de manière plus existentielle et plus littéraire, que politique. E. Lacascade ancre la pièce de Gorki, écrite en 1905 juste après l’échec de la première tentative révolutionnaire en Russie, non dans ce contexte historique immédiat, mais dans l’histoire théâtrale. L’interrogation sur le couple et les personnages féminins font songer à Tchékhov, référence déjà contenue dans le texte de Gorki, mais contribue également à inscrire ce spectacle dans l’œuvre de E. Lacascade lui-même, et notamment dans ses mises en scène précédentes, auxquelles avaient d’ailleurs collaboré certains des interprètes des Barbares, Lacascade renouant avec l’esprit de troupe. Enfin, dans une traduction qui tient davantage de la réécriture, le texte convoque également Shakespeare, quand Tsyganov déclame avec force lyrisme qu’« il y a quelque chose de pourri dans l’harmonie de la création. » 1449
Outre ces références au patrimoine littéraire universel, le spectacle entend s’inscrire plus précisément dans la tradition du théâtre populaire, par le recours aux mêmes codes esthétiques utilisés par J.-F. Sivadier. L’on retrouve ainsi le plancher en bois, l’utilisation de tréteaux qui portent ici des éclairages caractérisés par leurs couleurs chaudes qui contribuent à créer une ambiance festive, à laquelle contribue également la présence de guirlandes lumineuses multicolores. Les changements de décor sont à plusieurs reprises effectués à vue par les comédiens. Le choix des comédiens et des codes de jeu renvoie également aux codes du théâtre populaire, de même que les emprunts au cirque, forme populaire par excellence dans l’imaginaire collectif. Le caractère « sauvage » 1450 de la fille du maire, Katia, est exprimé par le fait que son interprète Millaray Lobos, tantôt roulée en boule sous une table, tantôt juchée sur un lampadaire qu’elle escalade comme un mât chinois, défie les lois de la pesanteur comme l’ordre établi. De même, c’est Gilles Defacque, clown de son état et illustre fondateur du Théâtre International de Quartier du Prato, qui interprète le personnage du maire et de même, le travail chorégraphique, marque de fabrique d’E. Lacascade, est dans ce spectacle encore très présent. Le recours à ces formes non verbales est destiné à revivifier « la tradition théâtrale française enkystée dans le texte [et qui] souffre d’inhiber la langue du corps au profit du seul texte. » 1451 L’utilisation de formes non verbales et festives va de pair avec la volonté d’une proximité avec le public. A défaut des spectateurs, les comédiens circulent entre la scène et la salle, et un certain humour est cultivé, le public étant gentiment bousculé, les petites provocations étant destinées à créer une complicité qui n’a rien de commun avec la provocation brutale revendiquée par certains artistes de la cité du théâtre postpolitique. A Stépane qui s’étonne d’entendre Tcherkoun parler seul, ce dernier répond qu’il discute avec une femme – Katia – qui se trouve « par là-bas », désignant d’un geste vague la salle, donc le public. De même, quand la femme de l’ingénieur Tcherkoun, Anna arrive avec sa bonne, Stiopa, elles font une première halte et posent leurs valises dans la salle, l’incluant géographiquement dans la fable. Outre ces différents éléments qui fonctionnent à la manière de marqueurs du théâtre populaire, le spectacle revendique plus largement des références à la culture populaire.
Le spectacle s’ouvre sur le « tube » du groupe de rock REM, intitulé « Losing my religion », interprété par un comédien qui s’accompagne à la guitare. Avant même l’entrée dans la pièce, la captatio benevolentiae du spectateur se fait ainsi par la référence à la culture populaire comme code partagé par le public et la salle. Le spectacle prend acte en quelque sorte à la fois du fait que le public de théâtre, public cultivé par définition, est aussi désormais un public qui assume ses goûts pour la culture populaire, comme l’ont démontré les récents travaux de Bernard Lahire sur la « dissonance » des pratiques culturelles des élites. 1452 Le sociologue qui se situe comme toujours entre dette et critique 1453 à l’égard de son ancien maître Pierre Bourdieu, ne conteste pas les travaux antérieurs sur la cohérence culturelle, mais incite à nuancer fortement le constat bourdieusien qui voulait que « le goût classe, et classe celui qui classe » 1454 , notamment du fait d’une évolution de la société. L’analyse des résultats de l’enquête de 1997 sur les Pratiques culturelles des Français 1455 , complétée par une centaine d’entretiens centrés sur les pratiques culturelles réalisés auprès de jeunes gens et d’adultes 1456 , incite B. Lahire à considérer que l’ancien schématisme ne vaut plus, qui faisait correspondre strictement comportements culturels et appartenance socio-professionnelle. S’il demeure encore largement vrai que les catégories populaires reconnaissent essentiellement des pratiques jugées « peu légitimes », « basses » ou « indignes » pour reprendre le vocabulaire consacré, à l’inverse les catégories sociales dominantes ne reconnaissent plus uniquement des pratiques culturelles légitimes, hautes et dignes, voire, « avouent » majoritairement des pratiques non légitimes. Et le constat est particulièrement valable pour la musique rock, pratique « peu légitime » et pourtant pratiquée par des individus dotés d’un fort capital culturel, appartenant aux catégories socialement dominantes. Toujours associée à une culture festive et populaire, de la fanfare de cuivre au bal musette en passant par le chant en canon, la musique demeure présente tout au long d’un spectacle qui entend faire coïncider la tradition du théâtre populaire avec la prise en compte des goûts du public réel des salles de spectacle en ce début de XXIe siècle.
Cette inscription dans la lignée du théâtre populaire, présente chez E. Lacascade en termes d’esthétique du spectacle, l’est également dans le discours, mais avec une évolution de taille. Le débat sur la mission de service public se focalise désormais non plus sur la démocratisation et le public, nous l’avons vu, mais sur les enjeux liés au financement public. Eric Lacascade va se trouver en 2007 au centre d’une polémique qu’il nous paraît à ce titre important de comparer à « l’affaire » Nordey au TGP en 1999. Dans les deux cas, l’idéal de théâtre public invoqué entre en contradiction violente avec la réalité de la gestion économique du théâtre, mais il ne s’agit pas du même idéal. L’assimilation du « théâtre populaire » au « théâtre d’art » contre le « théâtre citoyen » témoigne bien du déplacement des enjeux que suggère l’évolution déjà mentionnée de Olivier Py.
Notes
1443.
Entretien avec Eric Lacascade, propos recueillis par Angelina Berforini. Texte de présentation du spectacle sur le site du Théâtre de la Colline, consultable en ligne à l’adresse http://www.colline.fr/spectacle/index/id/125/rubrique/presentation
1444.
Les Barbares, op. cit., p. 110.
1445.
Idem.
1446.
Ibid., p. 111.
1447.
Idem.
1448.
Idem.
1449.
Ibid., p. 119.
1450.
Eric Lacascade, adaptation d’après Maxime Gorki, Les Barbares, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2006, p. 67.
1451.
Angelina Berforini, « De la littérature comme travail », p. 15.
1452.
Bernard Lahire, La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La Découverte, 2004.
1453.
Nous reprenons ici le titre de l’ouvrage dirigé par Bernard Lahire, Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, Dettes et critiques, Paris, La Découverte, 1999.
1454.
Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, 1979, p. 6.
1455.
Cette enquête a déjà donné lieu à une série de publications, voir notamment Olivier Donnat, Les pratiques culturelles des Français : enquête 1997, Paris, La Documentation Française, 1998.
1456.
L’enquête « Pratiques culturelles des Français 1997 » a été conduite auprès d’un échantillon de 3000 personnes représentatif de la population française de 15 ans et plus. En outre, 1350 personnes représentatives de la population ayant assisté au cours des 12 derniers mois à un spectacle vivant ont été interrogées grâce au même questionnaire. Parallèlement, pour cet ouvrage, une centaine d’entretiens a été réalisée (81 auprès d’adultes entre 23 et 85 ans, et 30 auprès d’adolescents de 16-17 ans), et quelques études de cas ont été menées (observation de soirées karaoké, étude du « cas André Rieu », analyse des invités de deux émissions télévisées, notamment.)
4. Les tensions du théâtre d’art,
entre idéal du service public et principe de réalité financier
(É. Lacascade et S. Nordey)
Objet d’une polémique enragée sur fond de déficit et d’accusation d’immoralisme, Eric Lacascade, directeur du CDN de Caen, entend, dans sa lettre ouverte datée du 21 mars 2007, informer chacun des « cher[s] ami[s] » 1457 que sont selon lui les autres directeurs d’institutions d’une « problématique d’intérêt général. » 1458 A la différence de celui des scènes nationales, le statut des CDN est souvent source de tensions entre l’« être directeur » et l’« être metteur en scène » du directeur de la structure, d’une part du fait d’une incompétence d’artistes parfois peu doués pour la gestion comptable, d’autre part du fait parfois de conflit d’intérêt entre ces deux identités. En l’occurrence, il est reproché à E. Lacascade d’avoir laissé le CDN dans une situation comptable pire qu’à son arrivée – alors qu’il avait été nommé sur la promesse d’un assainissement de la situation préalable et surtout, d’avoir vendu à perte son spectacle Les Barbares après avoir appris qu’il ne serait pas prolongé dans ses fonctions, endettant durablement le CDN et compromettant la programmation de la saison 2007-2008. Dans sa lettre, E. Lacascade plaide sa cause non plus au nom de la mission de service public, mais du statut de service public du théâtre :
‘« Permettez-moi de me souvenir de quelques principes basiques du bon fonctionnement de tout service public; l’un s’appelle péréquation. Celle-ci consiste à ne pas avoir comme but desdits services la rentabilité et le profit. Ne pas avoir le nez rivé sur le profit donne une certaine flexibilité dans le rééquilibrage des comptes d’une année sur l’autre, et permet par exemple de faire plus de recherche intensive une année, et l’année suivante équilibrera les comptes. Un autre de ces principes s’appelle la continuité du service public : à sa tête, les hommes changent, mais le fonctionnement de l’institution perdure. Cela n’a rien d’exceptionnel, et ce n’est pas non plus un privilège des artistes. A la poste, par exemple, le déficit occasionné par l’acheminement des lettres normales était équilibré par les bénéfices engendrés par le transport des colis. Et c’est bien sûr la même chose dans les hôpitaux, les universités, les écoles etc… » 1459 ’
Sans nous prononcer en l’espèce sur l’authenticité de l’argumentation développée par Eric Lacascade, il est intéressant de noter qu’il invoque le service public contre la logique de rentabilité typique de l’ « idéologie » libérale et de la « loi du marché. » Et de fait, le principe même du théâtre comme bien public, fondé sur une idéologie républicaine qui valorise la notion d’espace public et de bien commun, est mis en question sous couvert de « pragmatisme économique », et E. Lacascade cite l’exemple du nouveau protocole pour les intermittents, censé réduire le déficit, et qui a échoué sur ce point, mais a efficacement œuvré à ce qui était peut-être son objectif secret : que « le réel soubassement du théâtre public se [fasse] la malle. » 1460 Retournant comme un gant le reproche de mauvaise gestion, E. Lacascade argue du fait qu’« attaquer à cet endroit-là l’un des fondements de notre lien social et du bien public, c’est obéir au nouveau sacré, qui organise et structure nos sociétés : argent, profit, marchandisation. » 1461 Refusant que son travail au CDN soit évalué « par le prisme d’un item économique », E. Lacascade « revendique haut et fort » le fait que « [sa] priorité en tant que directeur a toujours été artistique. Et celle de [son] équipe de servir le public et les artistes. » 1462 Pour lui, la polémique participe d’une attaque « contre un positionnement de gauche, contre un partage de l’outil, contre une notion de collectif, […] contre cette façon de faire du théâtre sans stars, [...]. Aujourd’hui, la normativité fait la loi » 1463 et le « bilan artistique » « disparaît derrière la gestion économique. » 1464 Il est à ce titre intéressant de comparer cette polémique avec « l’affaire » du TGP qui, dix ans plus tôt, avait également soulevé la question du décalage entre l’idéal du théâtre public et la réalité de projets toujours jugés trop coûteux.
Nommé en mai 1997 à la tête du CDN Gérard Philippe à Saint-Denis, Stanislas Nordey accuse en octobre 1999 un déficit de dix millions de francs environ. L’Etat refuse l’étalement de la dette et exige dès la première année le remboursement de six millions, soit le montant de la part artistique pour l’année à venir. Face à la catastrophe que représenterait l’annulation de la saison, un Collectif des Compagnies programmées au TGP en 2000-2001 se constitue, réunissant près de cinq cents artistes. Avec la direction du TGP, mais aussi l’action des tutelles et des partenaires (Ministère, DMDTS, ONDA, DRAC Ile de France, Conseil Général de Seine Saint-Denis) et grâce également à la solidarité financière de nombreuses structures théâtrales, la barre est péniblement redressée. Pour S. Nordey, cette « affaire » est le fruit de « dérapages de gestion » 1465 qu’il ne conteste pas, mais également, et plus profondément, d’un « vrai désaccord de fond » entre les services du Ministère et la direction du théâtre, et de la volonté de « faire un exemple ». Pour Yan Ciret, après avoir été érigé en « porte-parole du théâtre qui s’occupe du social », au moment où le Ministère Trautmann réaffirmait précisément la responsabilité sociale des artistes, S. Nordey a dans un deuxième temps été transformé en « bouc émissaire » et « lynché » 1466 du fait de l’impossibilité de faire coïncider une haute ambition artistique et sociale avec une viabilité économique durable. Car le projet de S. Nordey et de V. Lang, l’un comme l’autre « exaspérés que tant de moyens ne soient attribués finalement qu’à quelques uns, et que ces lieux ne soient fréquentés que par une caste » 1467 , marquait la volonté de se démarquer d’ « une génération qui a en main tous les pouvoirs » 1468 , politiques et artistiques, et qui peine à céder la place, et de renouer avec l’idéal de décentralisation et de démocratisation, encore conçues comme vocation du « théâtre public », comme en témoigne la présentation des trois piliers du projet :
‘« 1. Dans quelle mesure avez-vous choisi Saint-Denis ?
Saint-Denis est une vraie ville, à la différence de Paris. Le théâtre y est physiquement inscrit au centre. Je n'aurais jamais pris la direction d'un autre théâtre. […] Il m'était impensable de ne pas travailler en banlieue, parce qu'il y a une mixité de population qui me passionne. Saint-Denis a une véritable histoire dans laquelle le théâtre a lui-même une histoire où je pouvais m'inscrire. L'idée était de rentrer dans une peau déjà existante et de la faire revivre.
2. Comment l'idée de théâtre public peut-elle être encore considérée comme « révolutionnaire » ?
L'idée de théâtre public est toute neuve. Elle n'a jamais été gagnée. Elle est née il y a une cinquantaine d'années, donc elle est en enfance, et dans une enfance, on a des accidents de croissance. Est-ce que le théâtre public n'a pas grandi trop vite par moments, est-ce qu'il n'a pas besoin de retrouver une cohérence et un passage ? On est au passage du deuxième témoin. Il y a eu les fondateurs : les Gignoux, Dasté, Garran ; puis les Lavaudant, les Vincent, et c'est le moment maintenant où ceux-ci vont avoir à faire le passage. Quand je parlais de « révolution » dans le Manifeste, je parlais de tour sur soi-même, avec un regard qui change constamment. Révolutionner les choses, c'est ne jamais les considérer comme acquises : le théâtre doit être dans un état de révolution permanente.
3. Vous faites appel aux poètes. Comment les rassembler ?
En réaffirmant que cette maison n'a de sens que si elle est traversée par leur parole. Déjà, le dire est important. Pour faire du théâtre, on n'a pas forcément besoin de metteur en scène, ni de décorateur ni de costumier, on a besoin de poètes et d'acteurs. Je voudrais donc que ce soit la maison des poètes et des acteurs. L'idée était d'en convoquer vingt-quatre différents dans l'année. On va passer des commandes à de jeunes auteurs, trois par an, et autour de la Coupe du monde de football, on fait traduire trente-deux étrangers. » 1469 ’
A la fin des années 1990, S. Nordey revendique un « théâtre citoyen » et non seulement un théâtre d’art, parce qu’il n’est pas seulement metteur en scène mais aussi directeur de lieu. Directeur pédagogique de l’Ecole du TNB depuis 2001, il maintient aujourd’hui la filiation avec l’idéal de transmission cher aux pionniers du théâtre populaire, mais radicalise la portée civique de l’éducation des jeunes générations d’artistes. Il entend former non seulement des acteurs mais des citoyens, et entend plus précisément encore leur forger une conscience politique aiguë, propédeutique à l’action politique, comme en témoigne son travail avec la promotion 2001-2006 sur Gênes 01 et Peanuts de Fausto Paravidino, qui s’intègre selon nous à la cité du théâtre de lutte politique. S. Nordey a accompli ainsi une trajectoire inverse de celle d’Olivier Py, dont nous avons vu qu’il renie aujourd’hui l’appellation « théâtre citoyen », alors que les deux « petits-fils de Jean Vilar» partageaient encore les mêmes vues en 1997 :
‘« Jean Vilar disait que le théâtre doit être un service public, comme le gaz et l'électricité. C'est une bonne formule, parce qu'elle est très efficace. Mais, en même temps, il faut faire très attention : le théâtre n'est quand même pas comme le gaz et l'électricité. Il est un peu plus raffiné, parfois. Ceci dit, nous tenons à la formule, qui renvoie à une idée fondatrice du théâtre public : un moyen d'instituer un dialogue avec la démocratie. Aujourd'hui, on entend souvent dire que le théâtre est l'endroit le plus inefficace, le plus inapte à représenter les hommes en général et la société telle qu'elle est. Il flotte sur la génération qui a quarante, cinquante ans, un désarroi lié à l'idée que l'aire techno-médiatique aurait écrasé les planches, que le public se désintéresse absolument des poètes contemporains, qu'il n'est pas possible d'inventer quelque chose. C'est dangereux. Quand on raisonne ainsi, on abandonne tout regard actif sur la société. » Si les budgets de la culture ont été augmentés en 1981, ce n'était pas seulement pour permettre aux décorateurs et aux metteurs en scène de développer leur imaginaire ce qui s'est trop souvent passé. L'apport d'argent aurait dû aussi servir à subventionner le public. Le ministère n'a pas suffisamment assumé ses responsabilités. Il aurait dû faire le gendarme pour empêcher les dérives, contraindre les théâtres à respecter leur cahier des charges. » Ainsi, aujourd'hui, le prix des places de théâtre est trop élevé. On peut trouver des places pas chères avec les réductions, mais ce système n'est pas satisfaisant parce qu'il désigne les publics. […] Le prix des places pourrait être moins élevé. Quand on dit qu'il devrait être de 50 francs, on s'entend répondre que cela déprécierait les spectacles, en termes de marketing. Cela prouve bien que c'est un choix politique, et pas économique. » 1470 ’
En dix ans, on mesure l’évolution du discours de O. Py, qui fait désormais passer à l’arrière plan les questions de politique tarifaire et de démocratisation, tout en continuant de rejeter l’immoralisme qui a accompagné l’ère Lang, et en maintenant la référence à la fonction politique du théâtre comme « dialogue avec la démocratie. » C’est désormais essentiellement la fonction civilisatrice du théâtre qui rend légitime son financement public, par le rappel de cette vérité que le libéralisme pourrait faire oublier, voire disparaître : l’homme ne se réduit pas à un producteur-consommateur :
‘« Ce théâtre communautaire […], ce théâtre non pas à tout prix révolutionnaire ou révolté, mais naviguant du moins à contre-courant des habitudes, des traditions confortables, des politiques installées, des droits acquis, ce théâtre pour le populaire en un mot, n'était-il qu'une utopie nécessaire ? Existait-il vraiment ? N'était-ce pas seulement un paysage imaginaire ? », se demande Vilar. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette soirée donne à penser. Sur la notion de « théâtre populaire » et son sens possible aujourd'hui, sur la « politique culturelle », sur la notion d'intérêt public et général. Sur l'exigence, enfin, ou l'ambition, que se donne ou non une société pour les hommes qui y vivent. Et sur la manière dont le théâtre agit. Mais elle le fait avec tous les moyens du théâtre […] » 1471 ’
Chez O. Py comme chez E. Lacascade, le « théâtre public », autrement dit le financement public du théâtre, demeure nécessaire et légitime, même s’il est découplé de toute démocratisation réelle du public, parce que le théâtre constitue par ce fait même un contre-modèle à la société marchande, et qu’il s’inscrit de plus, d’un point de vue esthétique, dans la filiation avec le « théâtre populaire ». Comme E. Lacascade ou J.-F. Sivadier, O. Py réactive ainsi le mythe du « théâtre de tréteaux » 1472 dans sa soirée d’hommage à Vilar. Au terme de notre analyse, nous pouvons porter un regard nouveau sur la polémique d’Avignon évoquée dans notre introduction concernant la définition des enjeux contemporains du théâtre populaire. Certains des tenants contemporains de la formule « théâtre populaire », de A. Mnouchkine à O. Py en passant par J.-F. Sivadier et E. Lacascade, maintiennent le rejet du théâtre politique présentant une vision clivée du monde, et oeuvrent ainsi à présenter une lecture œcuménique de l’histoire théâtrale, quitte à la fausser quelque peu, comme le manifeste le « cas » Brecht . Autre point d’accord entre les nouveaux artisans du théâtre populaire et les artistes de la cité du théâtre postpolitique, la reconnaissance de l’impossibilité de démocratisation. Mais ils ne s’accordent pas cependant sur les conséquences à tirer de ce constat. Alors que le théâtre d’avant-garde revendique la cohérence entre un élitisme dans la composition du public réel et une esthétique élitiste, c’est-à-dire notamment une esthétique non consensuelle, polémique, le théâtre populaire assume sa mission de service public en se focalisant sur une spécificité esthétique, celle de poursuivre la vocation des pères d’un théâtre comme divertissement noble et civilisateur, qui réunisse l’assemblée et ne vise pas à choquer. Mais deux options se dégagent au sein de cette cité du théâtre politique œcuménique, incarnées par les positions récentes d’A. Mnouchkine et de O. Py. Les deux grands noms du théâtre public français sont d’accord sur la spécificité de la conscience citoyenne de l’artiste comme sur la vocation et le pouvoir civilisateurs de la culture et de l’art, ce qu’ont montré leurs prises de position depuis les années 1990, de la lutte contre la barbarie en ex-Yougoslavie à la dénonciation du soutien de P. Handke à S. Milosevic en 2006, en passant par la défense des Droits de l’Homme et des sans papiers en 1996. Mais ils diffèrent sur la détermination de ce « théâtre populaire » et par là même sur ses enjeux. La première prône un « théâtre citoyen » qui, s’il se définit contre le théâtre politique asservissant l’art, n’en demeure pas moins fidèle à une volonté pédagogique d’ordre quasi moral, tandis que le second récuse même ce modèle pour prôner un « théâtre d’art » dépourvu de toute ambiguïté quant à son inutilité sociale. Il ne s’agit pas de « résoudre la fracture sociale » 1473 mais de s’adresser au public non en citoyen mais en mortel qui parle à des mortels de l’humaine condition.
Notes
1457.
Eric Lacascade, Lettre ouverte, Lille, 21 mars 2007.
1458.
Idem.
1459.
Idem. Cet argument appelle un commentaire, puisque les établissements scolaires ne fournissent pas un bon exemple, puisqu’ils ont l’obligation d’équilibrer leurs recettes chaque année.
1460.
Idem.
1461.
Idem.
1462.
Idem.
1463.
Voir La Lettre du spectacle n° 184, du 11 mai 2007, pp. 2-3.
1464.
Idem.
1465.
Stanislas Nordey, in Yan Ciret, Franck Laroze, entretiens avec Stanislas Nordey et Valérie Lang, Passions Civiles, La Passe du Vent, 2000, p. 11.
1466.
Yan Ciret, ibid., p. 12.
1467.
Valérie Lang, ibid., p17.
1468.
Stanislas Nordey, ibid., p. 15.
1469.
Jean-Louis Perrier, « Stanislas Nordey réactive le Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis », Le Monde, 11 mai 1998.
1470.
Stanislas Nordey et Olivier Py, « Stanislas Nordey et Olivier Py secouent le cocotier du théâtre public. Les engagements fermes des " petits-fils" de Vilar », Le Monde, 07 mars 1997.
1471.
Olivier Py, soirée d’hommage à Jean Vilar, Festival d’Avignon, 27 juillet 2006. Cité par Fabienne Darge, « Olivier Py rend hommage à l’utopie nécessaire de Jean Vilar » Le Monde, 29 juillet 2006.
1472.
Ibid.
1473.
Olivier Py, propos recueillis par Fabienne Darge et Nathaniel Herzberg, « On ne peut pas demander au théâtre de réduire la fracture sociale », Le Monde, 04 mai 2007.
Conclusion.
La cité du théâtre politique œcuménique
à l’heure de la crise du modèle républicain.
Entre repli
de la mission de service public
sur une ambition de « théâtre d’art »
et maintien
de la vocation de « théâtre citoyen »
La vocation politique ontologique et paradoxale du théâtre et des artistes de la cité du théâtre politique œcuménique.
Fondée sur une interprétation mythifiée des morceaux choisis et glorieux de l’histoire théâtrale que sont l’Antiquité grecque et la lignée du théâtre populaire de la fin du XIXe siècle à l’âge d’or du TNP de Vilar, la cité du théâtre politique œcuménique maintient et renouvelle l’idée d’une vocation politique ontologique du théâtre. Si l’espace-temps de la représentation théâtrale ne fonctionne pas à la manière d’un débat démocratique, il entend cependant y contribuer pleinement, par la création d’un « espace public polémique », l’assemblée théâtrale réunissant la scène et la salle fonctionnant comme une caisse de résonance dans laquelle s’amplifie l’écho d’une intelligence sensible. La cité du théâtre politique œcuménique, dont le principe supérieur commun pourrait être résumé par la formule « théâtre d’art-service public », active une politique de la pitié. Dans cette cité les artistes, qui estiment avoir une responsabilité singulière dans le débat public, constituent des tribuns de choix. Certes ils récusent le modèle du théâtre de lutte politique, à la fois par refus d’une instrumentalisation de l’esthétique au service le politique, et par désaccord idéologique avec l’autre lignée du théâtre populaire, que nous avons appelée théâtre populaire de classe, historiquement lié à l’idéologie marxiste et aux partis d’extrême gauche. Les artistes de la cité du théâtre politique œcuménique entendent bien pourtant s’inscrire eux aussi de plain pied dans le débat politique du fait même d’une double spécificité, de « conscience » et de parole. S’ils sont de ce fait pour partie assimilables à la noble catégorie des intellectuels, eux aussi dotés d’une parole publique spécifique, ils se démarquent cependant non seulement du modèle de l’intellectuel partisan inféodé idéologiquement et artistiquement, et même du modèle sartrien, mais se démarquent aussi, plus profondément, de la légitimation de la parole de l’intellectuel en tant que telle. Les artistes de la cité du théâtre politique œcuménique prennent la parole non pas au nom d’une compétence, d’un statut d’expert, ni au nom de principes politiques, mais au nom de leur conscience, précisément, c’est-à-dire d’un élan individuel et moral. Depuis la fin des années 1980, dans le contexte d’une défiance à l’égard de la classe politique et d’une crise idéologique des valeurs associées à la gauche, l’on constate en conséquence une double évolution de l’engagement des artistes, tant sur le plan des causes défendues que des modalités de leur défense.
L’engagement des artistes, de la défense de l’État-nation républicain
aux droits de l’homme universalo-européens
La notion de service public chère aux artistes de la cité du théâtre politique œcuménique active également une définition légitimiste de la politique. Le théâtre est ontologiquement politique aussi en ce qu’il constitue une catégorie d’intervention publique. Il ne s’agit pas d’un devoir de propagande idéologique bien-sûr, au contraire le théâtre de service public s’est historiquement construit contre le spectre d’un art officiel. L’ancrage idéologique de ce théâtre tient à son oscillation permanente entre la célébration des valeurs démocratiques et républicaines, et la critique de telle ou telle incarnation de l’État-nation qui contreviendrait aux principes fondateurs hérités de la Révolution Française, incarnés par la Déclaration des Droits de l’Homme d’une part, et la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » de l’autre. Cette oscillation a pris depuis les années 1970 une rythmique singulière du fait du passage de l’idéologie républicaine à l’idéologie des droits de l’homme, qui insiste sur les droits naturels et universels de l’homme moderne davantage que sur les droits d’un citoyen ancré dans le cadre de l’État-nation. Certes, le début de notre période coïncide avec l’espoir d’une fin démocratique de l’Histoire dans une Europe pacifiée par l’effondrement du bloc soviétique, et les cérémonies du Bicentenaire marquent la volonté que les héritiers de Vilar renouent avec la vocation paradoxale d’un théâtre de célébration critique des valeurs républicaines et démocratiques, héritées des Lumières et d’une interprétation œcuménique de la Révolution Française. Mais après ce sursaut aussi spectaculaire qu’en rupture avec la période qui précède, les années 1990 confirment l’effacement de l’idéologie nationale et républicaine, au profit d’une défense des droits de l’homme contre la barbarie et les nouveaux visages du Mal, dans une lecture manichéenne et morale des conflits existant à l’échelle européenne et nationale, de la guerre en ex-Yougoslavie au soutien aux sans papiers. L’omniprésence de la référence au « théâtre populaire » et au « théâtre public », ainsi que la vivacité du débat que ces expressions suscitent, nous paraissent cacher la profonde crise que traverse au XXIe siècle la cité du théâtre politique œcuménique. Ses raisons sont nombreuses et profondes, mais paradoxalement cette crise profite pour l’instant à la formule « théâtre populaire », brandie par les artistes comme un dernier rempart pour asseoir la légitimité d’un théâtre qui précisément n’en a plus en tant que service public, d’une part parce qu’une partie des artistes et directeurs d’institutions en ont fait le deuil, d’autre part parce que sans public – ou avec un public qui ne représente plus qu’une infime minorité de la population – il devient difficile de légitimer le financement du théâtre par la collectivité. La crise que traverse la cité du théâtre politique œcuménique nous paraît tenir plus fondamentalement à la crise idéologique que traversent la gauche et l’idéal républicain – et cette crise se cristallise précisément autour des notions de « peuple » et de « Nation ». Comment défendre le service public découplé de la référence au cadre de l’État-nation républicain nourricier et interventionniste ? Ariane Mnouchkine paraît à ce titre marginale autant qu’emblématique, par sa défense de la République et de la nation, de même que par le caractère explicite de son appartenance sinon partisane, du moins politisée, dont témoigne son soutien à la candidate socialiste à l’élection présidentielle de 2007. 1474 En ce sens, il nous paraît symptomatique que la référence à la nation tende à s’estomper dans le discours des artistes de la cité du théâtre politique œcuménique, tandis que la référence à l’Europe considérée comme l’antichambre de l’universalité des droits de l’homme, prend de l’ampleur, dans le même temps que la référence au « théâtre citoyen » laisse la place au « théâtre d’art » – et la formule témoigne ainsi de l’évolution d’un Olivier Py vers le refus de toute orientation idéologique explicite à mesure de sa prise de pouvoir institutionnelle sous des pouvoirs politiques de droite. 1475
Notes
1474.
La page « guetteurs et tocsins » du site du Théâtre du Soleil renvoyait durant la campagne de l’élection présidentielle 2007 au site « Désirs d’avenir » de la candidate socialiste Ségolène Royal.
1475.
« Le cas emblématique reste Olivier Py. Sa légitimité artistique n’est pas en cause. Mais sa nomination à la tête de l’Odéon est tout sauf innocente. » René Solis, « A la grâce de Donnedieu. Les nominations du ministre de la Culture sont contestables », Libération, 04 mai 2007.
Du théâtre citoyen au théâtre d’art ?
Ambiguïtés et reformulations de la défense
du « théâtre de service public » de 1989 à 2007
Dans la cité du théâtre politique œcuménique, le premier devoir de l’artiste a toujours été et demeure un devoir esthétique, et en ce sens le militantisme à l’œuvre dans cette cité se voue avant-tout à la cause… du théâtre et de la culture, dont la nécessité demeure légitimée aux yeux des artistes de la cité du théâtre politique oecuménique par la foi dans leur vocation civilisatrice. Mais, alors que dans les années 1990 triomphe la vision du théâtre populaire comme « théâtre citoyen » et la figure de l’artiste comme citoyen engagé d’abord dans son art mais aussi dans les affaires du monde, la formule « théâtre d’art » vient en force au début du XXIe siècle radicaliser encore le recentrage du militantisme sur la culture et le théâtre. L’évolution du contexte politique revêt à ce titre une importance fondamentale. Si l’heure de gloire du Ministère Lang sur laquelle s’ouvre notre période contient en germe le passage de l’interventionnisme au désengagement de l’Etat au profit des collectivités territoriales notamment, c’est le retour de la droite au Ministère de la Culture en 2002 qui va remettre en cause la vocation même d’une culture et d’un théâtre publics. Car ce n’est plus seulement de décentralisation des politiques culturelles, mais de privatisation, qu’il va de plus en plus être question désormais. Or les artistes dont il est question ici prônent le primat de l’esthétique sur les enjeux sociaux et politiques, et ne peuvent ni ne veulent en outre plus appuyer leur défense sur l’ambition de démocratisation ni sur l’universalité du jugement de goût ou le caractère populaire de la fréquentation des théâtres.
Pour défendre la nécessité d’un engagement de l’Etat dans la culture, ils insistent donc désormais moins sur la mission que sur le statut de service public du théâtre, et font de la vocation civilisatrice et spirituelle de la culture un argument contre la privatisation du secteur culturel considéré à la fois comme partie intégrante et comme métaphore de l’espace public démocratique et républicain. Le théâtre public est défendu comme projet de civilisation contre la marchandisation généralisée d’une société qui ne définirait plus l’homme que par son statut de producteur-consommateur, et c’est ainsi contre le risque que l’art soit « domestiqué par la consommation culturelle » 1476 et face à l’urgence majeure que constitue l’élection présidentielle de 2007 que le « monde du spectacle vivant » en appelle à la « République artistique et culturelle. » Cette posture de résistance liée au contexte politique le plus récent demeure cependant centrée sur la question culturelle, et l’intégralité des propositions de la lettre ouverte précédemment mentionnée ne font en réalité pas consensus, notamment la volonté de « structurer le lien social » ou renouer avec la « force de contestation » du théâtre, qui démarquent respectivement la cité du théâtre politique œcuménique de la cité du théâtre de refondation de la communauté politique, et de la cité du théâtre de lutte politique. Cette dernière se caractérise ainsi par une filiation avec l’autre lignée du théâtre populaire – de classe – qui n’oppose pas l’idéologie à l’idéal, et voit dans 1989 non le tombeau du marxisme mais le renouveau de la contestation politique, ce dont témoigne le renouveau d’une lecture politique de Brecht. Et la cité du théâtre de refondation de la communauté sociale et politique assume quant à elle la vocation de démocratisation du théâtre de service public, fondée non pas sur une métaphysique de l’art et une figure prophétique de l’artiste, mais sur un refus d’abandonner la préoccupation concrète du public et du peuple, du peuple comme public et du public comme peuple et sur la volonté, par le théâtre, de refonder la communauté civique.
Notes
1476.
« Pour une République artistique et culturelle », Lettre ouverte du monde du spectacle vivant aux candidats à l'élection présidentielle, signée par quarante artistes et directeurs de structures culturelles, « Rebonds », Libération, 15 mars 2007.
|
|
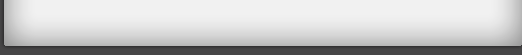 |
|