Conclusion générale
‘ « Peut-être quelques lecteurs auront-ils suivi avec étonnement d’abord, avec effroi ensuite cet exposé ; et ils en auront tiré la conclusion qu’il s’agit à nouveau d’une psychogenèse de la maladie mentale [...] Or, c’est justement cela que j’ai voulu éviter de faire :
étudier des malades mentaux et les rencontrer dans leur monde, ne signifie en aucune façon présenter une psychogenèse des maladies mentales.
Pour moi, j’établis une distinction très nette entre ces deux méthodes.
Mon travail vise uniquement à manifester la possibilité de saisir la manière d’être des malades dans la rencontre, en particulier dans le dialogue avec le médecin.
Mais cela n’implique pas du tout que la cause de la maladie mentale soit psychique. La psychose a un niveau qui s’ouvre au dialogue, et par conséquent, à une thérapie, à un traitement par la parole. 92 » (p. 29) ’
Cette citation de Gisela Pankow (1969) nous semble tellement bien restituer l’orientation et la tonalité générales de notre travail, que nous avons souhaité la faire apparaître en « caractères gras » pour mieux la mettre en avant.
Nous avons en effet parfois craint de sidérer le lecteur ou auditeur à travers l’élaboration et le développement de notre pensée. A plusieurs reprises, il nous est apparu que le contenu de cette recherche : tenter d’émettre des hypothèses à partir de ces « histoires de miettes ou de boudins » était complètement « farfelu. »
Il n’empêche que tout d’abord, cette pensée au pu être communiquée et partagée à plus d’une reprise et trouver des échos, des renvois qui l’enrichissaient.
Et surtout, du côté des patients, il m’apparaissait, sous forme d’une conviction quasi inébranlable, qu’il se passait quelque chose qui n’était réductible ni à la détermination de leurs pathologies qui les enfermaient, ni à un seul effet psychomoteur résultant du travail de la matière terre dans l’ici et maintenant.
Tout cela résonnait, quelque part, « ailleurs, et autrement. »
Et il aurait été impensable de passer à côté.
Si la médiation constitue un dispositif préétabli, dispositif matériel, technique, d’espace, de temps, comme le souligne M. Rodriguez :
‘« La quintessence de la médiation est immatérielle, elle est dans les processus qui visent au déploiement de l'activité représentative »93. ’
A partir d'une situation thérapeutique préétablie décrite par D.W. Winnicott (le jeu de la spatule), M. Rodriguez définit certains des mécanismes en jeu dans le processus de médiation.
L’auteur repère trois fonctions principales de médiation.
Tout d’abord, la première fonction vise à constituer un objet d’attention conjointe, c’est-à-dire à faire converger les regards vers un même point, une même activité, autrement dit à déplacer la séduction de l’adulte vers un élément particulier du dispositif. L’objet médium, à l’image de la spatule, devient un objet qui s’interpose entre le thérapeute et le patient, un objet convergent qui vise à instaurer une triangulation thérapeute-patient-dehors.
Ensuite, la deuxième fonction concerne la capacité à pouvoir utiliser, manipuler, à l’image d’un objet concret, une partie du dispositif afin d’exercer sur celui-ci l’empreinte de sa subjectivité (appréhension de l’objet médium), du côté de la création ou de la destruction. Dans la médiation, il y aussi cette idée d’utiliser un élément du cadre pour expérimenter, symboliser l’expérience de la rencontre ou de la non-rencontre avec l’autre. Il faut que l’objet survive à la destruction pour que le sujet puisse l’utiliser. L’attitude du thérapeute, qui doit se montrer suffisamment malléable, utilisable dans le jeu intersubjectif, permet le déploiement de l’activité représentative, en acceptant d’être, au même titre que l’objet médiateur, un support des projections.
Enfin, la troisième fonction concerne les conditions nécessaires au déploiement de cette activité représentative. Si celle-ci a besoin, pour être perçue et appréhendée par le patient, de se donner des représentants concrets, c’est au prix de son propre effacement : ce représentant doit accepter de ne rien représenter par lui-même si ce n'est d’être un médiateur, un représentant de la représentation.
Notes
92.
PANKOW G. (1969), L’homme et sa psychose , Paris, Aubier.
93.
RODRIGUEZ M. (1999), La médiation : un processus thérapeutique, L’information psychiatrique, n° 8, p. 822-825.
1. La symbolisation
A partir de la matière terre « à l’état brut », cette première « mise en forme de l’informe » au sein du dispositif autorise et invite à une dimension d’adresse (singulière) à travers les modelages. Ces derniers, à partir de leurs mouvements d’apparition et de traitement de la forme, réactivent par l’entremise du travail du médium malléable, ainsi que nous l’avons présenté, le lien à l’objet primaire.
Témoignant du lien spéculaire qui unit celui qui produit de ses mains la forme à la matière qui l’incarne et qu’il illustre en retour par le geste, à travers elle et les empreintes qu’il y laisse, se reflètent bien les états de son « monde interne », selon les degrés de désorganisation mais aussi de structuration psychique possibles qui lui sont propres.
Ces formes, adressées et partagées avec le thérapeute, mais surtout avec et à partir du groupe, dans l’espace du cadre-dispositif à médiation par la terre, sont des formes empruntes (empreintes) d’une tentative d’organisation de ce monde chaotique et s’adressant à un autre, à d’autres.
Au sein du dispositif, les personnes qui utilisent la matière terre montrent comment l’image du corps peut être révélée, modifiée ou restructurée par la mise en forme plastique. Entre ceux comme Boris qui dévorent le matériel, certains en prennent connaissance par la bouche, d’autres pour se remplir (remplir un corps, un trou sans fond), et ceux qui ont pu utiliser la matière pour véhiculer l’agressivité et décharger des tensions (Paul qui frappe à grands coups ses formes), on voit bien que le corps est partout dans cette rencontre entre la personne et la matière.
Si certains ne pourront toujours pas, par phobie du contact, toucher la matière avec les doigts en fin de prise en charge (Louise), pour d’autres comme Victor, nous assisterons à la naissance des premiers contenants avec leurs limites (passage de formes vides de contenus et béantes, aux formes en trois dimensions et fermées).
Le corporel représente le lieu possible de perception des éléments bruts, perceptions qui se mentalisent ensuite. C’est-à-dire qu’en plus de « mettre la main à la pâte», le thérapeute doit être à l’écoute de son corps et de sa propre sensorialité. La neutralité devient alors un travail de dégagement dans l’après-coup. C’est pourquoi l’analyse des mouvements et réactions sensoriels est primordiale. Le côté primitif de la relation est fondé sur le sensoriel et donne au contre-transfert une tonalité toute particulière : vécus très intenses d’impuissance, de désespoir ou de colère, d’inaccessibilité, mais aussi parfois de petites joies « de rien du tout » qui permettent de « retrouver le fil » et de relancer le tissage du lien...
Il faut aussi supporter de ne pas, ne plus rien y comprendre, c’est-à-dire être dans la maîtrise par la non maîtrise et de s’exposer à des ressentis parfois désagréables.
Le rôle des soignants peut parfois s’apparenter à une simple « conjonction de subordination », mais signifiant le travail de création qui permet des liens de continuité entre représentants psychiques et affects (travail qui renvoie à la stratégie du préconscient). Le soignant met à disposition son appareil psychique, contenant, qui donne un cadre et un sens aux échanges archaïques.
Quant au travail en cothérapie, celui-ci permet de modeler, d’aménager le paysage dans lequel se déroule la rencontre, de manière à pouvoir retrouver ou trouver un sens caché, perdu et incompréhensible, à la trajectoire du sujet en souffrance. Et il s’agit bien là d’un travail au cas par cas, sur-mesure pourrait-on dire, à partir et en partance des accordages sensoriels et affectifs entre thérapeutes.
S’il faut une matrice psychique pour favoriser l’émergence du sens, le thérapeute ne doit pas non plus tout accepter de cet univers chaotique : faut-il se laisser régresser jusqu’à ne plus penser?
Si « penser la cohérence » s’apparente parfois à une défense (en un certain sens le désir initial de cette recherche y participerait), il s’agit de continuer à penser, car le plus grand risque avec les sujets désignés « déficitaires » est le désinvestissement : le regarder et penser à autre chose, laisser faire les stéréotypies, ou pire, se lancer dans un activisme forcené.
Accompagner l’expérience régressive, se laisser porter par le tumulte ou l’apathie manifestes, « laisser faire » et se proposer soi-même comme matière malléable, « bonne pâte » pourrait-on avancer sans péjoration, seraient les maîtres mots de l’expérience de la pratique singulière avec ces sujets.
Mais ceci ne va pas forcément de soi (cf. la séance au cours de laquelle j’ai l’impression de veiller des agonisants). Survivre au chaos et ne rien comprendre est un premier pas : contenir le chaos, c’est « être avec.» Il faut que le thérapeute puisse trouver, se créer, maintenir et préserver une continuité interne, face aux discontinuités du sujet déficitaire.
En ce sens, il fut très important de pouvoir non seulement partager cette expérience en cothérapie, mais aussi faire état de mes recherches et trouver une écoute et un écho dans le cadre des séminaires mensuels à l’université.
Les personnes du dispositif « commenceraient à penser », en ce sens où ils exposent en langage préverbal les représentations primitives de l’établissement des premières relations construisant le Moi-corporel et l’espace. Chez le sujet qui n’a pas accès à la parole, l’image du corps est une médiation pour dire les fantasmes qui habitent et organisent son monde interne, cette manière de dire restant à décoder. Toute la difficulté est de ne pas interpréter d’emblée du matériel plastique, mais de considérer l’enchaînement des productions (comme les associations d’idées dans la cure analytique).
En effet, l’image du corps et les traces de l’originaire ne sont pas représentés dans le modelage, elles ont à se révéler par le dialogue analytique avec le patient (enchaînement des productions, chaînes associatives groupales).
Par ailleurs, le toucher et le contact participent aussi à la construction intrapsychique en ce sens que les processus psychiques primaires sont à l’œuvre dans l’association des idées, qui se font par contiguïté et par similitude.
La manière de modeler, propre à chaque sujet, peut être considérée comme signifiante et le modelage final comme un signifiant corporel en ce sens où l’activité plastique obéit à des « lois de composition » dont nous avons dégagé une structure spécifique.
Le modelage constitue un support pour la symbolisation primaire.
La symbolisation primaire rend donc compte du temps premier de la constitution des premières formes de représentants psychiques de la pulsion, premier travail de métabolisation de l’expérience pulsionnelle (transformation des traces perceptives en représentations de chose).
Mais que se passe-t-il quand cette symbolisation primaire est défaillante, comme c’est le cas dans les organisations psychotiques ou les troubles autistiques ?
Pour pouvoir se déployer correctement, le travail de la symbolisation primaire a besoin d’objets psychiques singuliers et disponibles qui puissent être investis et utilisés. Il existe aussi des objets matériels qui, de par la nature même de leur matérialité, servent de manière privilégiée à la symbolisation primaire dont ils permettent de percevoir certaines caractéristiques fondamentales. En particulier, les objets qui ont les caractéristiques du médium malléable permettent ce mouvement de symbolisation primaire.
L’utilisation de la figure sensorielle plastique permet à l’observateur clinicien d’accéder à la symbolisation primaire (par l’entremise du médium malléable). Pour le patient, elle peut être à la fois une étape de recherche active de Moi-auxiliaire partiel et une étape de récupération d’une fonction alpha partielle (Bion). Cette utilisation permet une première réappropriation du corps propre, structure dont il est crucial d’assurer la permanence et la continuité (apparition et disparition de formes dans un jeu permanent de formation, déformation, adaptation d’elles-mêmes).
2. La psychose : une affaire de groupe
Cette première « mise en forme » de la matière, adressée et reprise dans le cadre-dispositif à travers la transformation psychique offerte par le travail de groupe et aussi celui de mise en pensée des thérapeutes, a donné lieu à des formes concrètes capables d’affronter le temps. Les formes produites rendent compte des chaînes associatives, d’une séance à l’autre, témoignant tour à tour de la spatialité psychique du sujet ainsi que de celle des processus ayant trait à la constitution du groupe et de ses enveloppes.
Les différents temps décrits de la construction de notre mise en pensée du groupe, à partir des états de la matière, risqueraient de négliger qu’au fond, « le groupe » en lui-même, était présent d’emblée, ainsi qu’à partir des effets de la groupalité interne qui s’y inscrivaient et dont les résidus métonymiques constituaient un lieu de dépôt, de mise en forme, mise en sens.
Alors, sans le groupe : pas d’issue pour la pensée ?
Nous avons expérimenté que le groupe, en particulier dans le cadre d’une pratique avec des personnes psychotiques, semble d’emblée offrir une dimension symbolisante.
Les actes symboliques décrits à partir des sphères plus individuelles témoignent des différents temps de la groupalité. Les uns et les autres se sont construits en étayage. Nous avions pensé intégrer à notre grille de repérage des actes symboliques les « états du groupe », mais cela présentait le risque de stigmatiser, figer le groupe dans un temps particulier et de négliger les rapports toujours complexes d’inclusion, de superposition ou d’exclusion des processus psychiques à l’œuvre.
Or, ce sont bien les va-et-vient entre la constitution du groupe, hic et nunc, qui permettaient le déploiement des actes symboliques, non seulement en fonction de ce dont les sujets pouvaient témoigner, mais aussi et toujours de ce que la situation groupale avec les chaînes associatives et les processus qui lui sont propres pouvaient engendrer (c’est la fonction « conteneur » du groupe).
Les processus de la symbolisation auraient trouvé matière à s’incarner. Mais les actes symboliques décrits, rappelons-le, ne valent que parce qu’ils se déploient et s’inscrivent dans le cadre du dispositif groupal à médiation par la terre, parce que la mise au travail du médium malléable leur donne une possibilité d’utilisation, d’empreinte, de résistance.
Les personnes psychotiques nous auraient-elles permis d’apprivoiser notre propre groupalité interne ? Pourquoi avoir mis tant de temps pour parvenir à penser cette question ?
Il s’agirait dans un temps premier d’une position contre-transférentielle quasi aussi rigide que celle propre aux processus autistiques auxquels nous nous confrontions.
Rien ne nous assurait aux débuts du groupe qu’il existait une membrane capable d’inscrire et de conserver les traces de ce qui apparaissait.
Un groupe est une enveloppe qui fait tenir ensemble des individus. Tant que cette enveloppe n’est pas constituée, il peut se trouver un agrégat humain, il n’y a pas de groupe, nous dit D. Anzieu.
Rappelons alors que dans le cadre du groupe archaïque, il me fallait souvent au début faire appel à ma mémoire pour vérifier que tout le monde « était bien présent » (et il n’y avait jamais d’absents à ce moment là.) Cette première « recomposition du groupe » dans ma tête était bien la preuve que le groupe commençait à exister à travers cette première délimitation et ce « portage en interne », dans mon propre appareil psychique. Le groupe commencerait à exister « dans la tête » du thérapeute, qui peut contenir et transformer ce matériel, en convoquant et mettant au travail sa propre groupalité psychique interne.
Si le pâteux a menacé de rendre poreuses les frontières entre les êtres et de nous diluer tous ensemble dans ce magma, c’est aussi la groupalité psychique des autres membres du groupe liée à celle des thérapeutes, qui a permis de contourner ce risque. Les processus s’emboîtaient les uns dans les autres, devenant de plus en plus élaborés et plus complexes, à l’image des formes sensorielles qui s’enchaînaient au fil des séances, ainsi que prenait corps la réalité psychique groupale.
Et c’est bien à partir de « cette boue originaire » (le pâteux de la barbotine), qu’a pu naître le groupe, dont les appareillages singuliers au sein d’une entité qui les dépassait et les mettaient en forme et au travail, la réalité psychique groupale, déroulait alors des chaînes associatives témoignant de la construction d’une histoire, plus encore, d’une trame symbolique.
Il y aurait quelque chose d’évident dans la mise en rapport du groupe et de la psychose, qui renverrait sans cesse l’un à l’autre, tout comme il nous apparaît maintenant que l’image du corps est d’abord et avant tout groupale.
Les sculptures de Camille Claudel sont-elles, à ce titre, des représentations de groupe ? Répondre à cette question permettrait de lier émotion intime et histoire personnelle se dégageant de ses œuvres, à des éprouvés partagés et une histoire universels.
Lorsque sa création se tarit et alors qu’elle est dans l’isolement le plus complet et dans la peur extrême parce que déjà enfermée dans un délire de persécution (ses persécuteurs sont-ils une projection de sa groupalité psychique ?) et qu’elle détruit ses œuvres à coups de marteau, Camille tente-t-elle de préserver quelque chose de son unité intérieure menacée, ou bien s’attaque-t-elle à réduire à néant ce que ses œuvres portent de la multiplicité ?
Soulignons que nombre de ses créations sont des scènes à trois, qui donnent à voir quelque chose du groupe.
Nous oserons dire qu’il y a en tous les cas « du groupe à s’en émouvoir » dans son œuvre, car quand bien même elle sombra dans la psychose (folie qui, aujourd’hui, on peut s’autoriser à l’imaginer, ne serait pas guérie mais peut-être mieux soignée), nous nous sentons toujours aussi proche d’elle.
Les œuvres de ces créateurs, dont certains ont souffert le martyr, sont aussi à notre sens partie constitutive du patrimoine de notre groupalité psychique interne à laquelle ils participent.
Et si nous sommes universellement sensibles aux signes qui émanent de leurs œuvres, que ces signes nous touchent et trouvent un écho dans notre intimité la plus profonde, et au-delà des souffrances abominables que les auteurs ont pu endurer, c’est bien qu’il y a dans cette rencontre la marque du semblable, du partage.
Sans cette « pâte commune » et qui résonne, la vie serait peut-être bien ennuyeuse...
Alors avec beaucoup d’humilité, que ce travail leur soit aussi dédié.
3. Laisser venir les fantômes...
Parvenue au terme de cette recherche, j’aurais envie de dire, en proie à une joie certaine, mais déjà aussi à un peu de nostalgie : « Quelle aventure ! »
Vient maintenant le temps de la séparation...
Je puis à mon tour affirmer, au sujet de l’activité spéculaire du psychisme propre à l’originaire que P. Aulagnier (1975) a mis en évidence, qui jusqu’alors concernait dans mon travail les personnes psychotiques dans leur rapport à la matière brute, avoir moi-même expérimenté ce rapport dans l’élaboration de cet écrit. Cette composition a mobilisé ma sensibilité, à partir de ma propre sensorialité.
L’élaboration de ma pensée se construisait d’abord et avant tout « en miroir » de la matière clinique brute qui se présentait à moi, pour la modeler à mon tour, la mettre en forme et l’organiser. Néanmoins, je ne restais pas prisonnière de cet effet spéculaire.
Ecrire implique un bouleversement qui nécessite de s’organiser (voire se réorganiser) « en interne », mais aussi à l’extérieur de soi un environnement particulier, qui serait propre à chacun. Pour ma part, il m’aura fallu « me mettre au vert » en retrouvant dans une maison généreusement prêtée à la campagne des lumières, des odeurs, qui m’ont permis de retrouver le rythme apaisant de la nature mère. Se couper un temps du monde pour se laisser « doucement régresser » à un état intérieur à partir duquel s’originerait bien toute création psychique. Le formlesness de Winnicott constitue le point de départ, le « point aveugle » à partir duquel tout un chacun doit composer.
Ce moment de « douce régression » fut pour ma part joyeux. Mais je n’ai pu m’empêcher de penser que face à cette question, nous ne sommes pas égaux. Ceux qui sont dans la nécessité de la création pour survivre le diraient probablement avec d’autres mots, à partir d’autres maux.
Si Camille Claudel, et aussi les patients psychotiques, m’émeuvent tant, c’est peut-être parce qu’ils ont la capacité de faire resurgir en moi comme en tout un chacun « du semblable, du même », mais aussi et surtout de nous emmener (pour ne pas dire parfois de nous « rapter » émotionnellement, comme c’est le cas avec Camille), en nous permettant de trouver une « impulsion » à partir de ce noyau (psychotique), pour aller plus loin.
Aller plus loin, toujours avec eux, mais aussi et surtout dans la rencontre de l’altérité interne, propre à chacun et présente entre les êtres, constituant cet espace de manque à jamais irréductible, lequel nous « pousse » à chercher, bâtir, penser, créer, enfanter...
C’est sûr, ce qui « pousse » les créateurs à faire œuvre, peut-être aussi ce qui interroge le psychologue et tous ceux qui y sont sensibles, c’est bel et bien cette « prima materia » à mettre en forme. Des uns aux autres, la matière brute, si elle semble partir du même point d’origine, ne serait pas la même et pas ressentie ni transformée au même endroit, quoi que...
Il n’empêche que cette « prima matéria », tout comme la psychose, pourrait nous prendre tout entier dans ce risque de la fascination, par un effet de miroir, si nous ne tentions, à partir de nos parcours singuliers (et à ce titre notre histoire intime est elle aussi et avant tout la prima materia qui oriente nos routes), de nous en déprendre.
Partant de la même illusion que celle qui anime l’enfant qui ramasse dans la boue une substance dont il s’imagine faire des empires, lesquels se solderont dans la confection du « pot à crayons » trônant et perdurant sur le bureau d’une mère ou d’un père qui accueilleront avec tendresse et émerveillement cette « petite création de rien du tout » qui leur est adressée, nous aurions tous une désillusion à affronter.
Mais à partir de l’illusion désillusionnée de l’empire qui n’existera peut-être bien que dans l’imaginaire de l’enfant, le pot à crayons symbolise : c’est encore un trajet qui part du vide et du plein qui s’affrontent, une histoire de contenants, de peau.
Du pâteux qui nous menace sous forme de retour à la matière à l’élaboration du pot, la subjectivité au travail s’inscrirait dans les processus qui mènent au « produit fini » et témoignent de la symbolisation à l’œuvre et d’un mécanisme sublimatoire ?
Il y a le temps de l’éprouvé du formlesness (que nous pourrions à juste titre rapprocher de l’état pâteux de la matière et de « l’informe » dont il a été question dans notre travail), temps de désorganisation nécessaire à la mise en forme et à la tentative d’organiser au dedans une première cohérence de ce qui se dessine au dehors.
Il y a les moments de jubilation pour ne pas dire de jouissance propres à l’élaboration formelle, le « modelage de la pensée » qui s’organise et l’écriture semble alors couler naturellement et spontanément, s’incarne dans le déroulement du texte et y prend corps, trouvant un rythme qui rejoindrait celui du cosmos, de la nature mère et des sensations premières.
Il y a aussi les moments de doute atroce, la cohérence étant menacée par un retour surmoïque qui viendrait dire que « c’est insensé », que tout cela n’est que le produit d’une défense monumentale érigée contre le vide, nous ramenant au noyau psychotique en quelque sorte, menaçant de nous coincer à nouveau dans le rapport spéculaire, condamnant la pensée à l’errance, au « sans corps » et sans enveloppe de contenance.
Il s’agirait alors d’une redite du « Miroir, mon beau miroir... », à travers une version soumise à variations. Cette dernière correspondrait à l’expérience de Persée, qui contemple dans l’image renvoyée par son bouclier celle de la Gorgonne. S’il l’a tuée par ce stratagème, alors qu’elle avait le pouvoir de foudroyer de son regard ceux qui s’y laissaient prendre, c’est bien aussi sa propre image qu’il contemple. La sculpture de Camille Claudel à ce sujet, lorsque l’artiste commence à se sentir « coincée » dans son processus de création et que la folie la guète nous le fait bien ressentir.
Il est alors nécessaire de se trouver un nouveau souffle, d’aller « se réinjecter de l’Autre » pour que la boucle ne se referme pas sur elle-même. Puis alors l’extérieur, « l’Autre » (un directeur de recherches, un(e) ami(e), une sœur, un collègue ou encore un psychanalyste), qui nous entend ou qui nous lit, nous permet de rebondir et de mettre à distance ce risque de renoncement ou de « torpillage » de ce qui se construit alors. Les défenses s’assouplissent (entre autres le recours compulsif à la théorie), et « le public interne » (interlocuteur ou lecteur imaginé, véritable groupe interne qui condense les personnages susnommés) est convoqué, et cette dimension d’adresse à un autre permet alors d’inscrire dans un espace plus juste, nous « décalant du miroir », pour se proposer comme un espace au-delà de la fusion psychotisante, un espace à « plus de deux ».
D’ailleurs, ne dit-on pas que dans une rencontre, on est toujours « plus que deux ?»
C’est donc finalement à partir de, et dans mon corps, que j’aurai aussi laissé « nicher et incuber » les éléments hétérogènes issus de la rencontre avec les patients, éléments qui ont constitué tour à tour le socle et le creuset de mon propre questionnement, le besoin de les élaborer dans une pensée pour leur donner une cohérence, à nouveau « un corps », et à partir de cette mise en forme, leur permettre de croître pour envoyer en retour, à partir du « même », un écho différent, modelé aux formes de l’altérité.
Au terme de ce travail, les associations qui me viennent témoignent de la groupalité psychique interne à laquelle j’avais résisté. Ce travail semble s’emboîter avec les éléments de mon histoire personnelle et ceux de mon parcours professionnel. Les processus psychiques s’appareillent bel et bien les uns aux autres d’abord et avant tout selon un lien de contiguïté avant de pouvoir être pensés dans un lien de continuité et être mis en forme, en histoire, insérés dans une trame symbolique qui alors pourra inclure de l’Autre en son sein et croître.
Mais pour cela, il faut « laisser venir les fantômes »...
Fantômes de notre histoire personnelle, fantômes de l’histoire de l’institution, et surtout fantômes auxquels la psychose nous confronte. Au sein de la psychose, la froideur de ces entités nous fait ressentir que ces fantômes y sont en errance. Ils menacent toujours et encore de « mortifier en retour » celui qui s’y colle, pour qu’enfin advienne le corps singulier d’une pensée qui fait sens et d’une émotion partagée.
Enfin, avec une émotion certaine, il faudra nous déprendre de « cette aventure » pour composer, avec nos mots, la conclusion qui s’impose. Moments d’angoisse aussi, qui nous met dans un vécu d’insécurité, de fragilité, nous donnant presque l’impression « d’être toute nue », mais il est temps maintenant « d’ouvrir » et de proposer alors à d’autres de prendre connaissance de ce travail, de le lire, d’accepter de se risquer à l’altérité, et tout simplement, de ponctuer par un point final, aussi pour pouvoir « grandir » et passer à autre chose...
|
|
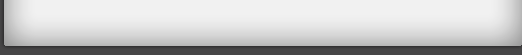 |
|