Introduction
De l’origine d’un parcours de recherche à partir de l’originaire
Lorsque j’ai rencontré Maria, Boris, Louise, Ernesto, Paul et Samuel, je travaillais comme psychologue dans une institution à caractère médico-social, et il s’agissait alors de ce qui constituera mon premier « lieu d’ancrage » professionnel.
L’établissement accueillait en externat des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles du comportement (selon les termes mentionnés par le livret d’accueil et le projet d’établissement).
La population était très hétérogène en âge et quant aux troubles rencontrés.
Les premiers instants de la rencontre avec ce public alors inconnu constituèrent un temps d’étrangeté.
Peu avaient accès à la parole, ou alors l’utilisaient sans véritable valeur de communication, sur un mode écholalique ou stéréotypé.
L’équipe qui œuvrait à l’accompagnement quotidien des personnes accueillies réunissait alors une directrice d’établissement, des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, ainsi que des intervenants à temps partiel : une psychomotricienne, un médecin psychiatre, un psychologue.
Le temps de prise en charge à la journée déclinait des activités encadrées par des éducateurs spécialisés.
Soucieuse de saisir la nature des problématiques source d’étrangeté auxquelles je me trouvais confrontée, ainsi que d’envisager en réponse, une possible intervention, je commençais par observer ce qui se déroulait pendant les temps d’interactions, entre les personnes accueillies et les professionnels.
Aussi, après un premier temps de prise de contact, je partis à la recherche d’éléments d’anamnèse ainsi que cliniques, susceptibles de me renseigner sur la nature des troubles de ces personnes. Je consultai leurs dossiers et questionnais ceux qui les accompagnaient.
La lecture des dossiers me renseignait très mal quant aux éléments d’histoire et s’accompagnait d’un sentiment de confusion quant à l’hétérogénéité des troubles : « psychoses infantiles à expression déficitaire », « troubles autistiques », « encéphalopathie congénitale », « retard global de développement d’origine indéterminée », ou encore « dysharmonie évolutive », etc.
Du côté de l’étiologie, manifestement rien ne m’orientait, j’étais « dans le vide », et de toute façon, aucune « étiquette ne collait. » Je compris vite qu’il n’y avait rien à chercher de ce côté là.
Quant aux éléments d’anamnèse, les personnes concernées avaient pour la plupart suivi un parcours institutionnel dès leur plus jeune âge (d’abord le jardin d’enfant thérapeutique, puis l’Institut Médico-Educatif, etc.)
Cependant, il ne restait que peu de traces de cette histoire.
Il semblait que le passage à l’âge adulte ait « effacé », comme pour ne pas en pâtir, l’histoire des troubles des personnes, provoquant un effet d’amnésie de l’anamnèse...
Du côté du personnel, si certains formulaient un questionnement et tentaient d’établir des liens, d’autres, plus anciens, connaissaient les difficultés d’antan posées par les troubles des personnes, et à les entendre « tout allait mieux », le « tout » symptomatique semblant être « rentré dans l’ordre », et ce alors même qu’ils me livraient à travers cette histoire des éléments cliniques importants.
Mais, pour l’instant donc, « rien à faire. » Je décidai alors de partir du moment présent, poursuivant mon temps d’observation, m’imprégnant de l’ambiance et restant à l’écoute tant du discours des éducateurs, de celui de l’institution, que des signes et indices cliniques dans l’expression des sujets.
Prise entre fascination et sidération, j’observais ces personnes.
Certaines se balançaient sur elles-mêmes, écholaliques, vocalisant ou poussant des cris, tournoyant dans l’espace comme des toupies, saisissant des objets pour subitement les laisser choir et s’en détourner.
D’autres s’en prenaient parfois à leur propre corps (se griffant, se giflant, se tirant les cheveux ou grattant sans fin des plaies qui ne cicatrisaient jamais), d’autres encore étaient figées et recroquevillées sur elles-mêmes comme des enveloppes vides, comme si le cours du temps était suspendu.
Certaines s’agrippaient à moi physiquement alors que d’autres semblaient mettre toute leur énergie à faire fi de ma présence et détourner ostensiblement leurs regards.
Je voulais tenter d’être avec elles, mais alors, comment bâtir un pont entre ce monde psychique qui m’apparaissait relever de processus très archaïques et le mien, celui du sujet qui se pense, se réfléchit et peut parler en son nom ?
J’entendais parler de « maintien des acquis », d’organisation d’activités, et relevais assez rapidement qu’il s’agissait d’occuper ces personnes, saisissant que les temps collectifs de transition ou de « rien », lorsqu’aucune activité n’avait lieu étaient redoutables pour tous.
Tous les temps d’accueil ou d’activité avaient lieu en groupe, et à aucun moment ni à aucun endroit, les personnes ne pouvaient échapper à cette exigence collective.
Les activités proposées avaient un caractère éducatif ou social. Elles étaient nécessaires, parfois ludiques ou créatives et proposaient un cadre qui rythmait la journée et la semaine, et procuraient aux personnes accueillies un effet de structuration psychique indéniable.
Néanmoins ce qui m’interrogeait dans le discours de l’institution et de ceux qui accompagnaient les personnes accueillies était cette apparente appétence au « faire ».
Il fallait remplir la journée et exiger la concentration, la compétence, la réalisation de quelque chose de visible et palpable de la part de ces personnes qui m’apparaissaient alors comme « dans les limbes.» Impossibilité vraisemblable du « rien » ou du manque (faire une activité sans consigne exigée, se sentir exister...voire être ensemble et ne rien faire...), il fallait travailler à faire accepter leurs différences tout en même temps qu’il fallait les tirer, les rendre semblables à nous-mêmes, à notre monde social organisé.
Par ailleurs, je saisissais aussi dans les temps de réunion la difficulté du côté des professionnels qui les accompagnaient à retracer ou raconter le parcours de ces personnes devenues adultes, comme si la lourdeur de leur déficience et de leurs troubles dont l’expression était souvent stéréotypée enfermait tout le monde dans une « chronicité » (avec un effet de répétition) et les figeait comme des personnes qu’on pourrait croire « sans histoire » (sans enfance, voire parfois sans filiation).
Il est certain que le « sujet déficitaire » entraîne souvent un processus d’anticipation du côté des professionnels, comme si la personne était coincée dans un état, ne pouvait dérouler, déplier sa vie dans un mouvement ascendant qui prendrait appui comme tout un chacun sur des étapes, des épreuves, des processus qui permettent de progresser.
Ainsi la formalisation d’objectifs autour de « l’autonomie », « l’intégration », le « maintien des acquis » apparaissaient-ils dans le discours de l’institution comme une réponse parfois « en miroir », qui viserait à masquer, boucher l’inévitable et impossible identification à laquelle ces personnes nous confrontent.
Si, dans un premier temps, je prendrai part à ce discours, ce dernier me laissera vite insatisfaite. J’avais l’impression de ne pas parler de ce qui m’importait et me semblait essentiel : la difficulté de la relation et la souffrance qu’elle pouvait engendrer.
La question était dangereuse parce que probablement douloureuse de part et d’autre, ou coûteuse à penser pour les membres de l’équipe car elle impliquait de s’extirper de la chronicité et de penser cette dernière.
Qu’importe, je décidais de « m’y coller », et de prendre le risque de m’y laisser aller...
Après un temps de franche sidération, j’en suis venue à envisager qu’il y avait peut-être chez ces personnes désignées « handicapées » un déficit moins mental que processuel.
Mais alors, que pouvais-je imaginer pour partager les tourments de ce monde archaïque sans risquer de me faire engloutir et qui ne relève pas du registre de l’agir ?
Face à ce monde qui m’apparaissait plus qu’une régression comme quelque chose « d’informe », je ressentais l’envie de proposer « quelque chose d’autre » en terme de dispositif thérapeutique.
A travers un premier ressenti contre-transférentiel, ces personnes semblaient solliciter ma présence sur un mode corporel et sensoriel, me donnant envie de « jouer » à partir de ma présence (musicalité des mots dans la parole, attitudes corporelles, toucher).
J’éprouvais au début de l’angoisse, mais aussi l’envie de « border », psychiquement mais aussi parfois corporellement, de « me laisser faire » (une personne, à la manière des enfants autistes me prenait la main pour tenter de me montrer ou prendre quelque chose), voire d’envelopper et donner une contenance, de mettre des paroles affectivées sur les manifestations de ce mode d’être au monde à priori « sans enveloppe » ou caché derrière des forteresses.
Il me venait l’intuition qu’il fallait partir du corps, des sensations de ces corps qui semblaient comme diffractés, morcelés dans l’espace, en proie permanente aux effractions ou ne pas s’éprouver au-delà du repli sur soi et des sensations que les sujets se donnaient à eux-mêmes.
Il y avait vraisemblablement une faillite des enveloppes primitives chez ces personnes.
Engager un travail à partir de la sensorialité constitua alors mon « point de départ. »
Mon temps d’observation m’avait permis de relever que toutes ces personnes, quelle que soit l’origine (connue ou méconnue) de leur état de dépendance psychique, manifestaient des troubles appartenant à la psychopathologie des problématiques psychotiques ou autistiques (je reviendrai sur ces éléments cliniques dans la seconde partie de ce travail).
Les regards étaient souvent évités ou plongeaient dans le mien, le toucher faisait effraction ou au contraire le collage « office de relation ».
Il fallait alors trouver un médium nous permettant d’entrer en relation susceptible de créer un écart nécessaire à la rencontre.
Partir du corps, c’est avant tout situer ce dernier à l’interface du soma et de la pensée, interface qui lui confère, en tant que tel, le statut d’objet privilégié de mes réflexions et de ma clinique.
Comme le souligne B. Golse (1999), de l’autosensualité archaïque à l’investissement objectal :
‘« it’s a long way to go... » (p 120) 3.’
Il s’agit d’un parcours qui chemine par l’auto-érotisme et le narcissisme primaire avec des méandres, des détours, des pauses, parfois des allers et retours qui font bien évidemment toute la spécificité de chaque histoire.
Le corps est aussi le lieu source de notre réflexivité et de notre réflexion, ce que nous indique clairement D. Anzieu.
Se toucher, se voir, se sentir, se goûter, s’écouter sont les préalables indispensables avant de pouvoir se penser pensant, acte réflexif par excellence dont on sait le rôle fondateur pour notre psyché.
Mais aucun psychisme ne peut s’instaurer et s’éprouver comme tel sans se donner d’abord à penser à un autre psychisme (il faut un détour par un autre).
Je me trouvais donc confrontée à des êtres qui semblaient en perpétuelle lutte contre l’angoisse d’un « non-être », angoisse du retour d’expériences d’agonies primitives telles qu’a pu les décrire D. W. Winnicott.
Il fallait donc trouver un médium à partir duquel échafauder un dispositif thérapeutique qui me permettrait de travailler sur les modalités précoces des processus de symbolisation.
La terre (l’argile) m’est vite apparue d’emblée comme une matière susceptible d’être aisément manipulée sans injonction de représentation.
Si je décrirai plus loin les modalités pratiques et cliniques du dispositif mis en place (en cothérapie avec une éducatrice), je peux, dans le cadre de cette introduction avancer que dès les premières séances, ce que la spécificité du médium utilisé permettait de présenter touchait au sens de l’inscription du vécu du corps du sujet dans le monde.
L’argile comme médium présente des ressources projectives infinies.
Associant le volume à la forme, l’activité de modelage met au premier plan les représentations du corps propre, mais elle permet aussi au sujet qui la manipule de se confronter à un objet en trois dimensions.
Plus que la matière elle-même, ce qui nous intéressera est l’action de modeler, par la mise en œuvre de la sensori-motricité qu’elle permet, « l’image motrice » en quelque sorte.
Le modelage fait appel à la sensation, à des perceptions tactiles et kinesthésiques avant la représentation.
Le corps de la production qui se modèle n’est pas indépendant du vécu du corps propre du sujet (G. Pankow, 1969, 1981).
Par l’intermédiaire de la matière et à travers l’acte de modeler, nous allons constater que ce qui venait se figurer en termes de traces ou de formes avait quelque chose à voir avec la réactualisation d’éprouvés corporels archaïques et du lien à l’objet primaire. Ces traces corporelles ont trait à la perception, ainsi qu’à la sensorialité, propres à chacun.
La matière se donnait alors comme support d’émergence et de figuration aux traces de l’originaire (au sens de P. Aulagnier, 1975).
Il me semblait alors nécessaire de pouvoir questionner et mettre en travail ce qui était ainsi repéré sur le plan clinique, de pouvoir trouver un espace en dehors de l’institution pour saisir ce qui se dégageait de la mise en place de ce dispositif. Sentir que ce que je proposais avait un sens et pouvait s’organiser et trouver une cohérence dans une pensée étit indispensable.
D’autre part, j’avais dans un premier temps, mis en travail ces hypothèses dans le cadre d’un DEA de psychopathologie et psychologie clinique à l’université.
L’hypothèse centrale était alors qu’au sein du cadre-dispositif de médiation thérapeutique en groupe par le modelage de la terre, le travail engagé permettait de dégager un espace de disponibilité sensitive. En référence aux travaux de D. Meltzer (1975) sur la dimensionnalité de l’espace psychique (uni, bi, tri et quadridimensionnalité), je proposais que cet espace de disponibilité sensitive (propre à regrouper les sensations), permettait aux patients d’expérimenter une aire de spatialité psychique aux qualités particulières. Ces dernières résidaient dans l’articulation de l’adhésivité propre à l’espace bidimensionnel à la possibilité projective de l’espace tridimensionnel.
Entre identification adhésive et identification projective, l’expérimentation de cet espace (aussi lieu du transfert), permettait au sujet s’y inscrivant un passage de l’autosensorialité à l’auto-érotisme. Etre en mesure de vivre la séparation, puisqu’une enveloppe psychique semblait se constituer, devenait envisageable.
Bien que proposant une mise en travail et une théorisation de ce qui me semblait alors opérant au sein du dispositif, ce travail révélait dans l’après-coup non seulement des failles, mais aussi de très fortes défenses contre-transférentielles à travers un recours aux concepts théoriques tout azimut.
Ceci ne me permettait pas encore de saisir ce qui se déroulait dans l’espace de la rencontre avec les sujets, et surtout je n’avais pas abordé la dimension groupale du dispositif.
A ce stade de mon questionnement, l’objet groupe n’était pas pensable, probablement parce que très angoissant du fait de la lourdeur des troubles des personnes et que j’opposais de très fortes résistances à penser cette question de groupalité psychique interne.
Quelles étaient les interrelations entre l’utilisation faite du médium et l’intersubjectivité à l’œuvre dans le groupe ? Le sujet psychotique déficitaire a-t-il accès à la groupalité interne telle que la définit R. Kaës (1976) ?
Le groupe existait-il réellement avec une dynamique et une vie psychique qui lui étaient propres, ou bien n’était-il que concept théorique, ce qui se déroulait sous mes yeux s’apparentant plus à la coexistence d’individus à l’intérieur d’un cadre donné ?
Par ailleurs, si j’avais questionné ce qui était mis en travail du côté de la sensorialité par le médium, c’était dans le champ des processus de symbolisation primaires, que je tentais tant bien que mal d’articuler aux processus secondaires, qui se révélaient bien étrangers aux mondes psychiques auxquels je me trouvais alors confrontée. Cette manière de penser se révélait frustrante car elle me laissait l’impression de « passer à côté de quelque chose. »
Il me fallait donc « plonger un peu plus profond » avec les mêmes sujets pour questionner ce qui pourrait se présenter (voire se présentifier tant l’acte semblera quasi originaire) comme une figuration et une mise en forme des processus relevant de l’originaire, m’emmenant aux balbutiements de la vie psychique.
Les sujets n’ayant pas accès à la parole, leur vécu s’exprimait et s’inscrivait d’emblée sur le mode de la sensorialité et à travers la sphère corporelle (sensori-motricité).
Quels maux saisir « en deçà des mots », comment mettre en travail ce qui se présentait comme un « déficit » (existentiel, corporel et psychique) pour le patient, à travers le dispositif de modelage en groupe et le lien intersubjectif ?
Notes
3.
GOLSE B. (1999), Du corps à la pensée, Paris, PUF, Le fil rouge.
|
|
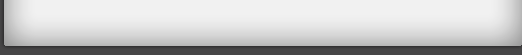 |
|