VI Corps et création
6.1 Le processus créateur :
du surgissement à la création,
le corps de l’œuvre
Nous proposons à présent d’étudier le processus créateur à partir des modélisations théoriques proposées par les psychanalystes qui l’ont étudié.
Afin d’introduire ce processus dans ses rapports à la psyché, nous avons choisi de le traiter ici sous l’angle de la question du déclenchement du processus créateur, de l’implication du corps dans le processus créateur, ainsi qu’à travers une œuvre précise qui sera celle de Camille Claudel.
Notre approche sera donc partielle et non exhaustive (de nombreux auteurs psychanalystes ont proposé une modélisation théorique tant de ce qui déclenche le moment du surgissement créateur que des relations étroites entre l’histoire singulière d’un créateur et de ce qui est cause de son œuvre).
M. Gagnebin (1988)48, fortement inspirée par D. W. Winnicott insiste sur le retour des agonies primitives dont on retrouve les traces dans les œuvres, en particulier dans la peinture. Ses travaux nous permettent d’établir les liens possibles avec les configurations singulières rencontrées chez les patients.
En effet, elle détecte ces agonies et leurs corollaires (les angoisses catastrophiques) chez des peintres contemporains. Sa thèse étant que celles-ci seraient camouflées dans ces œuvres derrière des procédés techniques ayant une fonction pare-excitante. Ces derniers représenteraient alors des procédés rationalisants contre le retour d’un effondrement qui se serait déroulé dans le passé, à une époque très précoce de l’existence.
Ces peintres des agonies primitives sont pour elle en deçà des processus transitionnels.
Si ces thèses ouvrent sur une dimension historique, un aspect de notre travail nous semble en concordance avec elles : il s’agit de cette faculté donnée à un médium à renvoyer sur les registres les plus archaïques, voire de l’utiliser pour exprimer des conflits internes plus douloureux.
Le moment du surgissement créateur est souvent rattaché à un caractère de nécessité, d’urgence. Il est question d’un « quelque chose », d’une matière probablement inscrite avant tout sensoriellement et corporellement, qui doit s’inscrire dans la rencontre avec une matière autre, extérieure mais non moins intime, pour qu’en advienne une matière psychique qui représente, tant pour le créateur que pour un autre, d’autres. Il s’agit pour celui qui crée de transposer une énigme interne en dépassant le contexte particulier de l’expérience personnelle car ce n’est qu’à cette condition qu’il y a création, qu’à cette condition que le créateur trace des routes nouvelles.
Didier Anzieu, a insisté sur un cadre « conteneur », en l’articulant essentiellement au corps de l’artiste que la création vise d’une certaine manière à restaurer.
Nous en proposons une lecture argumentée de propos d’écrivains.
Nombre d’auteurs ont mis en évidence dans la création artistique l’implication du corps en tant que tel. Les traces, mnésis, éprouvés sensori-moteur, souvenirs du corps (M. Ledoux, 1992)49 se retrouvent à l’œuvre dans la création artistique.
Dans un ouvrage remarquable, D. Anzieu50 (1981) décrit les cinq phases du travail de la création, et propose de penser l’articulation entre le corps du créateur et le corps de l’œuvre composé à partir de la projection des sensations corporelles de l’auteur et construite comme corps métaphorique.
La première phase, correspondant au moment du saisissement créateur est déclenchée par une crise (un deuil, une maladie, une liberté reçue ou conquise qui élargit le champ des possibles, une rencontre, etc.).
Grâce à cette crise, l’auteur connaît une première phase régressive que D. Anzieu rapproche du fonctionnement archaïque du tout-petit. Ce tout-petit en proie à l’abandon est saisi d’une sensation de froid soudain. Pour faire face à ce saisissement glacé, qui pourrait le faire basculer dans l’angoisse, la mort ou la folie, il se replie en lui, D. Anzieu désignant cela comme un repli narcissique indispensable.
On comprend alors que c’est dans l’espace de la séparation et du manque que se loge une partie de la création. Une séparation entre ce qui est Moi et ce qui est non-Moi, qui oblige à se replier sur soi et à donner forme à ce qui n’a pas encore été créé.
Le créateur crée à partir de ses propres manques, rendant poreuses les frontières entre le dedans et le dehors.
Cette première phase du saisissement créateur est donc une phase de lâcher prise qui permet à un matériel psychique alors enfoui de refaire surface, de « faire trace. »
Pendant cette crise, le créateur ne sait pas encore ce qu’il va créer. Il ne fait qu’enregistrer le contenu qui arrive à lui, sans avoir nécessairement cherché à le provoquer. La crise peut aussi survenir comme l’aboutissement d’un intense travail préparatoire, que D. Anzieu nomme incubation.
Ainsi le saisissement créateur se manifeste-t-il de différentes façons.
Il peut s’agir d’une crise, d’une secousse ou d’un choc.
On peut citer à ce propos Virginia Woolf, qui écrit :
‘« Je persiste à croire que l’aptitude à recevoir des chocs est ce qui fait de moi un écrivain. »’
Il peut aussi se manifester sous la forme d’un déplacement, d’un décalage.
Jean Genet raconte son entrée en écriture à partir d’une carte postale, dans son ouvrage L’ennemi déclaré.
Il était alors en prison, seul, et décide d’écrire une carte postale à une amie pour Noël, et :
‘« Je l’avais achetée dans la prison et le dos de la carte, la partie réservée à la correspondance, était grenue. Et ce grain m’avait beaucoup touché. Et au lieu de parler de la fête de Noël, j’ai parlé du grenu de la carte postale, et de la neige que ça évoquait. J’ai commencé à écrire à partir de là. Je crois que c’est le déclic...enregistrable.51 »’
Le décalage, le déplacement de quelque chose de corporel, matière sensorielle enfouie, vient se lier à l’auteur réagissant alors à cette sorte de « dérangement ressenti », d’une manière de se tenir au plus près de ce qui paraît aller à l’encontre de ce qu’il sait ou connaît déjà, sans le savoir.
L’entrée dans le processus créateur peut aussi passer par ce que l’on appelle un état passager de dépersonnalisation, rencontre avec le double, « je est un autre », docteur Jeckyl et Mister Hyde...
Nous pouvons ici citer un auteur comme Fernando Pessoa et ses hétéronymes, pour qui l’écriture est le lieu qui lui permet de faire entendre ses multiples voix. Pessoa se laisse aller à l’éclatement interne sans jamais perdre son intégrité psychique.
Pessoa a confié qu’enfant, il s’inventait des personnages qui pour lui n’étaient pas vraiment de l’ordre de l’imaginaire mais avaient une existence dans la vie réelle. Avec l’écriture, il retrouve ses personnages projetés et fait exister ce qui n’a pu exister.
Ce qui serait spécifique au créateur serait alors sa façon de tolérer l’angoisse face à ce moment de crise qui serait en quelques sortes de nature psychotique mais pas dans le sens du pathos.
Si la frontière est fragile, D. Anzieu souligne que le créateur a la capacité de préserver pendant la phase de régression un dédoublement vigilant et la capacité de s’auto-observer, de se placer dans un certain écart par rapport à soi, une distance « suffisamment bonne » sans laquelle ne peut advenir cette création.
Concernant cette première phase, le saisissement créateur peut encore se présenter selon D. Anzieu sous la forme d’une régression affective. Un affect puissant est revécu et fait remonter tout un tas d’éléments qui vont servir le processus créateur. Il n’y a pas de meilleur exemple pour illustrer cette secousse que celui de la madeleine de Proust.
Pendant cette première phase du saisissement créateur, l’auteur est dans un état d’immobilité. C’est comme s’il mettait toute action en suspens pour pouvoir laisser libre cours à ce qui doit advenir de son imagination.
Ce travail dans la solitude représente une confrontation avec soi-même pour le créateur. C’est cette confrontation qui permettrait de reconnaître l’autre en soi.
Semprun écrit :
‘« L’écriture, si elle prétend être autre chose qu’un jeu ou qu’un enjeu, n’est qu’un long, qu’un interminable travail d’ascèse, une façon de se déprendre de soi en prenant sur soi : en devenant soi-même parce qu’on aura reconnu, mis au monde l’autre qu’on est toujours.» ’
Ce moment de solitude est nécessaire à la création, mais c’est une solitude habitée par la pensée et les idées, « une solitude habitée par une relation constante avec le public interne » (M. de M’Uzan, 1977).
Dans cette plongée au fond de lui-même pour y retrouver ce qui n’a pas eu lieu, il y a aussi l’idée pour celui qui crée qu’il va peut-être rencontrer quelque chose qui serait commun à tous les êtres humains. A ce moment là, la création devient une façon de partager une intimité universelle.
A ce propos Charles Juliet souligne :
‘« Ecrire pour être moins seul. Pour parler à mon semblable. Pour chercher les mots susceptibles de le rejoindre en sa part la plus intime. Des mots qui auront peut-être la chance de le révéler à lui-même, de l’aider à se connaître et à cheminer.»’
Il faut maintenant au créateur sortir de cet état d’immobilité pendant lequel il se laisse aller à tout ce qui vient à lui et c’est là la deuxième étape du processus créateur selon D. Anzieu.
D’abord le créateur est saisi, puis ensuite « ça vibre »...
Le créateur va ici tenter de saisir une image mentale ou un affect par une voie qui peut être qualifiée d’hallucinatoire. Le créateur rentre alors dans un état d’illusion, une sorte de phase d’exaltation euphorique.
A ce moment du processus créateur, celui qui crée est totalement impliqué dans son expérience, physiquement et corporellement.
Pour illustrer cette idée, certains créateurs dont H. Michaux décrivent ce moment mieux que la théorie. C’est assez douloureux, mais dans le poème « Magie », il explique comment il entre...dans une pomme ! Il s’agit d’une belle métaphore du saisissement créateur, mais Michaux parle aussi du froid qui l’accompagne et du repli narcissique qu’il induit :
‘« J’étais autrefois bien nerveux. Me voici sur une nouvelle voie :
Je mets une pomme sur ma table. Puis je me mets dans cette pomme. Quelle tranquillité !
Ca a l’air simple. Pourtant il y a vingt ans que j’essayais [...].
J’en viens à la pomme. Là encore il y eut des tâtonnements, des expériences : c’est toute une histoire. Partir est peu commode et de même l’expliquer. Mais en un mot je puis vous le dire. Souffrir est le mot. Quand j’arrivai dans la pomme, j’étais glacé. 52 »’
Dans cette seconde phase et avec le passage de la passivité à l’activité, tout ce qui est autour du créateur semble se mettre en résonance avec sa création et entre en vibration.
Dans son ouvrage Ecrire, M. Duras témoigne de cette symbiose entre l’environnement et le texte en cours de création :
‘« Tout écrivait quand j’écrivais dans la maison. L’écriture était partout. Et quand je voyais des amis, parfois je les reconnaissais mal...Ca rend sauvage l’écriture. Ca va très loin l’écriture...jusqu’à en finir avec. C’est quelquefois intenable. Tout prend un sens tout à coup par rapport à l’écrit, c’est à devenir fou. Les gens qu’on connaît, on ne les connaît plus et ceux qu’on ne connaît pas on croit les avoir attendus.
[...] Ecrire, ça ne sauve de rien. Ca apprend à écrire, c’est tout. 53 »’
La seconde phase du travail de création est la prise de conscience des éléments inconscients. Le créateur a rapporté de l’état de saisissement créateur un matériel inconscient, réprimé ou refoulé, ou même encore jamais mobilisé, sur lequel la pensée, le conscient, vont reprendre leurs droits.
D. Anzieu dit que c’est comme si créer, c’était « lever soi-même un refoulement. »
L’œuvre va alors se structurer à partir d’évènements qui ont marqué l’inconscient. Dans cette phase, le créateur est supposé entretenir un « rapport de liberté avec l’inconscient », selon la formule que rapporte H. Bauchau. Il ne s’agit pas que la trappe se referme...
A cette étape, il faut que le Moi conscient du créateur, qui avait été mis de côté pour que le saisissement créateur puisse avoir lieu et qui s’est dédoublé, ramène les éléments de la période de saisissement et les fixe.
Rimbaud, dans Une saison en enfer écrit :
‘« Je fixe mes délires. 54 »’
Dans cette phase, il s’agit donc d’arrêter l’errance interne, de ressaisir et de fixer ce que le créateur affronte et qui est « remonté. »
C. Tarkos, poète contemporain, a une formule qui à ce propos sonne très juste, il dit que :
‘« Le poète est celui qui sait arrêter le poème, au contraire du fou. 55 »’
En fixant, le créateur fait taire ce qui le harcèle. R. Roussillon (2002) écrit à ce propos qu’il s’agit là de pouvoir :
‘« […] oublier et faire cesser le harcèlement interne qu’exerce sur le moi ce qu’il n’a pas intégré. 56» ’
Cette seconde phase du saisissement créateur, c’est aussi la phase du risque de l’échec, si l’inconnu échappe, il faut tout recommencer.
Donc au départ du processus créateur, il y a une vocation, une nécessité, mais aussi un risque. Françoise Sagan qui affectionnait ce risque disait que la raison pour laquelle elle écrit, c’est pour connaître la suite.
Cette phase pendant laquelle le créateur fixe une idée ou une intention est souvent accompagnée de sentiments de honte ou de culpabilité et gênée par le poids de la connaissance et des acquis.
Dans cette phase, contrairement à la première qui requière un état de solitude, le créateur supporte alors mal cette solitude. On pourrait même dire qu’à ce stade de la création, la solitude serait néfaste, car sont en jeux des mouvements actifs d’autodestruction, à travers le doute notamment.
Après avoir laissé remonter et fixé, le créateur doit alors composer. Il s’agit là de la troisième phase du processus créateur.
A ce stade là, l’incréé, le formlesness de Winnicott, ce quelque chose qui avait été écarté a été saisi et se transforme en œuvre d’art. C’est la phase de composition de l’œuvre. Anzieu parle alors d’instituer un code et de lui faire prendre corps.
Il est ici question de la forme. Contrairement au quelque chose de subjectif, à l’énigme interne, la forme ne préexiste pas à la production de l’œuvre (c’est aussi ce que souligne H. Maldiney). Dans cette phase il s’agit de déguiser l’expérience source pour qu’elle devienne art. Ainsi créer, c’est aussi et surtout transformer l’expérience première en la sortant de son contexte particulier. Dans cette phase il s’agit pratiquement d’effacer la source première, inventer pour le créateur un langage qui n’a jamais existé. Il y aurait quelque chose de l’ordre du démiurge dans cette phase, le créateur pouvant se prendre pour Dieu...
Cette troisième phase est surtout faite d’un compromis avec le réel. Il faut au créateur se soumettre aux contraintes de sa création. C’est une phase pendant laquelle l’auteur va transformer les éléments inconscients en noyau central, pour décoder la réalité. Le corps de l’œuvre devient aussi bien celui du créateur (nous retrouverions là le rapport spéculaire propre à l’originaire décrit par Aulagnier).
Même si l’un des enjeux de la création est celui d’une libération, la création n’est pas libre puisqu’elle doit se soumettre aux contraintes de l’expérience subjective qu’elle fait ressurgir.
Cette phase, qui montre qu’il faut inventer quelque chose qui n’a jamais existé, permet de mieux comprendre la différence entre création et créativité.
La créativité s’appuie sur des choses connues, utilise un code familier, touche l’anecdotique, le périphérique, l’aléatoire, le désordre, le non-relié, la créativité est le simple talent en quelques sortes.
La création propose quant à elle quelque chose de radicalement nouveau, en amont, devant le réel. Dans la création l’incréé est central, essentiel, constitue le nécessaire. Créer est structurant et source d’ordre pour le créateur.
Pour terminer cette phase de composition, l’œuvre prendra peut-être différentes formes mais les images, les sensations ou les affects rencontrés pendant le saisissement créateur suivent en général le créateur dans toute son œuvre.
La production de l’œuvre n’épuise pas sa source.
La quatrième phase est celle du corps à corps avec le matériau, c’est le travail du style. Il ne faut pas oublier l’inconscient pour autant, la trappe est encore ouverte, mais c’est une phase de mouvement, une phase de « rédaction », l’œuvre se déploie.
Dans cette phase il s’agit d’établir des liens entre le matériel issu de l’inconscient, mis en forme dans la phase précédente et les formes, couleurs, mots, langage.
Le matériau de la création c’est le langage analogique qui ne nomme pas et donc existe, fait exister. Dans cette phase le créateur trouve son style, trouve une langue dans laquelle l’incréé va pouvoir s’actualiser. Céline disait dans une interview que :
‘« Etre écrivain, c’est mettre sa peau sur la table. »’
Dans cette phase l’œuvre prend alors une forme concrète, dans un rythme propre au créateur.
Elle peut comprendre des moments de va et vient, des temps d’aller et retour, la fulgurance restant assez rare.
La cinquième et dernière phase consiste pour le créateur à détacher l’œuvre de lui, surmonter la honte et l’inhibition. La résistance inconsciente revient à la charge dans cette dernière phase. Il s’agit de faire partager un état subjectif, avec le risque de ne pas être compris. Il s’agit pour le créateur de détacher définitivement l’œuvre de lui, de se détacher d’elle, d’affronter les jugements et les critiques, d’accepter que l’œuvre n’ait peut-être qu’une survie éphémère...
L’œuvre produira un certain nombre d’effets sur le spectateur ou le lecteur : stimulation de la fantaisie consciente, déclenchement de rêves nocturnes, accélération d’un travail de deuil ou de symbolisation, voire enclenchement d’un travail de création...
Il faut laisser ce qui échappe au créateur s’échapper, accepter que l’œuvre contienne une part inachevée, et faire du spectateur le dépositaire de ce que l’œuvre et son créateur n’ont pas pu exprimer...
Dans cette dernière phase, c’est alors au spectateur, au lecteur, de prendre en charge et à son compte l’incréé, à partir de son corps et de sa propre psyché.
Notes
48.
GAGNEBIN M. (1987), Les ensevelis vivants. Des mécanismes psychiques de la création, Seyssel, Champ Vallon, 202 p., L’or d’Atalante
49.
LEDOUX M., (1992), Corps et création, Paris, Les belles lettres, 216 p., Confluents psychanalytiques
50.
ANZIEU D. (1981), Le corps de l’œuvre, Paris, Gallimard, 377 p., Bibliothèque de l’inconscient.
51.
GENET J. (1991), L’ennemi déclaré, Paris, Gallimard, NRF.
52.
MICHAUX H. (1963), Plume précédé de Lointain intérieur, Paris, Gallimard.
53.
DURAS M. (1993), Ecrire, Saint-Amand, Gallimard, 123 p.
54.
RIMBAUD A. (1873), Une saison en enfer, in Oeuvres complètes, Bibliothèque de la pléiade, 2009.
55.
TARKOS C. (2008), Ecrits poétiques, POL, 432 p.
56.
ROUSSILLON R. (2002) Le transitionnel et l’indéterminé, in CHOUVIER B. et al., Symbolisation et processus de création, Paris, Dunod, 286 p., p. 61-76
6.2 La chair sublimée
Le peintre Paul Cézanne écrivait :
‘« Je continue à chercher l’expression de ces sensations confuses que nous apportons en naissant.
Je veux peindre la virginité du monde. »’
Quelles sont les conditions d’émergence de la créativité qui permettent à un sujet de s’inscrire comme créateur ?
Quels sont les indices dans le travail d’un artiste qui renseignent la psychanalyse sur ce qui fait la rencontre d’un sujet avec les formes et les couleurs de son être ?
La production d’un objet est une tentative de formalisation. Formalisation de quoi ? Et que se transmet-il dans toute création ?
Il s’agit de la transmission d’un impossible à dire, d’un indicible, invisible qui réclame pourtant un besoin de mise en forme à travers un langage plastique (images, sons, couleurs, mots) pour s’évoquer.
Il est question d’un acte : acte de création.
C’est par ce biais de l’acte que nous proposons la question de savoir qui crée, quel est l’opérateur, qu’est-ce qui cause une œuvre. Nous nous référons à la théorie de la sublimation telle que l’a reprise J. Lacan57.
On peut désigner le lieu de toute création comme étant le sujet de l’inconscient, pure énonciation, et son outil : la fonction signifiante. Ce qui dit ce qu’est le sujet, c’est l’énigme, le hors signifié, l’expulsé du sens.
Ce qui est cause de toute création, c’est le transfert comme « émergence du désir comme tel » : désir de l’Autre dans la cure analytique, désir à l’Autre dans la création artistique pourrait-on dire. L’émergence du désir comme tel est ce qui motive toute création, c’est le désir, soit le manque à être.
Ce sujet du désir pense dans la logique du manque, qui est la logique du signifiant et non la logique du sens, pense dans ce renvoi à l’être qui ne peut se voir ni se saisir mais seulement s’évoquer.
Mais pour que la problématique du désir surgisse, il faut qu’il y ait destruction dans un premier temps, la destruction venant mettre en cause tout ce qui existe mais étant aussi volonté de création, de recommencement.
Si l’on peut dire qu’un rêve image le symbole en mettant le discours symbolique sous une forme figurative, le symbolique quant à lui indexe le réel, l’indicible et l’invisible. On serait là du côté du travail de tout créateur, ou de ce qui travaille tout créateur.
La jouissance d’un objet même réussi est toujours structuralement ratée. C’est ce qui permet à tout créateur de ne jamais cesser de créer.
Ce qui établit la connexion entre notre corps et ce qui l’entoure n’est pas de l’ordre des mots mais appartient aux registres sensori-affectivo-moteur et perceptif : c’est là que se perçoit, se rencontre ce vide, ce manque à être avant qu’il n’y ait aucun mot à la portée du sujet pour l’exprimer.
Cette perception du sujet c’est-à-dire de l’insaisissable réside en chacun de nos gestes, perceptions, au niveau inconscient, elle se traduit par des mouvements divers, des productions diverses pour assurer cette unité que nous cherchons et n’atteignons jamais. Le discours a alors pour fonction de nous protéger de cette perception intime de l’absence d’unité en soi.
L’acte est le répondant de ce hors sens qui nous constitue. Mais l’acte suppose un « lâcher prise », il n’y a pas d’acte sans perte. L’acte fait coupure : après ce n’est plus comme avant, nous n’avons plus tout à fait la même vision du monde. Ce qui a fait acte réduit au silence et échappe au discours. On peut considérer que l’acte est mouvement, au sens d’un transfert. Le transfert est le lieu de l’acte : mise en acte de la réalité de l’inconscient, de l’existence de ce sujet toujours entrevu comme surprise. La touche du peintre est quelque chose où se termine un mouvement. L’œuvre d’art est objet, signe, coupure, signe de l’acte et de la perte.
Il n’y a pas d’unité possible pour le sujet, c’est le renoncement à faire Un qui va ouvrir la voie du mouvement, de la quête, de la créativité. L’artiste propose une solution esthétique, il symbolise par l’image ou la forme, son fantasme, c’est-à-dire sa représentation du monde, qui est la forme sur laquelle s’appuie son désir. L’inconscient ne jaillit pas en direct sur une toile, un artiste travaille sur la limite et à la limite de la représentation. Il s’agit pour lui de repousser les limites de la représentation.
L’accès au désir est central pour l’accès à la créativité. Tous les chemins sont possibles du moment que le sujet accepte le change d’objet, ce qui définit la sublimation.
A propos des quatorze toiles d’Aki Kuroda intitulées « Les ténèbres », Marguerite Duras écrit ceci :
‘« On dirait que pendant cette minute de peinture Aki Kuroda écrit la phrase décisive qui lui permettra de laisser là la peinture à d’autres qu’à lui. Le silence est aussi fait par Kuroda sur l’intelligence de la peinture même. Il dit qu’il y a là à comprendre mais sans jamais savoir quoi, qu’il y a là à dire mais sans jamais savoir comment. La tentative que je fais en ce moment, je la vois comme relevant du silence établi par Kuroda. Kuroda est en avance sur le silence…58»’
En écoutant le discours de certains artistes au sujet de leur création, il apparaît que les sens et la matière partagent une relation d’intimité, on pourrait dire d’intimité originelle.
Notre travail de recherche s’organisant autour de la sensorialité et de ce qui s’adresse au corps, à la corporéité naissante, il nous a semblé pertinent d’aborder la question du travail des sens dans la création.
Nous proposons d’introduire notre propos à partir de la peinture, puis en viendrons à aborder plus spécifiquement la sculpture et le travail d’un artiste en particulier, Camille Claudel.
C’est la matière même de la peinture, qui par le corps du peintre touche nos sens.
Dans ce travail, il y a transmutation de l’excès de la chair en exaltation cérébrale. Bacon admet que :
‘« Peindre, c’est tenter de rendre la sensation.59 »’
La peinture incarne (« in-carne »), à un point tel que le peintre américain De Kooning a pu dire que la chair est la raison pour laquelle fut inventée la peinture à l’huile.
Pratiquement toutes les représentations, y compris celles abstraites, témoignent de l’intrusion en quelques lieux de la toile, de la marque d’un acte que l’on peut qualifier de charnel, qui serait « symptomatique » de la peinture.
Il y a dans la toile la trace de la manifestation corporelle. Sous le motif, la pulsion échappe au corps gestuel conforme pour surgir dans une déformation.
C’est dire que la peinture est un acte qui ne tient pas à l’identification de ses éléments, car la forme est dominée par la matière. La tâche de la peinture est de s’astreindre à rendre visibles des forces qui ne le sont pas et qui sont en rapport avec des sensations.
Aussi s’aménagent des intensités qui captent notre regard, jusqu’en notre intérieur.
Rencontres de forces, de sensations, d’intensités, d’inconscients.
C’est l’insolite de la toile qui, dans son premier temps d’exposition, inscrit un élan charnel. Se défait ce que l’on imagine d’une cohérence. Ca ne ressemble pas, ou plus, rien n’est plus pareil à l’ordonnance des codifications.
Sans cet arrimage inconscient, sans l’enjeu des sens, nul ne saurait rendre la sensation. La peinture travaille le paradoxe de nous le faire savoir à partir de l’indistinct initial.
Deleuze dit que la peinture est le langage analogique par excellence, car la ressemblance sensible y est produite non pas symboliquement (par code), mais sensuellement.
La peinture tire sa source des sens et sa réalisation produit des sensations dans une logique ordonnée notamment par la couleur.
La peinture partirait donc du corps du peintre à celui du corps de sa réalisation pour transiter jusqu’au corps de celui qui regardera.
Corps pensants, corps pensés, corps en pensée.
Nous retrouvons ainsi la marque de l’originaire, transmuée par la prématuration humaine qui portera l’être à inaugurer du sens, du fait de son impuissance première. De ce fait la chair se fait sensible et tire la sensation vers le sens.
Ce trajet, jamais épuisé, est inscrit en filigrane dans la matière première picturale détournée de son office (de la toile, de l’huile…) pour rendre compte d’un trajet « acharné » à la transformation.
Ne peut-on dire que dans la peinture la chair sensibilisée s’adresse en différents temps et différents lieux sous différents aspects ?
Du corporel s’éprouve si l’on veut bien entrer dans le tableau. Mais alors surgit l’informe car la matière règne, bouleversant les limites de la pensée habituellement acquise. Nos yeux enregistrent des faits qui défont l’évidence habituelle répertoriée par le regard. Notre corps, nos sens reçoivent une charge qui dénivelle l’ordonnance plus tempérée de nos présences courantes. Il y a en peu d’espace une accumulation sensible et elle ne dépend pas du sujet traité, mais bien plutôt du traitement de l’objet, de la croyance qui l’a fondé, des sens qui l’originent, qui l’affectent.
Si quelque chose nous émeut à nous en approcher, à pénétrer la toile, c’est que nous y trouvons les mouvements, la corporéité désirante d’un autre, du peintre. Jusqu’aux limites que le peintre s’est imposées, son geste le trahit, l’avancée de l’auteur est là, exposée dans sa retenue même.
Le rendu de la sensation est ce qui subsiste du mouvement du peintre. Cette translation nous informe, à travers une texture, qu’un sujet en mouvement a voulu transmettre. Ce mouvement dit bien qu’il s’agit d’aller vers l’autre, mais pas dans une pulsion ingouvernée et tiraillante, car si le peintre est parti des sens, il tire vers le sens. C’est ainsi qu’il nous adresse son corps pensant, troublant, d’une intelligence inscrite par une main éloquente.
Pourtant le verbe n’est pas là en son énonciation courante et c’est d’ailleurs de qui fait cette éloquence propre à l’art, cette éloquence quasi « silencieuse. »
Dubuffet écrit :
‘« C’est le peuplement des intervalles (par les projections mentales qu’il suscitent) à quoi je porte le plus constamment mon effort. Figurer le rien, figurer du moins ce qui n’a pas de nom, l’indéterminé, m’apparaît la tâche essentielle du peintre. 60 »’
Les artistes semblent nous dire que cette aire de l’informe permet l’agencement de l’inaccessible, qui n’est pas le signe du chaos, mais le mouvement d’un trait qui vient à signer l’espacement propre à chacun à partir de l’insensé. C’est de là, de l’entre-deux, que s’adresse l’artiste.
S’approchant des sensations premières, la peinture en vient à tenter de transmettre quelque chose de l’origine de la vie. Peut-être alors que ce que l’on nomme l’adresse du peintre tient plus à l’évocation de ce lieu qu’à une technique affûtée.
Il nous adresse l’ordre de sa pensée, au tamis des sens, mais également le désordre d’un dérangement occasionnée, justement par l’origine de son œuvre, à notre savoir habituel.
S’approchant des corps peints par Bacon, Deleuze dans le chapitre « Le corps, la viande et l’esprit, le devenir animal »61, écrit que la viande est la zone commune de l’homme et de la bête, leur zone d’indiscernabilité, elle est de ce « fait » cet état même où le peintre s’identifie aux objets de son horreur ou de sa compassion. Il cite d’ailleurs Bacon qui dit :
‘« C’est sûr nous sommes de la viande, nous sommes des carcasses en puissance. Si je vais chez un boucher, je trouve toujours surprenant de ne pas être là, à la place de l’animal… ».’
Cette « viande intime », masse de chair ambulante jusqu’à la chair putréfiée de la mort est présente en nos actes. Comment tenir et de l’animal et de l’esprit, comment l’esprit tient-il l’animal en nous tapi ?
Le problème n’est pas nouveau, son expression se renouvelle pourtant en chacun. Impossible à localiser entre vivre et mourir, organe de plaisir et de torture, la chair humaine appelle, dit Deleuze, « la pitié » expressive en l’œuvre de l’artiste.
La forme peut parfois être défendue comme moyen de survie psychique dans des conditions extrêmes (le peintre Zoran Music et son vécu des camps de concentration par exemple). Nombreux sont les créateurs qui ont écrit, dessiné dans des conditions de détention ou des situations de privation de liberté.
Alors si le sens de la vie c’est vivre ou mourir pour une forme, comment donner forme à l’informé, à ce qui se fait et se défait constamment ?
Il s’agit de tailler dans la multitude, dans le trop-plein d’excitation, de fragmenter l’arrière-fond de la vision pour en détacher un morceau pour soi. Pour trouver une image, il faut trouer le monde des images déjà là.
Lorsque Bacon présente dans ses peintures les corps et les visages exaltés d’ondes dénivelantes, remplissant nos yeux puis nos nerfs de forces intenses et submergeantes, il touche par l’intérieur même de l’être, l’être toile en face de nous. Sur ses toiles, il n’y a pas encore, ou plus du tout de corps structurés de face ou dessinés. Une géométrie, une topologie nouvelle s’insurgent pour éveiller la pensée hors de l’architecture éternelle de la vision de l’autre, de l’autre en soi. Ces représentations touchent jusqu’à notre propre motricité dans une retrouvaille de l’élémentaire, de l’ambigu premier quand la pulsion gagnait l’ensemble de l’être en le muant. C’était avant qu’il ne croise dans le miroir son image pour se représenter une stabilité de ce reflet vu dehors, et d’un coup identifié à celle de l’autre humain qui le côtoie. L’élémentaire apparaît donc quand l’organique règne sans organisation et que pourtant la sensation nous détermine.
Il est intéressant de parler de Bacon à propos du miroir car il peut nous faire ressentir l’altération et le désinvestissement possible de ce que nous croyons tenir par l’image du miroir. L’inconsistante des personnages dont la substance se délite nous rend la douleur primordiale de l’être au-delà des vicissitudes des histoires, des parcours.
Bacon montre que la peinture n’est pas miroir mais décomposition originelle et qu’elle ne répare rien de l’insoutenable fragmentation du tout imaginaire. L’effroi est partageable, car les toiles alors nous effractent et nous affectent, au-delà du masque quotidiennement endossé. La meurtrissure tenue en ces quelques signes, en ces couleurs décisives, s’avise d’établir un pont avec la nôtre, en deçà des mots, dans le choc en retour, innommable mais communicable pourtant.
Partir de l’informe pour que du beau advienne et se partage n’est pas donné. Cela se paie d’une perte d’illusion, mais s’y gagne de la signifiance, puisque le fond de la chose prend alors forme. Ce déplacement n’est pas sans effets, laissant des traces pour l’auteur alors divisé par son acte créatif. Cette rigueur initierait le travail de la pensée. Elle naît d’une régulation du surgissement initial. Travail régulant qui fait passer les sens, l’émotion, la pulsion vers une trace non pas désorganisée mais rigoureuse, retenue. Il n’est plus question d’immédiateté ni d’exhibition.
Il faut franchir un espace, s’affranchir de ce qui alourdi. Il ne s’agit pas pour le peintre de se débarrasser d’un trop-plein, mais bel et bien de créer un creux.
Le travail du peintre consiste, tout en ajoutant jour après jour sur la toile, à biffer, à recouvrir, par destructions successives ce qui fut déjà élaboré. Il faut sacrifier, perdre, regretter parfois un temps de l’œuvre recouvert et pour toujours disparu, enseveli.
Par ces mouvements se marque un écart, plusieurs possibles s’inscrivent. Ici affleurent, dans leur contradiction, leurre de l’avoir et désir de perdre. Il y a « allégement » par cette perte consentie de la présentation vers la représentation.
S’est inscrit dans ce labeur un changement d’état. Il est vrai que la sublimation est un certain type de mutation chimique rapide, de l’état solide à l’état gazeux.
Alors, ne pourrait-on dire que le terme « sublime » pourrait s’appliquer à ce processus d’arrachement perpétuel à soi ?
Freud a décrit comme activités de sublimation principalement l’activité artistique et l’investigation intellectuelle.
La pulsion est dite sublimée dans la mesure où :
‘« Elle est dérivée vers un but non sexuel et où elle vise des objets socialement valorisés. 62 »’
L’allégement est celui de la chair qui s’amenuise et devient manquante dans son épaisseur, sa densité habituelle, ses besoins élémentaires. Extraite de l’animalité, la forme inventée s’éthère, en devient épurée. Couleurs et lignes visent à l’essentiel, se sont affranchies de leur origine pulsionnelle.
Reste la force inscrite, la poussée endiguée, la chair travaillée, le travail acharné. On n’entend pas le peintre dire qu’il veut faire quelque chose de beau par son travail. Le désir est autre et si la beauté advient, c’est par surcroît. Le travail pour le peintre est de s’affranchir d’un non-advenu, un non-exprimé, parfois d’un non-dit, d’arracher à l’innommable quelques parcelles, de se défaire d’une masse l’alourdissant, à l’origine primitive.
Il y a une élévation par l’acceptation d’une perte. Moins de jouissance, une création : c’est une voie parmi d’autres de sublimation. Ce travail de l’artiste nous fait connaître, une fois encore, qu’il peut y avoir transmission de l’humanisation. Perte de chair, de sa proximité, de la jouissance ancienne, perte voulue, alors et seulement, acquise.
François Rouan parle d’inscrire la trace :
‘« […] des effets de vérité... Le tableau signe le passage du bordel de notre corps à l’organisation de la jouissance terrible de la pensée. 63 »’
Ces traces viennent de loin, d’une descente ancienne, elles s’animent en forme liée à une question, nous venons de le voir, intime, originaire.
La beauté naîtrait de l’élévation, non sans avoir su et vu en face l’enfer, la viande, la mort, sous condition que se reflète l’intimité terrible, mais pensée ou pansée alors, du peintre.
Il faut qu’il y ait le « pensement » du peintre sur la blessure narcissique ancienne, car comme l’affirmait Michaux :
‘« Qui laisse un trace, laisse une plaie. 64 »’
Bernard Chouvier65 nous dit que le rapport au soi et à son intimité au cours de l’acte créateur produit insensiblement une position paradoxale. En s’appuyant sur la démarche exclusive de quelques créateurs pour qui « créer et vivre sont devenus consubstantiels », il met en évidence que pour le créateur, se confronter en tant que sujet à l’expression de soi, c’est donner prise à ce qui, en soi, est de l’ordre de l’altérité. Il souligne :
‘« Peut-être n’y a-t-il de travail psychique dans la création qu’au travers des opérations de transformation du noyau primaire d’étrangeté qui habite le sujet. » (p. 8 )’
La question se pose, enfin, du statut de l’économie créatrice. N’est-il pas opportun de proposer un retournement épistémologique de la fonction énergétisante de la libido dans les symbolisations ici à l’œuvre ?
On pourrait dès lors, comme le fait René Roussillon, distinguer deux grands types de processus créateurs. Les premiers, opérant directement à partir du trauma, déterminent l’engagement dans la création comme une nécessité interne qui relève de la compulsion de répétition. Les seconds, au contraire, inscrivent la production de l’œuvre dans le prolongement direct de l’activation fantasmatique interne. Dans un cas, la rupture entre la matérialité de l’œuvre et la substance psychique impose le recours à l’éternel recommencement, alors que dans l’autre, la fluence créatrice est telle que l’œuvre devient programmatrice de l’élaboration psychique elle-même dans une continuité de sens entre le dehors et le dedans.
‘« Un tel repositionnement de la problématique symbolisante ne va pas sans réactiver la question d’une hiérarchie implicite des activités créatrices, ainsi que celle de l’existence d’une structuration psychique spécifiquement repérable chez les créateurs. »’
Ce dernier questionnement constitue la transition qui nous permet maintenant d’aborder plus spécifiquement la sculpture, ainsi que l’œuvre de Camille Claudel.
Notes
57.
Lacan J., Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1973.
58.
Article de Marguerite Duras, (1980), Les ténèbres d’Aki Kuroda, p 7, 8 et 9 du catalogue de l’exposition Kuroda à Tarascon, Maeght Editeur, Paris, 1992.
59.
Deleuze G. (1984), Francis Bacon. Logique de la sensation, Editions de la Différence, Entretien avec Bacon, p. 85.
60.
Dubuffet J. (1986), Bâton rompus, Paris, Les éditions de minuit.
61.
Op. cit.
62.
Laplanche et Pontalis (1967), Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF.
63.
Rouan F. (1991), Interview, in Cahiers de l’Abbaye de Sainte Croix, n°69, Musée des Sables d’Olonne.
64.
MICHAUX, H. (1981) Affrontements, Paris, Gallimard.
65.
CHOUVIER B. (1998) Introduction : sens de l’intime te travail de l’universel, in CHOUVIER B. et al., Symbolisation et processus de création, Paris, Dunod, p. 1-7.
6.3 L’art de la sculpture à partir de l’œuvre de Camille Claudel
6.3.1 Introduction
Camille Claudel (1864-1943) est incontestablement l’un des plus grands artistes de la fin du XIXième siècle. Aborder la création en nous imprégnant de cette artiste et de ses œuvres en regard d’éléments biographiques, nous permet de traiter la question des processus de symbolisation sous un angle différent de celui dont nous avions fait le choix avec les patients présentés dans le dispositif (bien qu’il n’y fût pas question de création mais plutôt de reconstruction, à partir de ce qui se déroulait dans le moment présent de « l’être ensemble »), et donc à partir d’éléments historiques.
Cette brève étude (il ne s’agit pas d’une nouvelle biographie, ni d’écrire « une thèse dans la thèse ») nous éclairera aussi sur les rapports entre les processus de création et la réactualisation, l’inscription d’éprouvés archaïques ayant trait au corps et à la relation à l’objet primaire dans le travail de la matière.
Elle nous permettra également de revenir sur les processus psychiques impliqués dans l’art de la sculpture en particulier, dont certains ne sont pas sans rappeler les actes symboliques décrits dans notre recherche.
Cliniquement, nous nous interrogerons, toujours à partir des éléments biographiques, afin d’élaborer des hypothèses quant à l’éclosion de la psychose chez Camille Claudel, mais aussi sur la nature de cette dernière. En effet, Camille Claudel était atteinte de paranoïa, avec les mécanismes de défense qui lui sont propres (le délire dit « en secteur » en particulier).
Qu’est ce qui a fait qu’à un moment de son histoire, les mains de Camille n’ont plus pu faire jaillir cette force incarnée, acharnée, du désir mû dans la matière ?
Un sentiment de grande proximité avec l’artiste se dégage de la contemplation de ses œuvres, comme si elle avait eu le pouvoir de mettre en forme et dire quelque chose que nous portons tous tapi au fond de nous, ce «nous » étant entendu comme quelque chose d’intime qui en vient à rejoindre un éprouvé universel.
En observant plus avant ses sculptures, il nous a semblé qu’il est possible d’y relever un mouvement qui semble se répéter et qui concerne le déséquilibre du personnage féminin (en particulier dans la Valse, l’Age mûr et la Fortune, et peut-être aussi déjà dans le Sakountala).
Aussi, il nous est apparu que certaines sculptures réalisées à des moments particuliers de son parcours personnel racontaient quelque chose de son lien à l’objet primaire, de son histoire (outre le lien à l’objet primaire, sa relation très forte avec le sculpteur Auguste Rodin), mais aussi de ses blessures et de sa décompensation. Son œuvre est une représentation des grands moments de sa vie.
La sculpture de Camille Claudel raconte quelque chose de vivant, nous parle d’émotion, de sentiments et de drames humains. Cette œuvre traduit la recherche d’une vérité intérieure. Camille Claudel est en cela l’élève accomplie de Rodin, dont l’enseignement primordial était de suivre la vérité de la nature.
Pour Camille, cette vérité n’est pas restée extérieure à elle-même : elle ne s’inspire pas de la vie sociale, mais chaque sculpture rayonne des émotions d’une chair vivante, où le sentiment illumine la matière et raconte une histoire puisée aux sources de l’expérience vécue par l’artiste. C’est un art de l’âme où vie et expression s’interpénètrent.
Ces impressions premières nécessitent, pour être décollées de la fulgurance sensorielle, émotionnelle et affective qu’elles nous ont procuré, d’inviter le lecteur à la rencontre de Camille Claudel à travers son histoire.
6.3.2 Enfance
6.3.2.1 La famille
La mère de Camille Claudel, Louise Athanaïse Cerveaux, vit une existence jalonnée par les décès familiaux, entre autres celui de sa propre mère à l’âge de trois ans, et aussi plus tard celui de son premier-né, Charles-Henri, quinze jours après la naissance. Camille naîtra seize mois après le décès de ce frère.
Louise Athanaïse donnera à son deuxième fils le prénom de son frère mort (Paul, ce fils est celui qui deviendra le célèbre écrivain).
Selon Paul Claudel, sa mère était :
‘« [...] le contraire d’une femme du monde, d’un bout de la journée à l’autre en train de coudre, de tailler des vêtements, faire la cuisine, s’occuper du jardin, des lapins, des poules ; pas un moment pour penser à elle ni énormément aux autres, hors de la famille.
[...] Douceur, gentillesse, suavité [...], ces manières n’étaient pas en usage à la maison. Notre mère ne nous embrassait jamais. 66 »’
La mère est décrite dans les biographies comme une femme maussade, sans aucune prétention.
Comme tant de bourgeoises de cette époque, elle avait une idée rigoureuse du devoir qui la poussait à s’occuper continuellement dans la maison ou au jardin et à éviter les distractions plus joyeuses. Dénuée de tolérance, elle manquait aussi apparemment de curiosité intellectuelle. En tant que mère, elle appréciait le conformisme de Louise, sa fille cadette, mais elle ne comprit jamais le génie de Camille et de Paul.
Le père, Louis-Prosper Claudel, orphelin de père à l’âge de trois ans, après des études brillantes, intégrera l’administration des finances. Affecté à différents postes, il se retrouvera à Fère en Tardenois comme receveur de l’enregistrement, où il prendra place dans le cortège des notables locaux.
De son mariage en 1862 à trente six ans (il a quinze années de plus que sa femme), naîtront quatre enfants : Charles-Henri, Camille (née le 8 décembre 1864), Louise Jeanne et Paul (6 août 1868).
Paul Claudelbrossera le tableau suivant de son père :
‘« [...] une espèce de montagnard nerveux, ironique, amer [...] insociable et fier. 67 »’
Néanmoins, toujours selon Paul Claudel :
‘« [...] il avait pour ses enfants de grandes ambitions. Il rêvait d’une Camille s’illustrant dans la sculpture, d’une Louise virtuose du piano, et moi, Paul, il m’imaginait normalien, professeur en Sorbonne. »’
Camille était beaucoup plus proche de son père. Comme elle, Louis-Prosper est décrit imaginatif, prompt à s’emporter, et doté d’un humour sarcastique. Par son appartenance à la bourgeoisie masculine, il avait reçu une éducation solide dans un collège de Jésuites et acquis une riche bibliothèque, dont les auteurs laissent à penser que Louis-Prosper était un grand humaniste. Cet homme conservateur et frugal comprenait les rêves de ses enfants et devint une force incontournable derrière leurs succès artistiques.
Pour eux, il acceptera de se séparer de sa famille et de faire face non seulement à de fortes dépenses, mais aussi à la réprobation sociale. Pour Camille, il fut le plus libéral des pères et resta son plus fervent allié jusqu’à sa mort en 1913. En effet, toute sa vie Camille sera assaillie par des problèmes d’argent. Son père, qui a toujours été convaincu du génie de ses enfants, lui en enverra régulièrement.
Il semble bien qu’il y ait du côté du père un véritable sacrifice, qui questionne d’ailleurs sur l’entente du couple parental, la mère faisant penser à la description faite par Sami Ali de la mère présente-absente, c’est-à-dire d’une mère qui est présente dans la réalité du quotidien, dans l’agir, qui s’occupe de toutes les tâches familiales, mais qui est absente émotionnellement pour ses enfants et pour son mari.
Celui-ci, malgré une vive sensibilité, ne sera pas plus capable d’un partage émotionnel direct, et privilégiera l’activité artistique de ses enfants peut-être, mais en sacrifiant sa fonction paternelle. Il tentera néanmoins de soutenir Camille, jusqu’au moment où l’autoritarisme de la mère sera le plus fort. Ceci nous donne l’impression d’un balancement de Camille de l’un à l’autre. Au final, la parole du père ne pourra pas soutenir sa fille. On se trouve là dans une défaillance de la fonction paternelle.
Camille et sa mère formaient par contre un contraste surprenant : leur apparence, leur personnalité, leur comportement, tout les opposait.
Paul Claudel mentionne dans ses écrits au sujet de Camille :
‘« Le front superbe, surplombant des yeux magnifiques, de ce bleu foncé si rare à rencontrer ailleurs que dans les romans..., cette grande bouche plus fière encore que sensuelle, cette puissante touffe de cheveux châtains, le vrai châtain que les Anglais nomment auburn, qui lui tombait jusqu’aux reins. Un air impressionnant de courage, de franchise, de supériorité, de gaieté. Quelqu’un qui a reçu beaucoup. 68 » ’
Paul oubliait de mentionner que sa sœur boitait légèrement (de la jambe droite, suite à une poliomyélite contractée à l’âge de cinq ans) et que cette petite imperfection l’avait d’autant plus incitée à chercher la perfection dans son art.
Les portraits psychologiques dressés de Camille révèlent aussi une fierté ardente, même de l’arrogance. Camille pouvait être imprévisible avec son entourage. Très impulsive, elle s’emportait facilement, parfois violemment. Paul fit allusion à sa « violence effroyable de caractère » et à « l’ascendant souvent cruel » qu’elle exerça sur son enfance.
C’est ainsi que la jalousie de sa sœur Louise, prendra bien plus tard pour Camille une tournure folle : Louise sera désignée dans le délire de Camille comme complice du persécuteur Rodin, accusée d’avoir fait alliance « scellée de baisers sur la bouche » avec lui pour la dépouiller de son œuvre et la déposséder de son héritage
La petite fille de Paul, Reine-Marie Parisécrira :
‘« Camille s’affrontera d’emblée avec sa mère et sa sœur cadette de deux ans, Louise, la préférée de sa mère, formant au sein de la famille un clan des Louise qui ne se séparèrent jamais. 69 »’
Avec son frère Paul, la relation est complexe. Une complicité les lie depuis le plus jeune âge, même si Camille exerce sur lui « un ascendant cruel. » A l’audace de Camille qui défie son milieu par la pratique d’un art réservé aux hommes et par sa relation avec Rodin, Paul, en plus de son métier de diplomate qui l’amènera à voyager à travers le monde, oppose une conversion religieuse et se consacre au théâtre et à la poésie où, paradoxalement, l’image de Camille est sans cesse présente.
On peut certainement penser que Paul et Camille aient eu une relation d’allure incestuelle. S’il l’abandonnera à son triste sort d’internée, Paul sera toujours fasciné par sa sœur.
Camille de son côté l’a admiré et aidé socialement. Les différents départs de Paul pour l’étranger furent pour Camille des pertes d’appui décisives.
Notes
66.
CLAUDEL, P. (1954) Mémoires improvisées, Paris, Gallimard.
67.
Ibid.
68.
CLAUDEL, P. (1965), « Ma soeur Camille », in PARIS R-M (1984), Camille Claudel, Paris, Gallimard.
69.
PARIS R-M. (1984), Camille Claudel, Paris, Gallimard.
6.3.2.2 La glaise : rencontre avec la matière
A douze ans, Camille découvre vraiment la sculpture, essentiellement pratiquée par les hommes à cette époque.
Tout débute à Villeneuve sur-Fère où la famille vivra quelques années. Malgré une série de déménagements imposés par les fonctions de Monsieur Claudel, la famille passait les étés à Villeneuve et finit par hériter de la confortable maison qui appartenait au père de Louise Athanaïse. Pour les enfants, et pour Camille en particulier, Villeneuve demeurera non seulement une maison de vacances, mais surtout un milieu de stabilité.
Pour la petite Camille, le trésor de ce lieu était la riche argile rouge que les ouvriers transformaient en tuiles. Le grand-père de Camille avait fait construire dans sa propriété un four capable de contenir 25000 tuiles. Evidemment, la petite fille se moquait bien des tuiles, mais elle constatait qu’on pouvait modeler l’argile pour en faire des formes fascinantes qui, si on les mettait au four, devenaient permanentes. Camille en fit d’abord des jeux, mais assez vite des créations plus sérieuses. Comme le souligne le journaliste Mathias Morhardt, qui deviendra l’ami protecteur et le premier biographe de Camille, elle développa « une passion véhémente... qu’elle impose despotiquement autour d’elle » 70.
Elle n’hésitait alors pas à enrôler comme assistants les gens imprudents qui se trouvaient près d’elle, généralement son frère ou sa sœur, et quand las de ces jeux ils parvenaient à s’échapper, elle se tournait vers les servantes.
Les paysages alentours (grottes, rochers) où elle allait galoper en compagnie de Paul, devinrent aussi d’étranges sculptures naturelles qui furent les premiers exemples d’un art qui allait l’absorber tout entière. Le rocher du Géyn (dont la forme nous a de manière stupéfiante rappelé la forme conglomérat du patient de notre étude dénommé Paul), inspirera Camille.
En grandissant, elle enrichit sa production artistique en s’aidant de gravures anciennes et de modèles anatomiques. Elle créa ainsi des personnages antiques tels qu’Œdipe et Antigone ou des figures historiques comme Napoléon et Bismarck. Mathias Morhardt put voir la dernière pièce de ces premiers essais : une sculpture de David et Goliath faite lorsqu’elle avait treize ans. Il en admira la fougue romantique, exprimée surtout par le geste victorieux de David et la « robustesse de ses muscles noueux »71.
Cette œuvre attira surtout l’attention du statuaire Alfred Boucher, dont la rencontre sera décisive pour la carrière future de Camille (c’est aussi celui qui lui fera rencontrer Rodin), lorsque la famille Claudel emménagea à Nogent sur Seine en 1876.
Ce que Boucher vit dans l’atelier de Camille fut suffisamment impressionnant pour qu’il décide de donner des leçons à une jeune fille apparemment très douée.
Parallèlement, Camille et son frère suivent l’enseignement d’un professeur, Monsieur Colin, engagé pour donner des leçons aux enfants Claudel, et sous sa direction, elle pourra aller bien au-delà de l’éducation médiocre généralement réservée aux femmes à cette époque. Camille aime lire, et les lectures qu’elle fit alors la menèrent à questionner les valeurs sociales de la bourgeoisie et à rejeter les croyances religieuses établies.
Malgré les rapides progrès sous la supervision d’Alfred Boucher et de Monsieur Colin, Camille faisait face à une limitation majeure à Nogent : la difficulté pour les femmes d’acquérir une formation artistique solide.
Par exemple, la réussite d’un tableau ou d’une sculpture de nu était la preuve de la compétence d’un artiste. En interdisant aux femmes l’accès au modèle vivant nu, la société leur refusait la possibilité de devenir de véritables artistes.
Heureusement, on trouvait à Paris diverses écoles privées et des ateliers d’artistes où les femmes pouvaient outre faire des études solides, accéder au nu.
Alfred Boucher et Colin savaient qu’il fallait trouver le moyen d’envoyer Camille à Paris.
Dans Mémoires improvisées, Paul Claudel écrira :
‘« Et puis s’est produit le cataclysme dans la famille. Ma sœur trouvant qu’elle avait une vocation de grande artiste (ce qui était malheureusement vrai), ayant découvert de la terre glaise, elle avait commencé à faire de petites statues qui ont frappé Alfred Boucher le statuaire. Alors ma sœur, qui avait une volonté terrible, a réussi à entraîner toute la famille à Paris, elle, voulant faire de la sculpture, [...], enfin bref la famille s’est séparée en deux : mon père est resté à Wassy, et nous, nous sommes allés à Paris, boulevard Montparnasse, où nous nous sommes installés. 72 » ’
Madame Claudel déménagea donc à contrecœur à Paris et Camille, qui n’avait alors pas tout à fait dix-sept ans, commença ses études à l’académie Colarossi.
Chez Colarossi, les hommes et les femmes payaient le même prix (ce qui était loin d’être le cas ailleurs), et les femmes pouvaient avoir accès au modèle vivant nu.
Boulevard Montparnasse où logeaient la mère et ses trois enfants, Camille décide de transformer en atelier la chambre de la fidèle servante qui avait suivi la famille, envoyant la pauvre fille vivre dans le grenier, laquelle atterrée rendra son tablier.
Quelques mois après, Camille trouva un atelier qui lui plut rue Notre-Dame-des-Champs. Deux autres femmes artistes y rejoignirent Camille, ce qui lui permit de partager le loyer et le coût du modèle. Alfred Boucher continuait de donner gratuitement des leçons à Camille et à ses deux amies, et venait les voir une à deux fois par semaine. Il se montrera de plus en plus impressionné par le travail de la jeune Camille.
L’aide de Boucher se terminera lorsqu’il gagnera le grand prix du Salon en 1881 et quittera Paris pour Florence un an plus tard. Avant son départ, cependant, il demandera à son ami Auguste Rodin de prendre sa place à l’atelier Notre-Dame-des-Champs, et c’est ainsi qu’en 1882, Auguste Rodin entrera dans la vie de Camille.
Notes
70.
MORHARDT, M. (1898), Mademoiselle Camille Claudel, Mercure de France, p. 708-755.
71.
Op. cit.
72.
CLAUDEL P. Op. cit.
6.3.3 La relation avec Rodin
Camille a dix-huit ans lorsqu’elle rencontre Rodin âgé de quarante deux ans.
La force physique nécessaire à la pratique de la sculpture fait qu’au XIXième siècle, celle-ci semble n’être qu’un métier d’homme. Dans ce contexte, la grande beauté, la jeunesse et l’apparente fragilité de Camille rendent encore moins crédible son talent.
Les liens complexes de maître à élève, la rivalité artistique et la jalousie inféreront dans le couple Camille Claudel-Auguste Rodin.
En effet, s’ils se fréquentent pendant quinze années durant, il est étonnant de constater que la passion heureuse ne durera réellement que quelques années et qu’elle sera violente et féconde pour les deux artistes. Une gémellité spirituelle les fait se retrouver dans une même passion pour la sculpture. La fusion dans l’art et la passion amoureuse leur inspire des œuvres dont certaines se ressemblent.
A l’amour absolu et intransigeant de la jeune Camille, Rodin oppose une vie amoureuse multiple entre une maîtresse, Rose Beuret, compagne des jours difficiles dont il a un enfant (qu’il n’a jamais reconnu), et des liaisons avec des modèles et des femmes du monde.
Malgré les souhaits de Camille et les promesses de Rodin, il ne quittera jamais Rose Beuret, ce qui provoquera sûrement la rupture, en 1898, en particulier suite à un avortement présumé.
Après avoir travaillé pendant deux ans sous la direction de Rodin, Camille modelait brillamment le corps humain, surtout les mains et les pieds. En 1885, Rodin reçut une commande pour ce qui deviendra Les Bourgeois de Calais et constata qu’il avait besoin d’assistants en qui il pouvait avoir entière confiance. Il invita donc Camille, âgée de vingt ans, à se joindre à son atelier de la rue de l’Université. Sans aucune hésitation et sans égard pour la « décence » de l’époque, la jeune artiste s’intègre à l’atelier qui n’avait jusqu’à présent vu que des sculpteurs masculins.
Camille ne tardera pas à devenir l’assistante la plus estimée de Rodin (il lui confie la réalisation des mains et des pieds de ses personnages).
Elle deviendra sa « féroce amie », celle à qui il écrira des lettres dont le ton est tour à tour inquiet et passionné :
‘[...] ta main Camille pas celle qui se retire, pas de bonheur à la toucher si pour l’avenir elle ne m’est le gage d’un peu de ta tendresse.
oh divine beauté, fleur qui parle, et qui aime fleur intelligente ma chérie. ma très bonne à deux genoux devant ton beau corps que j’étreins. » ’
« A deux genoux devant ton beau corps que j’étreins », évoque L’Eternelle Idole, une des figures de La Porte de l’enfer que Rodin reproduira plus tard en marbre.
Camille avait inspiré cette femme mélancolique, adorée de son amant vaincu, et perdue dans ses pensées. Elle était celle qui embellissait la vie de Rodin et la « divinité malfaisante » qui le tourmentait par ses réactions imprévisibles.
En 1883, Auguste Rodin a quarante trois ans, Rose Beuret trente neuf ans et Camille Claudel à peine dix neuf ans. Rodin, prototype de l’imago paternelle, est aussi né la même année que la mère de Camille Claudel.
La relation tumultueuse de Camille Claudel et Auguste Rodin est fascinante, mais elle n’est pas le centre de notre propos. Pour plus d’éléments à ce sujet, nous renvoyons le lecteur aux biographies respectives des artistes.
Sans relater le déroulement de la relation dans son intégralité, il nous faut cependant retenir deux événements importants, en particulier celui de l’avortement présumé et celui de la rupture amoureuse qui suivra.
Camille fera le silence sur cette liaison. A-t-elle eu des enfants avec Rodin ? Il semble indéniable que Camille ait subi au moins un avortement, provoquant la rupture de sa liaison, et peut-être (en lien avec d’autres événements dont la rupture aussi avec la mère) le déclenchement de la décompensation de Camille.
Le secret fut collectivement bien gardé. Mais les sculptures parlent : la jeune femme agenouillée aux bras tendus, appelée le Dieu envolé (1894), et celle qui lui est apparentée, l’Implorante (1899), ont chacune le même ventre arrondi de femme qui connut peut-être la maternité. Ce personnage de l’implorante deviendra « la jeunesse » dans le groupe à trois de l’Age mûr.
La liaison de Camille Claudel avec Rodin fut longtemps dissimulée aux parents de Camille, mais dès qu’elle fut révélée, Madame Claudel s’autorisa à faire éclater sa haine. La protection du père se révélera impuissante. Cet événement est peut-être l’un de ceux qui précipitèrent Camille dans la décompensation.
Camille fait alors le choix difficile de quitter Rodin pour s’affranchir sur le plan artistique (leurs œuvres sont tellement proches qu’on accuse Camille de « faire du Rodin »). Elle va vivre seule et se consacrera entièrement à son travail.
Contrairement à la légende romancée et à ce que peuvent mentionner certains écrits au sujet de Camille Claudel (dont certains très « féministes » accusant Rodin de tous les maux de Camille), elle traversera une période d’épanouissement artistique de plusieurs années avant que soudainement, cette force qui lui avait permis de se libérer se retourne contre elle, et se cristallise en pensées obsessionnelles sur celui qui deviendra la cause majeure de ses difficultés.
6.3.4 La rupture et l’Age mûr
En 1893, Camille et Rodin quittent leur atelier, lieu de rendez-vous amoureux. Camille loue un appartement avenue La Bourdonnais.
Elle a déjà exposé plusieurs fois, elle est reconnue comme la talentueuse et prometteuse élève du grand sculpteur, ce que lui reproche d’ailleurs son frère. Elle tentera alors de s’affranchir délibérément de l’emprise du maître.
Toute une série d’œuvres s’amorcent et convergent vers ce qui sera l’Age mûr. Il y eut deux versions de l’âge mûr. La première, en plâtre, est ainsi décrite par Reine-Marie Paris et Arnaud de la Chapelle :
‘« L’homme en position centrale domine les deux femmes, et ses deux immenses bras les couvrent comme deux branches, de cet arbre de la fatalité qui est lui-même. La vieillesse est représentée debout en sosie de Clotho sans chevelure. La jeunesse à genoux mais encore droite n’est pas séparée de l’homme, dont elle garde la main. 73» ’
Pendant deux ans une seconde version s’élabore. Dans celle-ci, l’homme s’est séparé de la jeunesse, et la vieillesse l’entraîne dans son redoutable envol.
Cette scène triangulaire présente l’acte du déchirement en Camille. C’est parce qu’il y a du passionnel qu’il va y avoir acte de déchirement.
Cette sculpture donne à voir la résonance entre la situation réelle Auguste Rodin-Rose Beuret et Camille Claudel, mais aussi et surtout le lien père-mère-fille, où l’homme, tiraillé entre la femme et la fille, finit par se délier de cette dernière.
La jeune femme de l’œuvre, en déséquilibre, est comme suspendue au détachement qui vient de se créer.
La commande de la traduction en bronze de cette œuvre, après avoir été promise par l’Etat sera supprimée d’une manière totalement inattendue (elle constituerait une atteinte à la vie privée de Rodin), et pendant des années, Camille s’obstinera à réclamer la commande de l’État pour le fondre en bronze.
Cette œuvre marqua l’entrée de Camille dans le délire de persécution et le début du déclin de son activité artistique.
Selon Marie Magdeleine Lessana :
‘« La facture artistique du scénario devait avoir une fonction déclarative et contre-persécutive. En produisant dans le plâtre une interprétation de la scène qui la persécute, Camille tentait de parer au risque de la persécution qui s’amorçait : en serrant dans la matière fabriquée le dispositif à trois, l’œuvre retient l’acte en s’y substituant, en quelque sorte. Ce devait être, pensons-nous, une œuvre de franchissement. Mais le geste artistique en jeu dans cette œuvre-là ne pouvait pas rester en suspend, il ne devait pas flotter, il devait être tenu jusqu’au bout, c’est-à-dire aboutir à son public anonyme. L’œuvre ayant été reçue comme un message personnel de haine, fut interrompue sur son parcours de publication. Elle fut détournée et retournée à l’envoyeur. Ainsi, par le ricochet de l’annulation, l’œuvre a pris valeur de passage à l’acte. 74 »’
Cette œuvre marqua l’entrée de Camille dans le délire de persécution et le début du déclin de son activité artistique.
Dans le même temps, Camille avait achevé la sculpture de La Valse, représentant l’emportement d’un couple amoureux, dans une danse aérienne défiant la pesanteur. Le personnage féminin en déséquilibre est maintenu par le personnage masculin dans le mouvement même de la danse. Mais le déséquilibre est déjà là.
Si certains y ont vu une représentation de Camille Claudel et Rodin, d’autres de Camille et Claude Debussy, nous émettons l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une représentation de Camille et du père. Ce dernier soutiendrait dans un mouvement œdipien sa fille déjà en position de déséquilibre. Ceci nous permettrait de comprendre alors la suite des œuvres comme la mise en scène du déséquilibre psychique, traduction du sentiment de la perte d’identité chez Camille.
Si l’Age mûr a souvent été comparé à la triade Camille Claudel-Auguste Rodin-Rose Beuret, comme nous l’avons souligné, la sculpture traduirait aussi une triangulation impossible Camille-Père-Mère, montrant une Camille implorante et enceinte.
Nous pouvons nous questionner sur cet enfant impossible, avorté, comme une possible tentative de donner à la mère un enfant.
Concernant Camille Claudel, il pourrait être aussi remplacement du premier enfant mort de la mère, à travers un désir de réparation de celle-ci, mais aussi peut-être une identification à cet enfant mort, l’enfant chéri de la mère. Car derrière l’homme de l’Age mûr, il y a la vieille femme, Clotho.
Selon Henry Asselin, à partir de 1906, Camille détruisait systématiquement et chaque été, à coups de marteau, les œuvres de l’année, puis enterrait les débris. Elle mettait ensuite la clé sous le paillasson et disparaissait pendant de longs mois sans laisser d’adresse.
Camille évoquait alors la « bande à Rodin », qui manipulerait tous ceux qui sont en contact avec elle : sa concierge, les collectionneurs... Il lui ferait, selon elle, « une guerre acharnée ». Le ton de ses lettres est de plus en plus incisif, violent et ironique.
Elle exige de l’argent de son marchand, sinon elle va « disparaître dans un cataclysme » : elle a reçu une facture qui « menace de l’engloutir tout entière. » Dans ce style qu’elle qualifie elle-même de « littérature exubérante », elle déverse sa rage sur « le premier qui se trouve à sa portée », (c’est-à-dire plutôt Rodin que sa mère), tels sont ses propres termes.
En 1909, Camille Claudel vit seule à Paris, démunie et dans la peur.
Les persécuteurs seront Rodin et sa sœur Louise, la persécution par Rodin protégeant jusqu’au bout Camille d’avoir à accuser sa mère. L’élément majeur est l’impossibilité pour Camille d’affronter sa mère en face.
Notes
73.
PARIS R-M. Op. cit.
74.
LESSANA M-M. (2000), Entre mère et fille : un ravage, Paris, Pauvert.
6.3.5 La mère « Méduse »
Revenons sur la relation de Camille à sa mère durant son enfance. Toutes les biographies nous parlent d’une mère froide, encore en deuil au moment de la naissance de Camille, certainement dépressive, ou luttant contre la dépression, « mère-morte » au sens de A. Green, c’est-à-dire incapable d’investir affectivement son enfant tant elle devait être prise par sa propre douleur interne.
Il semblerait que les ruptures successives qu’à vécu Camille au moment de l’Age Mûr, c’est-à-dire l’avortement, la rupture avec Rodin, celle d’avec les parents, le départ de Paul Claudel à l’étranger, la rupture du contrat de commande de l’État, aient provoqué sa décompensation, ces ruptures successives venant réactiver une première rupture insupportable et traumatique pour Camille.
Cette rupture première, concernant la mère et datant des premiers mois de la vie de Camille était resté clivée tout ce temps, grâce au rôle secondaire mais néanmoins étayant joué par la relation au père.
La relation de Camille à sa mère peut faire penser qu’il y a eu, dans la vie psychique de Camille, un échec dans l’établissement d’un objet interne tel que D. Meltzer (1967)l’a décrit sous la terminologie de sein-toilettes, c’est-à-dire d’un objet interne dans lequel le sujet puisse évacuer l’excès intolérable de sa souffrance psychique manifeste et surtout latente. La fonction du sein-toilettes consiste à contenir la projection de la souffrance psychique du bébé, à l’origine du besoin d’un objet externe accueillant et contenant.
Selon Jean Bégoin (1997) :
‘« Cet objet interne doit posséder les capacités d’absorber et de contenir l’excès de la souffrance essentiellement dépressive, dont l’impact brut serait mortel.75 » ’
Cet objet interne, peut-être absent ou défaillant chez Camille, pourrait expliquer la destruction systématique qu’elle opérera à la fin de sa carrière sur ses œuvres à chaque frustration.
Si l’on suit Bion, les modes auditifs, visuels, tactiles, olfactifs et gustatifs de la relation à la mère sont en même temps investis comme autant de points d’ancrage à l’objet et à son rôle psychique primaire de contenant.
Ce seront aussi les points d’ancrage des processus de symbolisation comme nous l’avons souligné à travers notre travail de recherche.
Cette sécurité de base qui manquait à Camille Claudel a fait que tout événement douloureux pouvait menacer son équilibre, et c’est ce qu’elle traduisait peut-être, dans le déséquilibre spatial de ses personnages.
De plus, si le personnage de Clotho constitue une représentation maternelle, on peut s’interroger sur « l’investissement esthétique de l’objet », au sens de D.Meltzer, c’est-à-dire l’investissement de la beauté de la rencontre, où le bon objet devient aussi le beau, investissement qui fonde le plaisir de vivre.
Or nous avons vu que Clotho est plutôt une figure de la mort. Lorsque les conditions d’environnement ne sont pas suffisamment favorables, l’aspect esthétique de l’amour primaire mutuel ne peut pas être créé.
Selon Jean Bégoin :
‘« En lieu et place, se développe le négatif de l’admiration et de l’éblouissement primaire : l’horreur, figurée dans la mythologie par la figure de Méduse au pouvoir paralysant et mortel, qui a été évoquée par F. Pasche et P.C. Racamier comme image de l’irreprésentable, et où l’on peut aujourd’hui voir, avec E. About, l’image du trou noir de la dépression primaire et d’une menace d’avortement de la naissance psychique.76 » ’
Or, après l’Age Mûr, c’est bien Persée et la Gorgone que sculpte Camille Claudel. Le personnage de Persée, décapitant la tête de la Gorgone en utilisant un miroir (son bouclier selon la légende), pour ne pas être pétrifié, constitue une tentative désespérée de donner corps à la Méduse et de l’affronter pour ne pas sombrer. Mais cette tentative se soldera par un échec pour Camille Claudel.
Selon E. About (1994) :
‘« Au conflit esthétique proposé par D. Meltzer la rencontre avec la Méduse vient opposer son aspect négatif. Derrière l’apparente beauté, le conflit esthétique offre l’ombre d’une nature plus complexe. Cependant, l’attrait de la beauté garde sa force pour entraîner le nouveau-né vers la recherche de ce qui se dissimule à l’intérieur de cette apparence. La rencontre avec la méduse, elle, offre l’aspect effrayant, qui peut faire craindre que l’intérieur soit pire encore que l’apparence.
Une relation Méduse s’établit entre la mère et son enfant lorsque la mère, absente de sa propre pensée, soumise à une pensée extérieure, ne peut faire transparaître ses aspects de beauté et de bonté qui permettraient à son enfant de s’engager sur la voie de la découverte du monde. Commence alors pour l’enfant une période de terreur dans laquelle il sera confronté à deux perspectives possibles de son développement ultérieur : soit il accepte la rencontre avec une telle souffrance, il accepte alors de porter son regard vers cet aspect terrifiant de la mère, et d’attendre l’apparition d’un aspect de bonté et d’une rêverie possible, soit il se laisse entraîner dans la pensée de sa mère, choisissant ainsi la moindre souffrance psychique.77 » ’
Camille écrira en 1938 à Paul, après la mort de leur mère et alors qu’elle et internée en psychiatrie :
‘« À ce moment des fêtes, je pense toujours à notre chère maman. Je ne l’ai jamais revue depuis le jour où vous avez pris la funeste résolution de m’envoyer dans les asiles d’aliénés. Je pense à ce beau portrait que j’avais fait d’elle dans l’ombre de notre beau jardin. Les grands yeux où se lisait une douleur secrète, l’esprit de résignation qui régnait sur toute sa figure, ses mains croisées sur ses genoux dans l’abnégation complète : tout indiquait la modestie, le sentiment du devoir poussé à l’excès, c’était bien là notre pauvre mère. »’
Camille avait comprit la souffrance de sa mère, traduite dans ce portrait détruit par la mère elle-même (alors que Camille est persuadée que c’est Rodin qui l’a volé), souffrance traduite aussi par la figure de Clotho qu’elle cherchait en vain à toucher par l’intermédiaire de l’homme dans L’Age Mûr. Elle attendra toujours l’apparition d’un aspect de bonté et d’une rêverie possible chez sa mère.
Pour établir un lien avec nos travaux de recherche et au sujet de la constitution de l’enveloppe psychique, nous pourrions aussi désigner, en référence à D. Anzieu , la faillite d’une peau commune entre Camille et sa mère. La peau psychique qui devrait être somptueuse devient flétrissement dans la Clotho.
Les ruptures successives que Camille a traversé ont fait resurgir la « mère Méduse. »
Notes
75.
BEGOIN J. (1997), Vivre le manque, souffrir l’absence, Cahiers de psychologie clinique, n° 8, L’absence, De Boeck Université, Bruxelles, p. 25-48.
76.
Op. cit.
77.
ABOUT E. (1994), Rencontre avec Méduse, Paris, Bayard.
6.3.6 Les dernières œuvres
Après Persée et la Gorgone suivra La Fortune, silhouette défiant les lois de l’équilibre. Lancée le pied sur une roue, valseuse qui a perdu son partenaire, elle a les yeux bandés.
La dernière œuvre majeure de Camille sera la Niobide blessée (1907), dont le titre n’est pas hasardé.
Dans le livre des métamorphoses, Ovide raconte le massacre des Niobides. Les sept garçons puis les sept filles de Niobé vont périr sous les flèches d’Artémis et d’Apollon. Les dieux jumeaux vengent leur mère Latone, que Niobé a orgueilleusement défiée de par sa fécondité. Face au spectacle du massacre de ses enfants morts, Niobé restera prostrée dans la pierre.
Camille Claudel, elle aussi alors déjà prostrée, en était-elle réduite à méditer sur cette fécondité anéantie ?
Avec l’échec de l’Age Mûr, l’art de Camille succombera à son impossibilité d’atteindre sa mère, celle qui retient l’homme par le bras pour l’empêcher d’agir en sa faveur. Camille, telle la Niobide blessée, s’effondrera et détruira les êtres de pierre auxquels elle avait donné corps, devenus inaptes à toucher sa propre mère.
Les actes de destruction deviennent alors systématiques après la Niobide blessée. Camille décrit ce rite comme un sacrifice. Dans une lettre à un oncle, alors qu’elle vient d’apprendre la mort d’un cousin, elle écrit :
‘« [...] Beaucoup d’autres exécutions capitales ont eu lieu aussitôt après, un morceau de plâtras s’accumule au milieu de mon atelier, c’est un véritable sacrifice humain. »’
En détruisant ses propres créations, Camille affirme avec véhémence son droit de vivre en dehors des valeurs de son temps. Pendant ces brefs moments de liberté illusoire, motivée par sa mission destructrice, elle peut croire qu’elle contrôle sa destinée. Quand le massacre est accompli et que les débris ont été enlevés, elle disparaît parfois des jours ou même des mois. Elle vit dans la crasse, fouillant dans les poubelles à la recherche de nourriture et pestant contre Rodin et « sa bande. » Pour se protéger contre eux, elle a transformé son atelier en forteresse :
« Des chaînes de sûreté, des mâchicoulis, des pièges à loup derrière toutes les portes », confie-t-elle à la veuve de son cousin Henri.
Plus que jamais, Rodin apparaît comme « l’ennemi suprême » dans l’esprit de Camille. Rien ne reste du compagnon d’autrefois ou du mentor généreux, rien d’autre qu’un être diabolique prêt à tout pour la détruire.
6.3.7 La chute et le délire de persécution
« L’enlèvement » de Camille à l’asile de Ville-Evrard aura lieu le 10 mars 1913, une ambulance et des infirmiers viennent alors la chercher à son domicile, accompagnés de son frère Paul.
Des contacts avaient déjà été pris avec le directeur de l’asile et sur les sollicitations de Paul.
Le Docteur Michaux, qui vivait à l’étage au-dessus de l’atelier de Camille, rédigera à la demande de Madame Claudel (mère), le certificat nécessaire à l’hospitalisation.
Il est vrai que Camille était arrivée au point où elle ne pouvait plus s’occuper d’elle-même. Ses lettres obsessionnelles, ses récriminations contre presque tout le monde, ses disparitions régulières et la saleté dans laquelle elle vivait démontraient clairement qu’elle avait besoin d’être soignée.
La première observation enregistrée le jour de son arrivée à Ville-Evrard allait dans le sens du certificat du Docteur Michaux et déclarait l’artiste atteinte « de délire systématisé de persécution basé principalement sur des interprétations et des fabulations, d’idées vaniteuses et de satisfaction. 78» Comme elle l’avait souvent fait, Camille blâmait Rodin pour tous ses problèmes, mais ses récriminations virulentes contre lui présentaient une nouvelle dimension délirante, car elle avait perdu la notion du temps et ne voyait aucune différence entre un millénaire et une décennie. Selon elle, Rodin avait commencé à l’exploiter trois mille ans auparavant, même avant le Déluge. Il l’avait obligée à travailler dans son atelier lorsqu’elle n’avait que dix-huit ans, il l’avait battue, lui avait donné des coups de pieds ; il avait essayé d’empoisonner tous les membres de sa famille. De plus, il l’avait fait interner pour voler le peu qui restait des sculptures de son atelier. En tant que chef d’une bande de voleurs, il était très puissant et pouvait influencer tout le monde, même les membres de la famille Claudel79.
Selon la loi, la destinée de Camille était entre les mains de son frère Paul. En tant que seul homme de la famille, il avait toute autorité pour agir en sa faveur. Mais le choix de Paul était limité : il pouvait soit l’emmener avec lui de consulat en consulat, soit la laisser dans un asile. A cette époque, Paul était déjà père de quatre enfants. De plus, entre ses livres et la diplomatie, sa vie n’était qu’un tourbillon incessant. Soirées, cérémonies, inaugurations, répétitions de pièces de théâtre, tout cela absorbait son temps et le maintenait sous le regard du public. Dans ces conditions, il aurait été impossible d’emmener sa sœur avec lui. Pourtant, bien que l’internement ait été, sans aucun doute, nécessaire, rien ne justifiait dans le comportement de Camille la décision de la couper totalement du monde extérieur. Sa séquestration fut décidée uniquement pour éviter le scandale.
Lequel scandale éclatera cependant quand les journaux feront part de la situation de Camille Claudel.
Informé par ce biais, au début de juin 1914, ainsi que par ses connaissances, M. Morhardt comprendra vite que le sort de Camille est inextricable et demandera de l’aide à Rodin, afin de trouver un lieu d’exposition pour rendre un hommage à l’œuvre de Camille. Auguste Rodin, alors septuagénaire et dans un état de santé précaire, acceptera d’envoyer dans un premier temps de l’argent.
Le sculpteur avait l’intention de renouveler le geste tous les ans, et surtout de proposer un lieu d’exposition dans sa vaste demeure au rez-de-chaussée de l’hôtel Biron rue de Varennes. Mais divers événements l’en empêcheront : en août 1914, la Grande Guerre commençait. Rodin quitte Paris. Lorsqu’il y reviendra trois ans plus tard, il sera en très mauvaise santé.
Certaines biographies mentionnent qu’après une première congestion cérébrale en mars 1916, puis une deuxième attaque en juillet, Rodin serait resté plusieurs semaines prostré, dans un état second et demandant à Rose Beuret où était sa femme, « sa femme qui était à Paris, ne manquait-elle pas d’argent ? »
Comme l’état de santé du sculpteur empirait, l’Etat comprit qu’il n’y avait plus de temps à perdre, et les documents pour la donation furent signés le 1ier avril 1913, trois mois après la dernière congestion de Rodin. Après tant de fausses alertes, l’hôtel Biron devenait enfin le Musée Rodin.
Ce n’est pas par manque d’intérêt qu’on ne réserva aucune salle pour l’œuvre de Camille Claudel, Mathias Morhardt et Auguste Rodin désiraient fortement rectifier l’injustice faite à l’artiste en la lui consacrant, mais ils se heurtèrent à l’opposition ferme de la famille Claudel.
Rodin, alors homme démuni, devenu l’ombre du sculpteur plein de vigueur et aux multiples conquêtes, épousa enfin Rose Beuret. Ils se marièrent le 29 janvier 1917. La maison de Meudon où ils s’étaient réfugiés n’étant pas chauffée à cause du rationnement, le vieux couple se blottit dans le seul endroit encore douillet qui leur restait : leur lit. Le gouvernement, qui aurait pu leur venir en aide, se contenta de remercier le plus grand sculpteur du siècle de sa générosité (Rodin avait alors fait don de toutes ses œuvres), en le privant de chauffage. Deux semaines plus tard, Rose mourut d’une pneumonie. Rodin la suivit le 17 novembre 1917, décédé, lui aussi, de complications dues au froid glacial de la maison.
Camille devait passer les trente dernières années de sa vie dans un asile à Montdevergues. Trente ans à désirer la présence d’une mère qui ne vint jamais. Trente ans à attendre les visites irrégulières de son frère. Trente ans à survivre malgré tout.
Les médecins avaient constaté que si les idées délirantes de persécution et d’empoisonnement résistaient, elles étaient devenues moins virulentes (les autres secteurs de sa personnalité étaient bien conservés, ce qui est le propre de la psychose paranoïaque). Camille présentant un état mental stable, les médecins demandèrent à sa famille si elle ne pourrait pas leur rendre d’éventuelles visites, ce qu’elle réclamait depuis si longtemps, voire même envisager une sortie. La mère s’y opposa farouchement et violemment (les lettres écrites aux médecins et directeur de l’asile témoignent du rejet et de la haine véritable de la mère envers sa fille aînée), jusqu’à sa mort le 20 juin 1929. Camille n’assistera pas aux obsèques de sa mère, ne la reverra jamais, elle ne remettra jamais un pied dehors.
Suite au décès de la mère, un violent conflit éclatera entre Paul et Louise, sœur cadette, au sujet de la pension de Camille à payer à l’hôpital et donc de décider qui serait responsable de cette dépense.
Avant 1940, l’asile de Montdevergues tirait suffisamment de revenus de ses fermes, ses vignobles et champs où travaillaient les pensionnaires (la plupart des malades étaient mis au travail) ; mais ensuite, les réquisitions de l’armée allemande ne permirent plus à l’asile de subvenir aux besoins des pensionnaires. Chaque jour, au moins cinq d’entre eux mouraient de faim. En 1943, 800 patients sur 2000 étaient morts.
Au cours de l’été 1942, Paul Claudel réfugié en zone libre vient de s’offrir un domaine somptueux à Brangues. Il reçoit un premier bulletin médical alarmant quant à l’état de santé de Camille, qui mentionne l’installation progressive d’un syndrome d’affaiblissement intellectuel, ainsi qu’un fléchissement de l’état physique général, dû aux restrictions alimentaires.
En décembre, une nouvelle lettre du médecin informe Paul que Camille va encore plus mal et qu’elle s’affaiblit progressivement, une complication cardiaque étant redoutée.
Paul est aux prises avec sa culpabilité, mais pour autant, il ne rend pas visite à sa sœur. C’est la belle-mère de la fille aînée de Paul qui ira rendre visite à Camille, après un très long voyage et lui apportera un peu de nourriture qu’elle aura pu se procurer. Elle restera une semaine entière auprès de Camille et écrira à Paul pour l’inciter à venir. Elle décrira une Camille « en paix », « un visage si reconnaissant et si épanoui par une simple visite. »
Paul se décide à rendre visite à Camille le 20 septembre 1943. Camille a alors 80 ans.
‘« Elle me reconnaît, profondément touchée de me voir, et répète sans cesse : Mon petit Paul, mon petit Paul !
[...] Sur cette grande figure où le front est resté superbe, génial, on voit une expression d’innocence et de bonheur. Elle est très affectueuse. Tout le monde l’aime, me dit-on.
Amer, amer regret de l’avoir ainsi si longtemps abandonnée ! »’
Le 19 octobre 1943, deux télégrammes partirent de Montdevergues. Le premier parvient à Paul dans la matinée : « Sœur très fatiguée. Jours en danger. Médecin-chef. » Le second arriva en fin d’après-midi : « Votre sœur décédée. Inhumation jeudi 21 octobre. »
Paul ne se rendra pas à l’enterrement. Seules quelques religieuses suivront silencieusement la procession, menée par l’aumônier de Montdevergues. Camille sera enterrée au cimetière de Montfavet, à l’endroit réservé à l’asile.
Sur sa tombe, une simple croix portant l’année de la mort de l’artiste et le numéro de la tombe : 1943-392. Une prière fut dite, c’était fini.
Notes
78.
Docteur Truelle, certificat médical, archives de Ville-Evrard, dans Rivière, Gaudichon et Ghanassia, 2001, p.306, 10 mars 1818. Les dossiers médicaux ne seront accessibles aux chercheurs que 150 ans après la naissance de Camille, soit en 2014. Une partie de ces dossiers fut publiée par Reine-Marie Paris, petite nièce de Camille Claudel, avec l’accord des autres membres de la famille. Plus récemment, les archives complètes de Ville-Evrard et celle de Montdevergues furent publiées dans la troisième édition du Catalogue raisonné par Rivière, Gaudichon et Ghanassia et la Correspondance de Camille Claudel par Rivière et Gaudichon en 2003.
79.
Docteur Truelle, rapport médical, Ibid., p. 305, 10 mars 1913.
6.4 Spécificité des processus psychiques en œuvre dans l’art de la sculpture
A partir de l’œuvre de Camille Claudel, qui constitue selon nous « l’œuvre princeps » mais aussi à partir d’autres œuvres, nous proposons d’étudier la spécificité des mécanismes psychiques mis en œuvre dans le travail de la sculpture.
La réalisation d’une sculpture place le sculpteur dans des conditions particulières, mettant en œuvre des processus psychiques spécifiques, lesquels semblent ne pas être dénués de bénéfices secondaires pour l’artiste.
Tout d’abord, la transformation de la matière implique de se soumettre aux lois physiques, au principe de réalité. La matière première se travaille selon deux modalités possibles : en partant du plein (« per via di livare ») ou du vide (« par ajout»).
Comme nous le verrons dans la dernière partie avec Camille Claudel, on peut sculpter en travaillant l’argile, le plâtre, le marbre, la pierre.
La « taille » consiste à partir du plein de la matière première et de « l’attaquer » dans un geste qui sera définitif pour en révéler le cœur et le travailler. Lorsque le bloc de matière brute sorti de la carrière arrive au sculpteur, il travaillera par retraits successifs, à l’aide d’outils qui l’aideront à donner corps à la forme qu’il souhaite représenter. La taille directe est une attaque violente et définitive qui engage celui qui s’y adonne dans une lutte physique (un corps à corps) exigeant une maîtrise parfaite qui ne permet aucun droit à l’erreur.
Cette technique fut entre autres celle usitée par Michel-Ange, satisfaisant à la fois l’exigence de maîtrise qu’il s’imposait à lui-même et son aspiration à réaliser des œuvres titanesques dont il voulait qu’elles soient parfaites. Lutte et mesure avec la matière lui permettent de soumettre cette dernière à la forme qu’il avait choisie pour elle.
L’illusion offerte de dominer la nature et de conquérir une liberté et le combat pour Michel-Ange laissent à penser qu’il chercherait peut-être à travers la matière à se mesurer à la création divine...
Mais le sculpteur est avant tout un bâtisseur. La matière dure perdure, résiste aux effets du temps et de l’érosion, signifiant un caractère possible d’immortalité pour son auteur.
Il est question d’assouplir la rigidité de la pierre pour procurer une illusion de mouvement à ce qui n’est que statique.
Autre est le mouvement de celui qui « monte » la sculpture en terre, lui offrant une colonne vertébrale, un squelette qui tient debout là où il n’y a rien au départ. Celui qui sculpte par ajout part du vide pour le remplir. La peau en contact direct avec la matière terre humide se réfère à une construction plus sensuelle, qui, par ajouts successifs va donner forme et tenue à la matière molle et malléable.
Ce type de tempérament convient bien à celui qui a envie de pétrir et de donner chair.
Modeler, c’est remplir l’espace vide de chair. Tailler, c’est dévider le plein pour trouver en son noyau la forme vivante.
Rodin par exemple, qui savait faire vibrer la matière-terre grâce à son modelé disait :
‘« Je m’efforçais de faire ressentir dans chaque renflement du torse ou des membres l’affleurement d’un muscle ou d’un os qui se développait en profondeur sous la peau »80.’
Sa sensualité exacerbée guidait ses mains qui sculptaient le corps. Se penchant sur une sculpture « comme s’il en eût été amoureux », rapporte le témoin Paul Gsell, ce dernier dit :
‘« C’est de la vraie chair […] on la croirait pétrie sous les baisers et les caresses! 81»’
Puis, mettant la main à plat sur la hanche de la statue, il ajouta :
‘« On s’attendrait presque en tâtant le torse à le trouver chaud »82.’
Rodin cherche la chair partout. Il dénude, fusionne. Il tente d’abolir la distance entre lui et le corps de l’autre. Les représentations d’un Balzac ou d’un Victor Hugo, pourtant commandes officielles, seront livrées nues, non pour être désacralisées mais bien au contraire devenir emblématiques de notre incarnation sublimée.
Modeler la terre humide, c’est aussi revenir aux jeux des enfants qui pétrissent la boue, l’écrasent dans leurs mains, la font couler… Jeux sans fin qui nourrissent un plaisir qui n’est pas sans rapport avec la pulsion anale.
Le contact avec la terre « prima materia », satisfait donc à plusieurs titres une tendance régressive.
Chaque sculpteur, selon sa personnalité, ira instinctivement vers tel ou tel matériau. Rien d’étonnant qu’un Giacometti, hanté par les squelettes, ait privilégié le plâtre qu’il ajoutait avec parcimonie sur des fils de fer, jouait le rôle du squelette souvent à peine recouvert. Pour lui, les femmes ne sont pas de chair mais d’os. La forme qu’il cherche, poussée à son extrême, c’est le fil. Là où Rodin ôte les vêtements, il ôte la chair elle-même.
Comme le souligne H. Jousse83, la matière, qu’elle soit dure ou tendre, impose sa loi et renvoie le sculpteur à ses limites : sculpter est une mise en acte par excellence, une confrontation au réel.
Affronter les lois de la pesanteur, de l’équilibre, de la résistance d’un matériau (pierre ou marbre), du temps de séchage d’un autre (terre), nécessite d’y investir tous ses moyens physiques et intellectuels, son temps, ses efforts, sa patience (savoir cesser de travailler pour reprendre plus tard). Cet affrontement entre soi et les éléments permet certes de mesurer son pouvoir sur le réel, mais, à contrario, les limites de celui-ci.
Les contraintes imposées par la nature placent le sculpteur dans la lutte entre les éléments naturels et ses aspirations. En ce qui concerne les figures de Michel- Ange, le philosophe de l’art Georg Simmel souligne :
‘« Pesanteur tirant vers le bas et énergies spirituelles aspirant vers le haut, se démarquent mutuellement avec rudesse et hostilité » 84.’
Le sculpteur est un homme de combat, d’action. Sculpter, c’est mettre en acte, dépasser les contradictions de sa condition. Le travail soumet l’activité du sujet aux exigences du matériau.
En se mesurant à la matière, l’artiste cherche à mesurer son pouvoir sur les éléments, sur le monde dont il est issu.
Il doit passer non pas à l’acte, mais par l’acte. Il n’a pas le choix. Michel-Ange, qui ne prenait guère le temps de manger et ne dormait que quelques heures précise :
‘« Je m’épuise de travail, comme jamais homme n’a fait, je ne pense à rien d’autre qu’à travailler jour et nuit ».’
Sans aucun doute, l’ambition d’un Michel-Ange, d’un Giacometti, ou d’un Rodin laisse à penser que le fantasme de toute puissance ne leur était pas étranger. Giacometti rêvait de réaliser « un petit univers semblable au grand univers. »
Quant à Rodin, regardons La main de Dieu qu’il sculpta. Qui est le Dieu ?
Enfin, les œuvres titanesques de Michel-Ange illustrent par elles-mêmes la tentation démiurgique de leur auteur.
Le sculpteur qui, comme le créateur au sixième jour modela de la terre pour faire l’homme, n’est-il pas secrètement tenté de se prendre lui-même pour ce premier sculpteur des temps? Derrière ce fantasme de toute puissance, c’est de repères, d’un cadre au sein duquel se mouvoir librement que cherche le sculpteur un peu tel un enfant en mal de limites.
Se confronter aux lois de la physique, c’est un peu être en quête de sa propre mesure.
En tentant de soumettre la matière à son action pour trouver la résistance, pour délimiter, celui qui œuvre chercherait à se circonscrire lui-même, trouver les cotes de l’humain, étalonner le réel.
Par ailleurs, la sculpture a privilégié le corps en tant que repère élémentaire. Sculpter permet de se confronter à l’image du corps, impliquant le Moi-peau, la frontière dedans-dehors.
C’est le volume du corps humain, c’est-à-dire la forme de l’artiste lui-même, qui sert de volume de départ, même chez les artistes qui plus tard s’en sont éloignés (abstraction).
Regarder le corps humain dans les traits d’un modèle ramène dans sa nudité et son dénuement au schéma corporel en soi. Est-il continu, morcelé, délimité par un Moi-peau suffisamment consistant ?
Soulignons aussi l’obsession de certains artistes pour une partie du corps en particulier. Giacometti était obsédé par les yeux qui révèlent le monde visible, Camille Claudel par les pieds et les mains qui permettent la préhension du réel.
Les destructions violentes, irrémédiables, et systématiques que Camille Claudel infligeait au corps de ses sculptures à une certaine période de sa vie pourraient être interprétées comme autant d’autodestructions.
H. Jousse85 souligne que Giacometti souffrait d’un manque de consistance et de continuité de son schéma corporel. Elle dit qu’il ne cessait, à travers son travail de sculpteur, de mettre en forme l’informe du corps, de son propre corps.
Il disait :
‘« Je ne sais plus qui je suis, où je suis, je ne me vois plus, je pense que mon visage doit apparaître comme une vague masse blanchâtre, faible, qui tient tout juste ensemble portée par des chiffons informes qui tombent jusqu’à terre »86. ’
Le Moi-peau de Giacometti semble ne pas remplir sa fonction. Le corps est sans cesse ressenti comme menacé de se vider. Rien n’est vraiment retenu à l’intérieur, les contours sont flous, « vagues » et l’ensemble est sans vie (« masse blanchâtre », c’est-à-dire vidée de sang). Il ne reste plus à Giacometti qu’à rechercher dans la structure osseuse de quoi soutenir un corps que la seule peau ne contient pas. De là, son obsession du squelette.
Sculpter permet une confrontation au schéma corporel, ainsi qu’une réélaboration permanente de celui-ci et du Moi-peau qui l’enveloppe, permettant de (re)délimiter le repère dedans-dehors. Sculpter constitue la mise en œuvre, en acte, de la recherche et la définition permanente de cette frontière. Elaborer un volume, c’est décider d’un contour qui va délimiter le vide du plein.
Regarder une sculpture, c’est voir tout ce qui n’est pas le vide et qui le comble si l’on regarde l’espace autour de l’objet, mais c’est aussi voir tout ce qui est plein si l’on choisit de regarder la matière elle-même. Entre les deux, une ligne imaginaire sépare, distingue, confère son existence au visible, constitue le trait qui délimite. Cette frontière recherchée peut aussi se toucher.
Cette quête est parfois mêlée d’angoisse. Giacometti qui cherche dans la sculpture la permanence de ce qui lui semble sans cesse se défaire écrit :
‘« Les têtes, les personnages ne sont que mouvement continuel du dedans, du dehors, ils se refont sans arrêt, ils n’ont pas une vraie consistance, leur côté transparent […], forme changeante et jamais tout à fait saisissable. » ’
L’intégration de la limite corporelle dedans-dehors est favorisée, nous l’avons vu, par la nécessité devant laquelle se trouve l’artiste de développer une perception du dessin de la ligne qui sépare ce qui est plein de ce qui est vide. Devant cet impératif, le psychisme du sculpteur va privilégier la constitution d’un Moi-peau. Si ce dernier joue efficacement son rôle, le sculpteur aura à sa disposition, et à la faveur de sa création, une enveloppe contenant des éléments sensoriels et émotionnels, une barrière protectrice de son identité et de son autonomie, un filtre des échanges intérieur/extérieur et enfin une surface d’inscription des excitations.
On pourrait dire de la sculpture qu’elle est la seule œuvre d’art qu’un aveugle pourrait voir, au sens de pouvoir se la représenter intérieurement en la touchant. La mise en acte du sens tactile et du toucher dans le travail de la sculpture permettrait de vérifier que « le réel est tangible.» La sculpture favorise l’appréhension tactile, le toucher étant le sens qui est prédominant dans cette forme artistique. L’approche sensuelle de la sculpture ne peut échapper tant à celui qui sculpte qu’à celui qui observe la sculpture.
Paul Claudel parle de la « fureur érotique » des œuvres de Rodin.
Le toucher du sculpteur peut parfois s’apparenter à ce que nous avons trouvé dans nos ateliers avec les patients qui semblent produire des « formes autistiques » avec lesquelles le créateur pourra jouer.
Nous ne pouvons pas d’avantage ignorer l’attrait régressif qu’elle exercesur nous, provoquant un moment de résurgence de l’enfant en nous, mu par l’envie irrépressible de toucher.
Paul Claudel, l’écrivain et le frère de Camille écrit à ce sujet :
‘« La sculpture est le besoin de toucher. Avant même qu’il sache voir, l’enfant brandit ses petites mains grouillantes. La joie presque maternelle de posséder de la terre plastique entre ses mains, l’art de modeler, de posséder, désormais durable entre ses dix doigts, ces formes rondes, ces belles machines vivantes qu’il voit se mouvoir alentours, c’est de quoi le désir apparaît chez lui le premier, satisfait de la première arche et de la première poupée »87. ’
Ces « formes » dont parle Paul Claudel ne sont pas sans rappeler les formes autistiques décrites par Frances Tustin88. Toucher, c’est régresser au moment de notre enfance où ce sens était primordial, c’est-à-dire toucher pour vérifier l’existence des choses. C’est le cas des petits garçons qui se touchent le pénis, aussi celui des psychotiques qui se touchent compulsivement le visage et le corps pour vérifier leur propre permanence.
Le sculpteur aurait-il besoin de cette réassurance ?
L’individu qui sculpte est plongé, par l’entremise de cet acte, dans une situation exceptionnelle et unique qu’aucune autre forme d’art ne pourrait lui offrir, et de laquelle va découler un ensemble de processus psychiques saisissant l’inconscient du sculpteur. Nous pouvons aussi mettre en exergue que le travail de la sculpture permet de placer l’objet créé en trois dimensions dans l’espace et de s’assurer de sa permanence (H. Jousse, 2008).
Le sculpteur doit « se figurer » sans cesse cet espace à trois dimensions et créer son œuvre en son sein.
Mais si sculpter c’est « remplir l’espace », ce dernier se résume-t-il à des coordonnées mathématiques, au vide, ou bien est-il à « trouver-créer » à chaque nouvelle pièce qui s’élabore ? Le sculpteur doit préalablement s’en faire sa propre représentation, réinventer l’espace, en quelque sorte.
Giacometti avait élaboré une solution pour figurer l’espace autour de ses sculptures : une cage sans barreau, une boîte qui n’aurait que des arrêtes et pas de plans, afin de voir au travers. L’espace est une notion abstraite et pour le moins difficile à appréhender. Elle s’assimile pour certains au vide.
En 1924, Giacometti notait la résolution suivante dans son journal :
‘« Ne plus faire de trous dans le vide. » ’
Il semble donc qu’il pouvait concevoir le vide comme une quasi substance.
Le sculpteur ne peut faire l’économie de penser l’espace. Percevoir la profondeur relève d’un apprentissage. Si nous ne sommes pas comme l’enfant ou comme le psychotique qui croit que ce qui n’est plus visible a disparu, c’est parce que nous « savons » par expérience que ce n’est pas le cas, et parce que nous avons acquis le sens de la permanence de l’objet. Toute la difficulté en sculpture consiste à toujours garder présent à l’esprit ce qui pourtant n’est pas apparent mais vit derrière, sur l’autre versant. Sculpter exige de représenter ce qu’on ne voit pas dans l’immédiat, de tenir compte de la face cachée, de pressentir que de l’autre côté, il existe autre chose.
Les sculpteurs utilisent d’ailleurs une « tournette » (planche qui tourne sur elle-même) sur laquelle ils placent l’œuvre en cours de réalisation qui leur permet d’intégrer en permanence cet espace à trois dimensions, l’œuvre se présentant alors en tant que volume, évitant par là même le risque du statisme.
Sculpter serait ainsi s’assurer de la permanence de l’objet. Chaque profil, tour à tour, apparaît puis disparaît pour ensuite réapparaître, tout comme la bobine dont Freud décrit l’usage qu’en fait l’enfant qui en joue du bout de son fil pour vérifier qu’elle est toujours là, bien que non visible, puisqu’il peut la faire réapparaître, prélude aux jeux de cache-cache.
Ainsi, l’image du corps mise en jeu par la sculpture, va pouvoir trouver un point d’unification là où il y a morcellement, continuité là où il y a discontinuité, permanence là où il y a mouvance.
Le travail de la sculpture permet dans un premier temps de reconstituer le tout à partir d’un morceau de corps (cf. sur ce point les résonances avec les travaux de Pankow qui utilise le modelage dans la cure psychanalytique avec des patients psychotiques et que nous allons aborder ensuite).
Le sculpteur se sert d’une partie du corps qu’il parvient à réaliser pour reconstituer le corps dans sa globalité. Il s’agirait d’une forme de métonymie sculptée (Jousse).
Giacometti tout comme Rodin en faisait une obsession dans son travail de représentation :
‘« Je suis réduit aux têtes pour le moment parce que si l’on avait une tête, on aurait tout le reste. » ’
Ou encore :
‘« Ce qui m’a amené à faire la sculpture de la jambe ? […] Il ne m’était pas possible, à l’époque de faire une grande figure avec les différentes parties bien déterminées et pourtant j’avais le désir de définir un bras, une jambe, un ventre. Il ne me restait que la possibilité de faire une partie pour le tout. » ’
Ceci est à la fois un aveu d’impuissance à faire autre chose que des morceaux mais c’est dans le même temps la révélation d’une stratégie du psychisme qui se sert de ce bout de corps façonné pour s’assurer de la représentation mentale de l’ensemble.
Quant à Rodin, il raconte comment il s’y prenait pour se constituer une « collection» de morceaux de corps. Il demandait à ses modèles de prendre des positions multiples en les alternant arbitrairement. Tout à coup, son attention était retenue par un bras levé de telle manière, par l’angle d’une articulation, par un geste, une façon de plier un membre ou de faire une torsion. C’est alors uniquement cette partie qu’il retenait dans l’argile, à l’exclusion du reste. Puis parfois longtemps après surgissait devant lui la vision intérieure de tout un corps issu de la partie conservée.
Ici, c’est le corps morcelé que l’esprit du créateur reconstitue. Tout le corps est pour lui contenu dans le morceau comme si une même logique préexistait à la partie et au tout.
Ces données s’articulent tout particulièrement avec notre clinique et les formes produites à l’atelier de médiation par la terre. Cette notion de « partie pour le tout » ainsi que celle du morcellement concerne bien les sujets auxquels nous avons à faire.
Sculpter est une activité du moi d’autant plus valorisante narcissiquement que la sculpture met en jeu l’image du corps, l’image de soi et permet de restaurer celles-ci.
Ces mécanismes projectifs, introjectifs et identificatoires font de l’activité de sculpter une activité du moi particulièrement revalorisante dès lors qu’est écarté le danger que comporte la « déliaison. »
La dimension projective de la sculpture ne peut échapper à celui qui la regarde. Cet « écran en trois dimensions » qu’est la sculpture va favoriser les mécanismes de projection. Que dire alors de celui qui a créé cet espace, le sculpteur lui-même ?
Le « double », autre soi même, serait chez le sculpteur sa propre sculpture, l’irréductible de ce qu’il est, un concentré de son être, la projection remaniée de l’idée qu’il se fait de lui-même. Tout se passe comme si le sculpteur confiait à sa sculpture la charge de le représenter pour ensuite s’identifier à cette réincarnation idéalisée de lui-même et qui le dépasse déjà.
Il se trouve que le moi idéal est souvent marqué chez les sculpteurs, par un idéal de toute puissance narcissique, un rêve de démiurge (nous l’avons mentionné au sujet de Michel-Ange).
Si la sculpture en cours est un objet idéal de projection, ceci l’est à plusieurs titres.
Tout d’abord, elle n’a pas encore de forme propre, et peut donc « prêter le flanc », sans les limites d’un objet préconçu, à la projection de toutes les émergences inconscientes.
Ensuite, elle est à la fois une chose et une personne lorsqu’elle représente un corps humain, sans revêtir les caractéristiques dangereuses d’une personne réelle sur laquelle l’inconscient peut hésiter à projeter. On a à faire à une projection sans que cela prenne pour autant l’aspect paranoïaque et pathologique qu’elle pourrait avoir.
Mais encore, elle prend forme peu à peu sous les effets modulateurs des projections successives.
Elle est mise à distance idéale, celle-ci étant choisie à chaque instant par le sculpteur qui peut, selon la force des affects en jeu, se rapprocher ou s’éloigner de l’objet, se confondre ou s’en distinguer plus ou moins.
Enfin, la situation modèle-sculpture-sculpteur peut permettre des projections superposées très intéressantes : le sculpteur peut projeter aussi bien sur le modèle vivant que sur la représentation qu’il va en faire. Son inconscient peut également « se servir » de l’énorme capacité suggestive et évocative de l’objet-modèle pour laisser émerger des éléments enfouis qui pourront ainsi êtres projetés sur l’objet-sculpture.
Nous pourrions aussi émettre l’hypothèse de cet autre cas de figure caractérisé par un processus en trois temps :
S’opère dans un premier temps une transformation de cette projection par transformation de la matière, qui permettrait l’acceptation de ce qui était inacceptable avant d’être transmué, cela concernerait alors l’introjection des éléments métabolisés grâce à cette transformation de la matière.
Ensuite, par ce processus, l’image du projeté devenue tolérable serait réappropriée par le sujet. Prenons l’exemple de l’image du corps. Si celle-ci n’est pas acceptée, il se peut que la vue du modèle réveille des projections qui vont venir se fixer sur la sculpture elle-même. Mais celle ci, n’étant pas « définitive », la projection de l’image du corps pourrait être modelée et ainsi rendue acceptable.
Enfin, elle devient donc possible à introjecter, et ceci qu’il s’agisse des affects eux-mêmes, de la cause des effets ou des qualités dont est investi l’objet lui-même.
La création par elle-même engendre une régression, comme nous l’avons abordé avec D. Anzieu. Le préalable de toute création est un état de crise qui a pour origine un bouleversement intérieur (dû à un événement déclencheur) qui, en quelque sorte « exacerbant » la pathologie latente de l’individu, va mettre en question les structures existantes et entraîner une régression.
Ainsi, le sculpteur comme tout créateur est soumis à ce processus régressif, mais, dans son cas, il est amplifié par le fait que l’activité de sculpter est déjà en soi une activité régressive.
En effet, du fait de la manipulation de la matière, à fortiori lorsqu’elle est humide (terre ou plâtre), s’attaquer à la matière, c’est accepter de replonger dans les entrailles de la terre mère, de la « prima materia. » La simple manipulation peut réveiller des affects enfouis depuis le début de l’histoire, début de sa propre vie intra-utérine, débuts de l’histoire de l’humanité (les premières œuvres d’art ont été façonnées d’argile ou de pierre).
Mais aussi, la sculpture confronte le créateur au travail tridimensionnel sur l’espace, travail qui ramène à l’espace originel, la matrice. Le premier espace que nous ayons expérimenté fut prénatal. C’est par le contact du corps logé dans le volume d’un autre corps qu’il nous fut révélé.
La sculpture oblige à une « régression » du fait que son travail renvoie de façon privilégiée au schéma corporel qui s’est constitué en amont, dans des temps archaïques où le corps était une découverte, l’expérience corporelle primaire avec la mère, voire des sensations de vide ou de manque peuvent être ravivées à cette occasion.
La petite fille Camille Claudel passait quant à elle le plus clair de son temps au Geyn (cette roche géante sculptée par la nature et l’érosion du temps), cette haute pierre dressée dans la lande champenoise. Cette expérience nous a été rapportée par elle-même et par son frère qu’elle entraînait dans ses explorations du géant.
Sculpter, c’est favoriser la régression parce que c’est toujours cette terre ou pierre originelle que va chercher à retrouver le sculpteur au travail. La crise créatrice n’est pas sans danger car l’artiste peut ne pas sortir indemne de la phase régressive de la crise, pour peu qu’il y rencontre le vide. Le risque de décompensation voire de mort psychique est réel.
Mais à l’exclusion de ce risque, l’activité du moi particulière qu’est l’activité de sculpter, produit chez le sculpteur des effets dont il est bénéficiaire.
Quels sont les bénéfices secondaires sur le plan psychique de l’art de sculpter ?
Les bénéfices sont secondaires en ce sens qu’ils sont des effets non recherchés mais inhérents au fait de sculpter.
Nous pouvons tout d’abord avancer que l’art de la sculpture permettrait à la psyché du créateur d’harmoniser une dualité interne entre diverses instances psychiques, dont la source serait le conflit entre le Moi idéal et le Surmoi.
Le Moi idéal se pose comme source du monde et de soi. Or, lorsque l’artiste sculpte un être humain, qui pour autant qu’il en porte les caractéristiques n’en est pas moins magnifié, ce double de l’artiste représenterait le Moi idéal, alors que le sculpteur devant sa sculpture incarne le Moi conscient.
Dans une telle situation, le Moi, sous la juridiction du Moi idéal laisserait celui-ci lui redorer son blason, lui panser ses blessures narcissiques, restaurer l’image qu’il se fait de lui.
Le Surmoi a beau tenter d’imposer la loi, son ordre restrictif, ses complexes ou ses inhibitions mentales, son joug sera amoindri parce qu’il a face à lui un adversaire qui serait « masqué. » En effet, le Moi idéal, fort de son incarnation sculpturale serait d’autant plus à même de mener à bien la lutte qui l’oppose au Surmoi pour gagner les faveurs du Moi conscient, médiateur et, en dernier ressort décideur.
Ensuite, le travail de la sculpture permettrait une restauration narcissique de l’image de soi. Grâce à cette influence de l’Idéal du moi sur le Moi qu’elle permet, grâce aux objets socialement valorisés qu’elle vise, grâce à la dimension narcissique qu’elle incarne, grâce à la projection de l’image de soi qu’elle favorise, ainsi qu’à l’expérience de castration qu’elle incite à dépasser, à son pouvoir d’unification et de liaison, la sublimation par la sculpture est une occasion inespérée de réparer des manques archaïques et des blessures narcissiques.
A partir des positions décrites par M. Klein (en particulier la position dépressive, qui fait suite à la position schizo-paranoïde), on peut dire que se présente à travers la sculpture une possibilité de réparation de l’objet. La pulsion d’agressivité (envers l’objet maternel) étant sublimée car dérivée vers un autre but, la sculpture, peut être dépassée. L’objet (la mère) ainsi déchargé d’agressivité, va pouvoir redevenir « bonne », la capacité d’identification possible et la « position dépressive » abandonnée.
Combien de Piéta le maître Michel-Ange a-t-il dégagé de la pierre comme pour retrouver au cœur de celle-ci l’amour d’une mère cruellement absente de la vie du sculpteur orphelin d’elle à l’âge de six ans ? Et la douleur de l’enfant face à la mort de sa mère n’est-elle pas à lire, en sens inverse, dans les traits de la vierge qui regarde son fils « sans vie » en apparence ?
La surpuissance émotive de la Piéta de Saint Pierre de Rome pourrait-elle être interprétée comme le résultat d’une judicieuse inversion des rôles, qui permet à Michel-Ange de recevoir le regard et l’amour qu’il n’a pas eu et qu’il prête à sa mère s’il était mort avant elle ?
La mère, cet être de nos origines qui marque à jamais de son empreinte la figure féminine qui vit en nous, nous la retrouvons chez nos sculpteurs derrière les traits de la vierge, de la madone, de la jeune fille, de la femme mure…
De la Piéta de Michel-Ange, aux courbes magnifiques des femmes et jusqu’à à la Clotho de Camille Claudel, en passant par les « femmes tas d’os » de Giacometti, l’histoire toujours remaniée, transformée, de ces premières relations dramatiques deviennent à travers leurs représentations l’incarnation d’un « trouvé-créé » avec l’objet maternel qui était resté « en rade » et le dépassent dans l’acte même de la création, chaque spectateur pouvant ainsi le reprendre à son compte.
La sculpture est antérieure aux mots comme le rappelle Michel Serres89 et qu’elle se laisse plus difficilement interpréter qu’un texte. Elle résiste au sens propre et au sens figuré. Elle dérive du rocher, de la pierre ou du pétrissage de matières plus malléables comme la terre. Elle fait partie de la masse qui la conditionne et en ce sens, elle relève autant du regard que du toucher. Michel Serres rappelle que le mot « masse » dérive du mot grec qui signifie « la pâte que l'on pétrit » et que pétrir et masser en grec sont un même verbe. La statuaire est, dans l’imaginaire collectif, au croisement du maternel et du phallique : par la « masse » véritable métaphore de l’inconscient, façonnée, travaillée par le sculpteur qui lui donne forme. En ce sens, cette pratique humaine est probablement celle qui a le plus d’affinités profondes avec le travail psychanalytique.
Le sculpté émerge de la masse, comme le « moi » du « ça.»
Freud, en un sens, ne s’est intéressé à la sculpture que pour les thèmes qu’elle véhicule, d’une manière pour ainsi dire littéraire, dans la mesure où celle-ci faisait partie d’un « texte » mythologique, religieux ou narratif, comme c’est le cas pour le « Moïse » ou la « Gorgone. » Il ne s’est pas intéressé à l’aspect tactile ou formel de la statue, préférant le signifiant au signifié et le mot au geste et à la matière. En ce sens, on pourrait dire que Freud ne s’est pas intéressé à l’acte du sculpteur, pourtant si proche de celui du psychanalyste, mais plutôt à son résultat, et à la forme organisée et insérée dans un discours, plutôt qu’à la forme naissante. Michel Ange et Freud sont, dans cette perspective, à la fois antithétiques et parfaitement complémentaires dans leurs démarches de « découvreurs » et de créateurs.
Représentation phallicisée du Dieu, du héros ou du prince, identification aux ancêtres, lien à la mort, mimétique des attributs corporels, ce sont là les fonctions de la statuaire classique connues par Freud et qui constituent la base de sa collection, ainsi qu’un apport essentiel à certains aspects de la théorie psychanalytique, comme les notions d’organisation « phallique », de phallus « maternel » et d’imago. Cette sculpture a cependant détourné Freud de certaines fonctions plus archaïques de la sculpture qui ne sont qu’apparues après sa mort, en particulier avec la découverte de l’art sumérien.
En 1930, la majorité des œuvres sumériennes n’étaient pas encore connues, comme le rappelle André Malraux90. Celles-ci n’ont été découvertes et publiées qu’après la guerre. En connaissant et peut-être en collectionnant ces œuvres n’aurait-il pas abordé plus précocement la problématique préœdipienne, comme l’ont fait les psychanalystes de la génération suivante, qui a été confrontée à une sculpture plus complexe et moins rationnelle ?
Entre Jérusalem, Athènes ou Rome, que peut nous apprendre une statuaire antérieure à l’écrit (pour le sumérien ancien) et complètement étrangère au monde gréco-romain et même en grande partie à l’égyptien ?
Les premières statues de l’art sumérien, comme les premières statues de l’histoire, sont féminines. Il s’agit des statues des « déesses-mères » qui remontent au Vième et IVième millénaire. L’écrit semble avoir eu des conséquences capitales sur la représentation des corps dans la statuaire. L’écriture cunéiforme ou les hiéroglyphes imposent une structuration du corps spécifique (séparation de la tête, des membres et du tronc) et une mise en page que l’on ne trouve pas dans les statuettes de déesses-mères qui sont toutes en courbes et en fluidité.
C’est la faible importance de la tête, véritable appendice d’un corps hyper sexualisé, aux seins et aux cuisses proéminentes, que l’on remarque en premier, dans cet art, ainsi que la position accroupie que certains spécialistes ont pu rapprocher de l’accouchement. Les « déesses-mères » sont une gestalt de la femme fantasmatique, assimilée aux seins, aux cuisses et aux fesses. Le sexe est rarement représenté ou simplement évoqué par une zone pubienne. Ce n’est pas le sexe qui représente l’élément dominant de la féminité (celui-ci ne figure que dans quelques statuettes comme une fente rapidement faite, peu profonde, juste ébauchée) mais plutôt des seins bombés que la divinité entoure souvent de ses mains, et surtout le nombril fortement marqué, véritable métaphore du sexe.
L’hypertrophie des formes, tout comme l’absence des têtes ou leur anonymat est-elle une expression du désir comme nous pourrions le formuler d’une manière moderne, une figuration d’objets de culte ou s’agit-il d’un ex-voto exprimant un souhait de fécondité ? Cette « sculpture des origines » est probablement aux confluents de ces trois dimensions auxquelles il convient d’ajouter la dimension tactile fortement présente dans ces figurines : les déesses-mères sont des objets faits pour être touchés, voire manipulés contrairement aux sculptures classiques plutôt destinées à être regardées.
Les statues des déesses-mères posent par ailleurs une question d’ordre phylogénétique : pourquoi la sculpture des origines débute-t-elle par des représentations féminines, la mère-nourricière semblant être représentée au début de l’humanité plutôt que le phallus ou la mère phallique ?
S’agit-il d’une représentation de la mère toute-puissante ou d’un prolongement de la palpation du sein par l’enfant dans le contact avec la terre cuite ou même la pierre dure ? On pourrait s’interroger, dans ce cas, sur l’utilisation par l’artiste de l’une ou l’autre matière pour signifier la plasticité ou la rigidité de la mère.
Nous pensons ici à Camille Claudel qui excellait dans l’art de sculpter le marbre et l’onyx, matériaux réputés difficiles, « froids » mais qu’elle a su animer, et qui ne donnent pas droit à l’erreur dans la taille.
Pour revenir à Freud, la mémoire phylogénétique est décrite par lui comme patrilinéaire, avec le « père de la horde », la « coalition des frères » et le meurtre puis l’idéalisation du père. Les « déesses-mères » pourraient représenter une phylogenèse d’un autre ordre, essentiellement lié à la mère, à l’enfantement et à la symbolique du sein. En ce sens, cette mémoire phylogénétique serait, comme celle du « père de la horde », associée à la survie de l’espèce, cette fois-ci non pas par la guerre et la coalition mais par la présence de la mère idéalisée, permanente et préservatrice.
Notes
80.
Cité par CLADEL J. (1936), Rodin, sa vie glorieuse et inconnue, Paris, Grasset.
81.
GSELL P. (1911), Auguste Rodin : l’Art. Entretiens réunis par Paul Gsell, Paris, Grasset.
82.
Ibid.
83.
JOUSSE H. (2008), Spécificités des processus psychiques en oeuvre chez le sculpteur, Topique, 2008/3, n°104, p. 173-100.
84.
SIMMEL G. (1990) Michel-Ange et Rodin, Petite bibliothèque Rivages.
85.
Op. cit.
86.
cité par JOUSSE H., Op. cit.
87.
CLAUDEL P. (1905), Camille Claudel statuaire, in PARIS R-M. (1984), Camille Claudel, Gallimard, 383 p., NRF, p.11-16.
88.
TUSTIN, F. (1989) Le trou noir de la psyché, Le seuil.
89.
SERRES M. (1993), Statues. Le second livre des fondations, Paris, Champs Flammarion, p.96.
90.
MALRAUX A. (1981), Préface à Sumer L’univers des Formes, Gallimard, p. 9.
6.5 Éléments pour une conclusion
A l’asile, ce renoncement à la création à laquelle et pour laquelle Camille avait pourtant tout sacrifié jusqu’alors, soulève d’importantes questions, sur lesquelles nous terminerons avant de proposer une conclusion pour cette courte étude.
De nombreux portraits de Camille frappent par leur tendance à incarner les âges de la vie : enfants, jeunes filles, femmes et vieille femme. Une vieille femme dont le corps abîmé, décharné, prend sens par rapport à son nom : Clotho, l’une des Parques, référence au temps imparti à chacun de nous, image du destin.
L’âge mûr, qu’on a trop facilement attribué à une représentation de Rodin arraché à la jeune Camille par la vieille Rose Beuret, s’inscrit dans cette thématique du temps qui passe, une dominante qui révèle une angoisse démesurée chez le créateur.
A l’asile, le temps est comme suspendu, Camille est alors prostrée, comme « hors du temps » (le temps circulaire de la psychose).
Peut-être Camille s’est-elle rapprochée des origines de la création au point de se confondre avec elles ?
Camille était-elle devenue à son tour, dans cet asile, « une créature », à l’existence minérale et atemporelle ?
Peut-être qu’à l’asile de Montdevergues, pendant ses trente longues années de silence, Camille Claudel a créé inlassablement, farouchement et passionnément le Néant ?
A ce propos nul ne sait et ne saura rien.
En écrivant ces quelques lignes à son sujet, cette première mise à distance que permet l’écrit ne suffit pas à calmer l’intensité de l’émotion qui est la nôtre à l’évocation de son parcours et de ses œuvres.
Il fallait un courage fou pour affronter une telle destinée !
Le défi était peut-être le trait personnel le plus visible de Camille Claudel. Elle défia les préjugés de la société dans laquelle elle vivait dans presque tout ce qu’elle entreprit.
Tout d’abord sa carrière de sculpteur, ensuite son entrée dans un atelier où, avant elle, ne travaillaient que des hommes. Plus encore, sa liaison avec le maître de cet atelier, ainsi que sa détermination à sculpter le nu avec la même liberté que ses collègues masculins, mais aussi son insistance à solliciter les commandes de l’Etat pour des œuvres qui ne pouvaient que choquer la morale sexiste du monde de l’art.
Chacun de ses choix défiait les préjugés de son époque.
Il lui fallut un courage immense pour continuer à rejeter les restrictions qu’on voulait imposer à sa liberté d’expression, malgré les représailles réelles dont elle était la victime, et qui constituèrent malheureusement le creuset de ce qui prendra une tournure tout à fait délirante (au sens psychopathologique du terme).
En refusant de s’incliner devant ce que la société du XIXième siècle attendait d’une femme dans le domaine de la création artistique, Camille Claudel s’accorda la liberté de créer des œuvres capables de rivaliser avec celles des plus grands artistes et elle put leur donner une profondeur émotionnelle et sensuelle entièrement originale.
C’est d’ailleurs elle qui libéra la nouvelle sensualité que l’on trouve dans les plus grandes œuvres de Rodin.
Le génie de Camille Claudel se reconnaît également dans son talent exceptionnel à tailler la pierre, dans son sens inné de la forme et dans la hardiesse avec laquelle elle interprétait le nu.
Pour terminer, je propose et prends le risque d’une conclusion en prose poétique, que ce parcours et la rencontre avec l’œuvre de Camille Claudel m’a donné envie de composer...
‘« L’avare terre qui ne ment jamais.
Lorsque la lune passe au travers de l’asile où elle a perdu la notion du temps,
Elle respire l’odeur de la terre.
Regardez-la à genoux, cette douleur de femme ensevelie dans la lumière 91 .
Elle gratte de ses deux belles mains à la terre arrachée du sol, la terre de Villeneuve.
Elle qui sera tour à tour belle Intransigeante, Féroce amie,
Pourquoi la douleur a-t-elle eu raison d’elle ?
Sa famille autour est un monde de silence ou de conflits dont Elle se fiche.
Entendue par le père qui accède à sa demande.
Une respiration,
Un geste émergent.
Une main s’approche de la chose informe, la réchauffe et la transforme,
Contact-toucher la matière.
Un premier rythme.
S’en imprégner et tour à tour s’en détacher ?
Sentir en son corps le mouvement,
Celui de l’Irreprésentable à mettre en forme, ordonner.
Corps à corps, incarner les sensations,
de l’émotion touchée au partage.
Dans la sphère fusionnelle et une, seule, volcanique,
jusqu’à l’Intermédiaire.
Goût, odeur, mouvance, humide, peau, tactile,
les sens en errance,
se regroupent.
Le bloc. Prima matéria.
T’attaquer pour mieux t’apprivoiser !
Sauras-tu expérimenter, réceptionner en ton sein,
à partir et au delà du corps à corps
charnel, sensuel, érotique et cruel,
cet espace-carapace entre-deux ?
Peur d’être envahie.
Elle a peur de perdre ce qui la rattache à cette communauté des vivants.
Elle redoute qu’on la suive de trop près.
Elle est muse intransigeante, plus que cela,
Elle crée.
Elle veut et cherche obstinément le Fond, à partir duquel la profondeur et la résonance des corps-matière se déploient et pas seulement l’écho du miroir.
Elle recherche avec acharnement à incarner dans la pierre une différence, celle qui signerait le volume à partir de l’érotisme fusionnel et magnifique avec la peau maternelle et jamais vécu en son temps,
que le passage au trois, plus loin que la soustraction et la division,
Est Un possible,
et que s’y crée,
par surcroît, un petit Plus de Rien du Tout,
une Adversité toujours tumultueuse,
Quand bien-même le Tourment qui la distord tendra sournoisement à couper tous les liens,
L’œuvre-signe restera.
Défiant la fosse commune où Elle gît.
La Trace inconditionnelle presque domptée,
celle aussi du Désir partagé et jamais abouti,
Trace et Signe d’une blessure féminine,’
Manque,
à jamais refermée,
inscrite en son sein et comme ouverte,
et pour toujours,
Fendue. »
Notes
91.
CLAUDEL P. L’endormie.
|
|
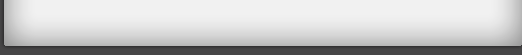 |
|